Pratiques Industrielles et Vie Quotidienne: Conserveries et Ferblanteries Nantaises XIXème siècle - XXème siècle
Práticas industriais e vida quotidiana: Fábricas de conservas e estanhagem de Nantes Século XIX - Século XX
Roger CORNU Phanette de BONAULT- CORNU
Chapitre IV – Le potager de fer-blanc
Capítulo IV -A Horta de Folha-de-Flandres
“De toutes les conserves de légumes, écrit Antonin ROLET dans son traité de conserves, c’est peut-être le pois qui occupe le premier rang dans les conserves APPERT, bien qu’il soit un des plus difficiles à traiter”[1]. C’est encore du petit pois qu’il s’agit lorsque GRIMOD de la REYNIERE chante, dans l’Almanach des Gourmands, les conserves de M. APPERT : “… ce résultat est d’avoir dans chaque bouteille et à peu de frais, un très fort plat d’entremet qui nous rappelle le mois de mai au coeur de l’hiver, et souvent même à s’y tromper lorsqu’il a été accommodé par un cuisinier habile ; ce n’est point une exaggeration de dire que les petits pois surtout, préparés ainsi, sont aussi verts, aussi tendres et aussi savoureux enfin que ceux que l’on mange en pleine saison. M. APPERT prépare de la même manière des fèves de marais, soit avec leur robe, soit dérobées, des haricots verts, des haricots blancs, etc…”[2].
1 A. ROLET – Op. cité p. 33.
2 Cité dans Les Conserves – Document UPPIC – 1975 – p. 10.
Le petit pois est au centre de la réflexion sur les conserves de légumes pour plusieurs raisons : légume estimé, sa réussite en conserve, notamment pour la couleur et le goût, est un critère de qualité. Légume fragile et fermentant rapidement il implique l’amélioration des techniques utilisées et notamment les recherches dans le domaine de la mécanisation.
Les conserveurs nantais vont prendre une place importante dans la production des conserves de légumes. En 1908, Auguste CORTHAY, le directeur de La Conserve Alimentaire, en route pour la Nouvelle Calédonie, note au cours de son escale à Colombo (Ile de Ceylan) que “sous ces climats humides et chauds… les boîtes bombent facilement”. Exhortant les conserveurs à faire des conserves de qualité permettant d’éviter cette détérioration, il ajoute : “par contre toutes les boîtes de légumes de RÖDEL, AMIEUX, de GARRES, de RAYNAL, de ROQUELEUSE, de BOUCHARD, de SAUPIQUET, de CASSEGRAIN, de TIROT, et de bien d’autres dont le nom m’échappe, rien n’a bombé”[1]. On retrouve dans cette liste, à côté des bordelais, quatre entreprises nantaises.
[1] La Conserve Alimentaire – Juin 1908 – p. 83.
1 LES PETITS POIS DE M. APPERT:
A lire les textes sur l’appertisation et l’hommage rendu à APPERT, c’est l’idée de la conservation qui est mis en exergue. La lecture du texte d’APPERT nous montre par contre les difficultés techniques qu’il dut affronter.
Laissons de côté, pour l’instant son atelier pour traiter les viandes et celui pour préparer le lait, pour atteindre les 3ème et 4ème pièces : “Les ustensiles qui meublent la troisième pièce pour les procédés préparatoires, se composent :
“1° de rayons de planches à bouteilles dans le pourtour.
“2° d’un dévidoir pour le fil de fer destiné à ficeler les bouteilles et autres vases.
“3° de cisailles et de pinces pour ficeler.
“4° d’un petit tour pour tordre le fil de fer, lorsqu’il est dévidé et coupé de longueur.
“5° de deux mâchoirs à levier pour mâcher les bouchons.
“6° d’un casse-bouteilles ou billot monté sur trois pieds, garni d’une forte palette pour boucher.
“7° d’un tabouret monté sur cinq pieds pour ficeler.
“8° d’une quantité suffisante de sacs de treillis pour envelopper les bouteilles et autres vases.
“9° de deux tabourets couverts de cuir, rembourrés de foin, pour tasser ceux d’entre les objets renfermés dans les vases qui ont besoin de l’être.
“10° d’une presse pour les sucs de plantes, de fruits, d’herbes et le moût du raisin, avec les terrines, vases, tamis et tout ce qui est nécessaire.
En outre de ce laboratoire ainsi composé, j’ai établi trois ateliers [1].; le 1er pour faire préparer les légumes ; il est garni de tables au pourtour.
“Le second, distribué en fruitier, pour recevoir et préparer tous les fruits.
“Le troisième est un cellier garni de planches à bouteille, pour rincer, resserrer les bouteilles et autres vases au magasin”[2].
“Le quatrième (local) est meublé de trois grandes chaudières en cuivre, montées sur des fourneaux en maçonnerie. Ces chaudières sont munies d’un fort couvercle assez juste pour entrer dans l’intérieur et peser sur les vases. Chaque chaudière est armée d’un fort robinet au bas, pour lâcher l’eau en temps utile ; ces vaisseaux reçoivent généralement tous les objets que je destine à être conservés, pour leur appliquer d’une manière convenable l’action du calorique au bain-marie”[3].
Le petit pois d’APPERT est le pois au naturel par excellence, celui qui se faisait encore dans les familles il n’y a pas très longtemps, mis en bouteilles ou en bocaux et stérilisés au bain-marie dans une lessiveuse.
[1 ]Retenons ici cette notion d’atelier qui ne s’identifie pas avec le local mais un coin du local délimité par une activité. Dans les manufactures de tabac, l’atelier dépasse le cadre d’un local mais là encore c’est l’activité qui le définit, c’est à dire le procès de travail à effectuer, les outils et les hommes qui sont nécessaires. On retrouve aujourd’hui quelque chose de proche dans la formation et l’animation lorsque l’on parle du travail ou d’une activité de loisir” ou “en ateliers”, ou encore des “ateliers” de discussion.
[2] N. APPERT – Op. cité – p. 12-14.
[3]Idem – p. 10.
BEAUVILLIERS, le cuisinier déjà cité conseille de prendre des petits pois très fins, “ceux appelés cassés sont les meilleurs”. “Ayez des bouteillesneuves ou très propres ; remplissez-les de petits pois sans les fouler : laissez-y plutôt un peu de vide; bouchez-les avec de bons bouchons de lièges neufs. Ficelez vos bouteilles avant de les mettre dans l’eau, soit avec du fil de laiton ou de fer ; posez-les dans un chaudron rempli d’eau fraîche ; mettez ce chaudron sur un feu modéré, faites-le aller doucement jusqu’à ce que l’eau bouille. Laissez cuire ainsi vos pois pendant une heure ; sortez votre chaudron du feu, laissez refroidir l’eau, retirez vos bouteilles, goudronnez vos bouchons… Ayez dans un endroit frais des planches percées, appelées vulgairement planches à bouteilles ; posez dessus vos bouteilles, comme on y pose celles qui sont vides. On peut aussi faire un trou dans la terre, y mettre les bouteilles sans-dessus-dessous, et les couvrir de terre. Lorsque vous voudrez servir de vos pois, faites-les blanchir et cuire comme dans leur primeur…”[1].
[1] BEAUVILLIERS – Op. cité supl. – p. 25-26.
On aura reconnu là la fabrication de ces bouteilles qui se retrouvent aux trois-quarts pleines après stérilisation et qui est le propre du procédé APPERT sous sa forme originelle.
Si le principe de l’appertisation est simple, APPERT se heurte au départ au problème des récipients et de la fermeture étanche : “J’ai fait choix du verre comme étant la matière la plus imperméable à l’air. Je n’ai hasardé aucun essai avec d’autres matières. Les bouteilles ordinaires ont généralement des embouchures trop petites et mal faites ; elles sont trop faibles d’ailleurs pour résister sous la palette et à l’action du feu. J’ai donc fait des bouteilles exprès, ayant des embouchures plus grandes avec étranglement, c’est à dire avec un filet saillant dans l’intérieur de l’embouchure au-dessous de la cordeline (ou bague).
Mon but était que le bouchon introduit de force sur le casse-bouteille dont j’ai parlé, à l’aide de la palette, jusqu’aux trois-quarts de sa longueur, fut étranglé par le milieu. De cette manière la bouteille se trouve parfaitement bouchée à l’extérieur de même qu’à l’intérieur. Elle oppose ainsi un obstacle à la dilatation qu’opère l’application du calorique aux substances renfermées dans la bouteille.
Cette manière de boucher est d’autant plus indispensable, que j’ai observe plusieurs fois que la dilatation était si forte dans cette circonstance, qu’elle repoussait dehors des bouchons de deux, trois et quatre lignes, quoique maintenus de deux fils de fer en croix. Les bouteilles et vases doivent être de matière liante, les premières de vingt-cinq à vingt-six onces pour un litre de capacité, dont le verre soit réparti également ; autrement elles cassent au bain-marie à l’endroit le plus chargé de matière. La forme de Champagne est celle qui convient le mieux, elle est la plus belle et celle qui résiste le mieux que tous les autres.
“C’est généralement une économie bien mal entendue que celle de 20 et même de 40 sols sur un cent de bouchons, parce qu’à l’appât de 2 centimes que vous croyez gagner sur un bouchon, vous sacrifiez souvent par cette lésinerie une bouteille de 20, 30 sols et même de 3 livres et plus. On bouche pour conserver et améliorer l’objet bouché en le privant du contact de l’air ; on ne peut donc faire trop d’attention à la bonne qualité des bouchons, qui doivent être de 18 à 20 lignes de longueur, et du liège du plus fin ; ce sont véritablement les plus économiques.
L’expérience m’a tellement prouvé cette vérité que je ne me sers que de bouchons superfins pour toutes mes opérations. Je prends encore la précaution de mâcher chaque bouchon aux trois-quarts de sa longueur, en commençant par le bout le plus petit, par le moyen du mâchoir en comprimant ainsi le bouchon ; le liège devient plus souple, les pores du liège se rapprochent ; le bouchon s’allonge un peu, et diminue de grosseur à l’extrémité qui doit entrer dans l’embouchure de la bouteille, de sorte qu’un gros bouchon peut entrer dans une embouchure moyenne.
“L’action du calorique dans le vase ainsi clos, est tel que le bouchon grossit dans l’intérieur du vase et opère le parfait bouchage…
“Avant de boucher, je fais attention que les bouteilles contenant des liquides ne soient pleines qu’à trois pouces de la cordeline (ou bague), afin d’éviter la casse qui serait la suite nécessaire du gonflement produit par l’application de la chaleur au bain-marie, si les bouteilles étaient trop pleines.
Quant aux légumes, aux fruits, aux plantes, etc, deux pouces de la bague ou cordeline, suffisent. Je pose la bouteille pleine sur le casse-bouteille déjà cité, devant lequel je suis assis. Cet appareil doit être garni d’une forte palette en bois, d’un petit pot plein d’eau, et d’un couteau bien affilé, graissé d’un peu de suif ou de savon pour couper les têtes des bouchons, qui doivent rarement se trouver trop haut à l’extérieur de la bouteille. Les choses ainsi disposées, j’approche le cassebouteille entre mes jambes ; je présente à ma bouteille le bouchon qui lui convient ; après l’avoir trempé à moitié dans le petit pot d’eau, pour qu’il entre plus facilement, et en avoir essuyé le bout, je l’appuie en tournant contre l’embouchure ; je le soutiens dans cette position de la main gauche, que je tiens ferme pour que la bouteille soit d’aplomb. Je prends la palette de la main droite pour introduire le bouchon de force. Lorsque je sens au premier ou au second coup de palette, que le bouchon est un peu rentré, je le quitte pour prendre de la même main le col de la bouteille, que je tiens ferme et d’aplomb sur le case bouteille, et à coups de palette redoublés, je continue d’introduire mon bouchon jusqu’aux trois-quarts de sa longueur. Le quart du bouchon qui doit excéder la bouteille, après avoir résisté aux coups redoublés de la palette, m’assure d’une part que le vase est parfaitement bouché, et de l’autre cet excédent est necessaire pour appuyer mon bouchon de deux fils de fer en croix ou de deux ficelles, pour le maintenir contre la compression qu’il éprouve au bain-marie. On ne peut faire trop d’attention pour parvenir à bien boucher ; aucuns petits soins ne doivent être négligés, pour que la substance qu’on veut conserver soit privée rigoureusement du contact de l’air, puisque c’est l’agent destructeur le plus à craindre…
“Ensuite je mets chaque bouteille dans un sac de treillis ou de grosse toile, fait exprès, assez grand pour l’envelopper tout entière jusqu’au bouchon.
Ces sacs sont faits comme un manchon, ouverts également par les deux bouts, l’un duquel est froncé par une coulisse et un cordon, que ne laisse d’ouverture, que de la largeur d’une pièce de cinq francs. L’autre bout est garni de deux ficelles pour tenir le sac autour du col de la bouteille. Au moyen de ces sacs, je suis dispensé de
me servir de foin ou de paille pour emballer les bouteilles dans le bain-marie, et lorsqu’il s’en casse dans l’opération, ce qui arrive quelquefois, les tessons de bouteilles cassées restent dans le sac…
“Je range tous les vases ou bouteilles debout dans une chaudière. Ensuite je l’emplis d’eau fraîche, de manière que les vases y baignent jusqu’à la cordeline (ou bague). Je couvre la chaudière de son couvercle, lequel je fais poser sur les vases ; j’entoure le dessus du couvercle d’un linge mouillé, afin de fermer toutes les issues, et empêcher l’évaporation du bain-marie le plus possible. Aussitôt la chaudière ainsi disposée, je mets le feu dessous ; lorsque le bain-marie est au bouillon, ou à l’ébullition, je continue ce même degré de chaleur plus ou moins de temps, suivant la nature des objets qu’il contient. Le temps révolu, je retire bien exactement le feu dans un étouffoir. Un quart d’heure après le feu retiré, je lâche l’eau du bain-marie par le robinet ; une demi-heure après l’eau retirée, je découvre la chaudière ; je n’en sors les bouteilles ou vases, qu’une heure ou deux après l’ouverture, et mon opération est ainsi terminée…
“… J’ai le plus grand soin d’examiner, en sortant de la chaudière, toutes les bouteilles l’une après l’autre avec la plus grande attention.
“J’en ai remarqué avec des défauts dans le verre comme des étoiles, des fêlures, occasionnées par l’action du calorique au bain-marie, ou par le ficelage, lorsque l’embouchure du vase est trop faible ; d’autres qui annonçaient par un peu d’humidité autour du bouchon, ou par de petites taches à l’embouchure, que l’objet renfermé avait filtré au-dehors au moment de la dilatation qu’opère l’application de la chaleur au bain-marie ; voilà les deux remarques principales que j’ai faites ; aussitôt que j’ai reconnu Quelques bouteilles avec ces défauts, comme j’étais sûr qu’elles ne se conserveraient pas, je les ai mises de côté pour en faire usage de suite, afin qu’il n’y eut rien de perdu.
“La première cause d’avarie que je viens de signaler, tient à la qualité et à la mauvaise confection des bouteilles ; mais la seconde, peut provenir, 1° d’un mauvais bouchon ; 2° d’avoir mal bouché ; 3° d’avoir trop empli la bouteille; 4° enfin de l’avoir mal ficelée, etc.. Une seule de ces fautes suffit pour perdre la bouteille, à plus forte raison lorsqu’il y a complication”[1].
[1] N. APPERT – Op. citó – P. 15-23, 27-28, et 30-31.
A travers la description minutieuse faite par Nicolas APPERT, on peut imaginer le nombre d’échecs, d’entailles aux doigts avec les morceaux de verre, de bouteilles dont le contenu se détériore, etc.. On peut imaginer aussi le nombre d’observations et d’analyses qu’il a faites avant de contrôler correctement la fabrication des conserves, peut-être aussi d’incertitudes quant à l’origine des échecs : le principe ou les moyens techniques. On peut aussi imaginer combien sa période de travail dans les caves de champagne a pu lui servir pour la connaissance des bouteilles et le bouchonnage. A la façon de décrire, on imagine bien N. APPERT enseignant à l’un, à l’autre son système de conservation et les problèmes qu’il soulève. Tous ces éléments ont dû faire parti des conversations qu’il eut avec COLIN père et fils en ce Noël 1805 qu’il passa chez eux.
On peut encore l’imaginer disant aux COLIN : “Dans l’application de la chaleur au bain-marie, j’ai rencontré bien des obstacles, particulièrement pour les petits pois ; car c’est de toutes les substances la plus difficile à conserver parfaitement. Ce légume cueilli trop tendre ou trop fin, fond en eau ; la bouteille se trouve en vidange de moitié, et cette moitié n’est même pas propre à être gardée (lorsque j’en trouve par hasard dans ce cas, j’ai le soin de les mettre de côté pour en faire usage de suite). Si les petits pois sont cueillis de deux ou trois jours par la chaleur, ils ont perdu toute leur saveur ; ils durcissent, ils entrent en fermentation avant l’opération ; les bouteilles cassent successivement, ou sont défectueuses, ce qui se reconnaît facilement par le suc qui se trouve dans la bouteille, lequel est trouble au lieu que les petits pois bien conservés ont leur suc limpide”[1].
Vu les inconvénients des bouteilles et les risques de casse dans les transports, la bouteille sera rapidement abandonnée pour l’essentiel des produits à l’exception des fruits, des sauces et condiments. Ce ne sont que ces derniers produits qui sont encore en bouteille chez COLIN en 1836, BERTRAND en 1840 ou PENEAU en 1844. Les gros fruits entiers, comme les pêches sont déjà mis en boîtes.
II. LA FABRICATION DES PETITS POIS :
On ne sait que très peu de choses des débuts de cette fabrication, sinon qu’en 1836 la Maison COLIN produit 27.000 boîtes de petits pois, ce qui est peu par rapport aux 40 à 50.000 litres de fruits ou aux 100.000 boîtes de sardines.
Le prix de la boîte est équivalent à 8 jours de salaire d’une ouvrière qui travaille à la fabrication, ou au prix payé au cultivateur pour 5 à 10 kilos de petits pois (selon la qualité et la saison). Le journal LE BRETON écrit en 1836 : “Pendant la
saison des petits pois qui dure 10 semaines, 300 femmes sont employées et font une journée de 14 heures. Elles reçoivent un salaire de dix sous mais trois copieux repas leur sont servis.
“L’enlèvement des cosses de petits pois demande chaque jours sept tombereaux.
“Presque tous les cultivateurs de la commune de Chantenay se sont adonnés à la culture des petits pois, laquelle est des plus rémunératives. COLIN leur achète à un prix variant de 0,20 à 0,40 la livre. On calcule que dans ladite commune, la dépense des échalas nécessaires pour ramer la précieuse légumineuse n’est pas chaque année inférieure à 30.000 francs”[1.]
[1.] Citó par LIBAUDIERE Félix. Des origines de l’industrie des conserves de sardines (1824-1861). Nantes – Mellinet 1910.
La seconde description que nous ayons nous vient par la tradition orale consignée dans un journal d’entreprise en 1951. Il s’agit de la description des usines AMIEUX vers 1855. L’auteur de l’article, jeune, a entendu une ancienne ouvrière âgée, raconter avant 1935, ses souvenirs de jeunesse. Le texte ainsi obtenu mélange la réalité et la mythologie qui entoure la conserve nantaise et celle de la Maison AMIEUX : “Le dernier témoin oculaire de cette présence AMIEUX, quai de Turenne, a été madame GARNIER, notre ancienne gérante des usines de Port-Louis puis de l’Ile d’Yeu, morte en 1935 aux alentours de 90 ans, et qui nous racontait que petite fille, vers les années 1853-55, elle allait porter avec sa mère le panier de midi de son papa, contre-maître au quai de Turenne.
“La maison lui semblait fort grande et imposante. Au rez-de-chaussée se fabriquaient les conserves qui étaient ensuite montées au premier étage où les boîtes étaient soudées à la main et mises dans des autoclaves à fer nu. De loin, nous disait-elle, la maison apparaissait tellement pleine de fumée et de bruits que l’on aurait dit une forge ! Voilà pour le côté impressionniste.
“Mais le côté romantique n’en était point pour autant exclu; et rien n’était plus pittoresque, parait-il, que la saison des petits pois au quai de Turenne.
“Aux premières heures du jour les savoureux légumes arrivaient par bateaux plats des campagnes en Amont : Saint-Sébastien, Thouaré, Barbechat, Saint-Julien et Mauves. Les mariniers débarquaient les vertes corbeilles sur le terre-plein en contre-bas du quai, où l’on accédait à l’usine par un escalier aux marches de granit.
“L’écossage des gousses se faisait naturellement à la main… Pour cet écossage l’on recrutait donc les commères du quartier, accompagnées souventes fois de leurs petites et grandes filles ; et le rez-de-chaussée de la maison tout encombré de tables et de matériel à conserves, étant bien trop étroit pour contenir corbeilles et corbeilleuses, tout ce monde s’installait sur la berge du fleuve, et travaillait gaiement aux clairs matins de Mai, ou bien cherchait abri sous les grands parapluies maraîchères quand le “crachin” estompait de son voile gris les silhouettes de l’Ile Feydeau. Aux jours de beau temps, les badauds ne manquaient pas, et les quolibets s’échangeaient avec les lavandières et les mariniers menant leurs chalands au fil de l’eau.
“Charmante image des jours révolus, pleine de sève populaire, et vive en couleurs comme une gravure de DEBUCOURT”[1]. C’est pratiquement toujours l’écossage qui tient la place centrale dès que l’on aborde le problème des petits pois et c’est autour de lui que se construit le folklore qui renvoie soit à l’écossage à la ferme, confondu en ce cas avec l’égoussage (gousses séparées du pied) , soit avec l’arrivée de la main-d’oeuvre saisonnière, par exemple les bretonnes avec leurs coiffes dans la commune de Chantenay, et ceci jusqu’à la mise en place des écosseuses mécaniques, puis des batteuses de plein champ.
En 1840, la liste des productions du conserveur F. BERTRAND (devenu par la suite PHILIPPE et CANAUD) mentionne trois types de conserves de petits pois : au beurre, au saindoux, au jambon [2]. En 1843, la conserverie BONHOMME-COLIN (successeur de Pierre Joseph COLIN) produit cinq sortes de petits pois : accommodés, à l’anglaise, au jambon, au jus, au saindoux [3]. Les pois peuvent aussi servir de garniture à des conserves de viande comme le veau aux petits pois de Joseph PENEAU.
[1] “Toujours à mieux”. Bulletin de liaison du personnel de la société. AMIEUX- Décembre 1951 n°2.
[2] Archives Municipales de Nantes.
[3] BONHOMME-COLIN Jules. Notice sur les conserves alimentaires et sur leur application possible à la nutrition de la Marine, l’Armée, les Classes Ouvrières, les hôpitaux et les prisons. Nantes – Imprimerie Merson, rue Notre-Dame 3 – 1843 – 79 P.
On ne peut comprendre les formes de préparation des conserves de petits pois si l’on ne prend pas en compte les caractéristiques du produit et les moyens techniques disponibles. Au moment de la cueillette une même gousse peut donner des petits pois de différents calibres, de l’extra-fin au gros pois. En second lieu, au fur et à mesure que la saison avance, pour un même calibre d’une même variété de petits pois, le grain devient de plus en plus farineux et de moins en moins vert et la taille des pois tend à augmenter. En troisième lieu, ses caractéristiques (tendreté et verdeur) dépendent des terrains et des variations climatiques. Nous reviendrons plus loin sur ces aspects de culture.
Il est des façons d’accommoder les pois qui permettent de traiter toutes les tailles à quelque moment de la saison que ce soit. Ce sont d’abord les recettes héritées des confiseurs, les pois au beurre ou au saindoux ; ce sont ensuite les pois cuisinés et mis en boîte. Les pois au lard ou au jambon participent de l’une ou l’autre méthode.
Avec la conserve APPERT, de nouvelles techniques vont apparaître. Dès le début, on fabrique les pois au naturel, procédé qui permit de réduire les difficultés rencontrées par APPERT et qui se fait encore à la fin du XIXème siècle de la même façon, dans certaines conserveries. J.B. ALBERT, traiteur et conserveur, fournit la recette à “la très chère soeur Narcisse, Econome de la communauté de Mormaison Vendée” : “Pour faire les petits pois en conserves, il faut les plonger dans l’eau bouillante et au premier bouillon les retirer pour les rafraîchir puis les mettre dans la boîte, les couvrir d’eau salée comme pour la soupe, ensuite les faire souder et les passer à l’ébullition pendant deux heures et demi” [1]. Une stérilisation aussi longue se fait au bain-marie. Avec l’autoclave, le temps de cuisson-stérilisation sera ramené au début du siècle à 1/2 heure à 112 degrés.
[1] Archives ALBERT : Lettre du 16 juillet 1895.
Réussir à conserver de façon correcte les petits pois nécessitait des modifications techniques permettant notamment le raccourcissement de la durée de stérilisation. Le premier système a consisté à ajouter du sel dans l’eau du bain-marie afin de faire monter le degré d’ébullition et par là même raccourcir le temps de cuisson. Le second système qui fut progressivement perfectionné, fut l’autoclave. La première marmite autoclave, celle de LAMARRE, ne possédait pas de manomètre et fut à l’origine de nombreux accidents. Ce n’est qu’après la mise au point du manomètre de BOURDON que le premier autoclave fut mis au point par CHEVALLIER-APPERT vers 1850. Une troisième méthode enfin consistera à stériliser en faisant le vide dans la boîte. Dans tous les cas, la réduction du temps de cuisson-stérilisation améliorait la qualité du produit.
Il reste que le pois au naturel ne pouvait être fait correctement qu’avec des “pois très frais du commencement ou du milieu de la saison” [1]. S’il avait pu satisfaire les gastronomes du XIXème siècle, il n’en allait plus de même au début du XXème siècle : “le pois à la Française ou pour mieux lui laisser l’appellation qui lui est propre, pois au Naturel, a été très dédaigné depuis longtemps, il n’a pas de couleur, pas d’aspect et trop peu de goût, à la faute de nous tous Messieurs, qui en préparons depuis longtemps sans chercher à le préparer en lui laissant la plus grande partie des principes qu’il contient et qui font toute la valeur de ce légume tant aimé, tant goûté.
“Blanchir le pois dans l’eau, le rafraîchir dans l’eau, ajouter une saumure légèrement sucrée, voilà le pois à la française pour tout le monde,… c’est partout bonnet blanc et blanc bonnet. C’est ainsi que disparaissent dans l’eau la fécule et tous les autres principes du pois, il ne reste que des fécules et un peu de matière pâteuse sans goût, sans aspect, ce qui fait que personne n’en veut”[2].
[1] La Conserve Alimentaire – septembre 1915 – p. 515.
[2] La Conserve Alimentaire – juin 1808 – p. 90.
Très tôt pour pallier le manque de couleur et donner belle allure au petit pois, les conserveurs se mirent à faire des petits pois à l’anglaise ou pois reverdis. Le principe consiste, après avoir blanchi les petits pois à ajouter du sulfate de cuivre, puis à égoutter les petits pois et à les rincer sous le robinet à l’eau fraîche. Le petit pois sort reverdi et raffermi.
L’emploi du sulfate de cuivre fut interdit en 1860, ce qui n’empêcha pas les conserveurs de continuer à l’employer. En 1880, le Ministre de l’Agriculture rappelle cette interdiction en signalant que d’autres procédés ont été trouvés. En 1881 le Préfet de Nantes reçoit une lettre de la Préfecture de Police signalant que “parmi les échantillons déposés au laboratoire de chimie établi à la Préfecture de Police, certains de ces produits reconnus comme contenant du sulfate de cuivre ont été déclarés provenir de la Maison AMIEUX frères à Nantes”[1]. Par la suite l’interdiction des sels de cuivre sera levée en France mais sera maintenue dans d’autres pays comme les Etats-Unis, ce qui obligera de toutes façons les conserveurs à rechercher d’autres moyens. Ils utilisèrent entre autres le jus d’épinards pour redonner la couleur verte et au-delà tous les moyens permettant d’utiliser la coloration par la chlorophylle. Le petit pois ainsi reverdi était présenté dans les restaurants parisiens comme des “petits pois frais d’Afrique”.
A partir des années 1880, la production des conserves de petits pois va subir une mutation qui nous oblige à revenir loin en arrière dans l’histoire. En 1681 parait à Londres un ouvrage ayant pour titre The New Digester et dont l’auteur est un français, Denis PAPIN. L’ouvrage est traduit en français et publié sous le titre : “La manière d’amollir les os et de faire cuire toutes sortes de viandes en fort peu de temps et à peu de frais, avec une description de la machine dont il faut se servir pour cet effet, ses propriétés et ses usages, confirmés par plusieurs expériences, nouvellement inventée par M. PAPIN, docteur en médecine” [2]
1 Archives Municipales – Série 1 M 1559 – Lettre du 3 octobre 1881.
2 Cité dans Louis FIGUIER. Exposition et histoire des principales découvertes scientifiques modernes (5ème édition) – Paris 1858 tome 1 – p. 68.
L’appareil fut connu sous le nom de digesteur ou marmite de PAPIN : “PAPIN commence par donner la description de son digesteur. L’appareil se compose de deux cylindres creux rentrant l’un dans l’autre : le premier à parois métalliques très épaisses, renferme l’eau que l’on doit convertir en vapeur ; le second, plus petit, sert à contenir les viandes. Tout l’appareil est fermé par un épais couvercle métallique s’adaptant parfaitement aux contours du cylindre, auquel il est fixé par des écrous très solides : quand on veut s’en servir, on le place sur un fourneau allumé. La marmite de PAPIN n’est donc qu’une sorte de bain-marie, dans lequel seulement la vapeur renfermée dans un espace clos, ne peut se dégager au dehors. Après avoir donné la description de sa marmite, PAPIN ajoute : “Cette machine est sans doute fort simple et peu sujette à se gâter, mais elle est incommode en ce qu’on ne regarde pas dedans aussi aisément que dans le pot ordinaire, et comme elle fait plus ou moins d’effet, selon que l’eau qui y est se trouve plus ou moins pressée, et aussi que la chaleur est plus ou moins grande, il pourrait arriver quelquefois que vous tireriez vos viandes avant qu’elles fussent cuites, et d’autres fois que vous les laisseriez brûler ; ainsi il a fallu chercher des moyens pour connaître et la quantité de pression qui est dans la machine, et le degré de chaleur.
“Il n’y a qu’à faire un petit tuyau ouvert des deux bouts, et l’ayant soudé sur un trou fait au couvercle, il faut appliquer sur l’ouverture d’en haut de ce tuyau une petite soupape bien exacte et garnie de papier”.
Pour connaître le degré de la pression de la vapeur, PAPIN fermait cette soupape au moyen d’une petite verge de fer qui, fixée par une de ses extrémités à une charnière, portait à l’autre bout, un poids mobile à la manière des romaines. Il avait déterminé la pression nécessaire pour soulever ce poids. “De sorte, ajoute-t-il, que lorsque la soupape laisse échapper quelque chose, je conclue que la pression dans le bain-marie est environ huit fois plus forte que la pression de l’air, puisqu’elle peut soulever, non seulement le poids qui résiste à six pressions mais aussi la verge que j’ai éprouvée qui résiste à deux, et ainsi en augmentant ou en diminuant le poids, ou en le changeant de place, je connais à peu près combien la pression est forte dans la machine”[1-2]. Et Louis FIGUIER, en ce milieu de XIXème siècle porte un jugement négatif sur la cuisine faite dans le digesteur : “Cet appareil, qui a été renouvelé de nos jours sous le nom d’autoclave, est loin cependant d’avoir réalisé les promesses de l’inventeur ; les viandes cuites par de moyen contractent une saveur ammoniacale. Aussi, quoique LEIBNITZ ait dit dans une de ses lettres : “Un de mes amis me mande avoir mangé un pâté de pigeonneaux préparés de la sorte par le digesteur, et qui s’est trouvé excellent”, il est permis de contester l’utilité de ce procédé de cuisine économique” [3].
[1] Denis PAPIN. La manière d’amollir les os… – p. 10.
[2] Louis FIGUIER – Op. cité – p. 69-70.
[3] Idem – p. 68-69.
Les résultats encore peu satisfaisants, du point de vue de la présentation ou des qualités gastronomiques conduisirent à la recherche de nouvelles solutions : “Le fabricant., pour lui et pour sa famille, en pleine récolte n’est jamais tombé dans cette aberration ; lorsque le petit pois était irréprochable, il accommodait au lard, au jambon, au beurre ce qu’il lui fallait pour sa provision d’hiver, le reverdi c’était pour les clients.
“Aussi chacun s’ingéniait pour innover un genre de cuisson inédit ; les imaginations étaient au travail ; tous ou presque tous nos chefs d’usines étant d’anciens chefs de cuisines, les procédés ne manquaient pas ; pas plus que les accommodements. L’un se servit de ses casseroles à ragoût à fond épais, larges et peu profondes pour étuver ses petits pois ; il ajouta, à la cuisson, quelques coeurs de laitues pommées, une poignée de petits oignons nouveaux, un peu de sucre et un peu de sel, suivant les préceptes immuables de la cuisine française ; il mettait au fond de la casserole une petite quantité d’eau qui, en se vaporisant, étuvait le petit pois, concentré qu’il était sous le couvercle hermétiquement fermé. Lorsque laitues et oignons étaient fondus, le petit pois était à point, emboîté tout chaud et soudé de même. Le petit pois conservait son goût de pois frais, sa saveur franche et parfaite de légumes frais ; et comme du laboratoire, la moitié de cette conserve passait dans le garde-manger du patron qui, lui, la faisait déguster à ses amis (en les dénommant conserves ragoûtées indiquant d’un mot qu’elles avaient été faites dans une casserolle à ragoût), cette méthode encore usitée n’a subi que peu de changements.
“A défaut de casserolles à ragoût en cuivre étamé, on adopte les marmites communes en terre à feu ; même les marmites en fonte sont admises à cette fête ; cela allait bien tant que le travail se faisait à feu nu ; lorsque la vapeur a été adoptée, les méthodes se transformèrent.
“Comme les usines étaient outillées pour toutes les conserves de fruits, on fit alors les conserves cuisinées dans les petites bassines à fruits, à basse pression, bien couvertes, elles mijotèrent pendant une heure au moins, attendant la reprise du travail pour être soudées.
“Lorsque la clientèle, chaque année de plus en plus nombreuse, réclama le petit pois cuisiné, il suffit alors d’appliquer, en grand, toutes ces petites méthodes ; de là vint dans chaque usine une manière particulière de fabrication, le résultat étant le même : la suppression du blanchiment ; mais le savoir-faire donna un cachet spécial à toutes les maisons qui, les unes continuaient la cuisson en petites bassines, les autres en vase-clos, à même l’autoclave, et sous pression ; d’autres encore utilisèrent le four servant à la cuisson des tripes ou pâtés, en remplissant de petits pois les terrines à tripes hermétiquement closes et firent ainsi une excellente conserve.
“Il se dégage cependant une instructive déduction de l’essai de tous ces procédés dûs au génie inventif et débrouillard de nos chefs d’usines : c’est que les excellentes qualités de nos petits pois se conservent entièrement, que les qualités secondaires gagnent beaucoup à cette cuisson ainsi que les qualités inférieures provenant non des sortes de pois mais de la nature des terrains et du climat…”[1].
Ce texte est un témoignage important sur l’évolution du traitement des petits pois dans les conserveries. Le rôle joué par les conserves destinées à la famille du conserveur dans l’évolution du produit est important [2] à souligner, d’autant plus que, jusqu’à la première guerre mondiale au moins, les conserveurs déterminaient le choix des produits en fonction de leur propre goût et non de celui des clients. Très souvent, les repas entre familles de conserveurs étaient l’occasion de faire déguster leur produits nouveaux ou leurs produits millésimés.
[1] La Conserve Alimentaire. Mai 1904 – p. 257-58.
[2] Au moins deux témoignages que nous avons collectés par entretien vont dans le même sens.
Notons en second lieu comment le savoir-faire et l’innovation consistent, sur la base de connaissances culinaires, à faire “avec les moyens du bord”, ce qui est source de variété dans le produit mais qui ne peut dépasser le stade semi-artisanal. Les connaissances culinaires sont détenues par les “chefs d’usines” qui ne sont pas nécessairement des conserveurs, mais plutôt des chefs de fabrication ou des contremaîtres, promus au rôle de gérants, en ce début de XXème siècle.
Quelque soient les solutions décrites dans le texte, tous les proceeds concourent à remplacer le blanchiment des légumes et leur cuisson-stérilisation dans l’eau, à avoir recours à une cuisson dans leur propre jus sans pour autant se heurter aux difficultés rencontrées par APPERT. L’industrialisation des proceeds conduit à réfléchir à l’utilisation de la vapeur. Du point de vue de la technique culinaire, c’est la transposition des principes de la cuisine à l’étouffée. C’est une maison bordelaise, RODEL, qui lance vers 1884, les petits pois à l’étuvée. Le terme lui-même renvoie à l’utilisation de la vapeur, au recours à l’étuve humide.
On peut saisir cette mutation à travers l’entreprise SAUPIQUET. Lorsqu’en 1877, Arsène SAUPIQUET demande l’autorisation d’ouvrir une conserverie rue de Crucy à Nantes, il ne mentionne comme outillage que deux chaudières en fer pour l’ébullition des boîtes et quelques bassines en cuivre pour la cuisson des légumes. En 1892, SAUPIQUET, devenue société anonyme, demande à s’installer dans de nouveaux locaux, boulevard Sebastopol, et mentionne cette fois des écosseuses mécaniques, des cribles, des bassines de blanchissage et de refroidissement, des tables d’emboîtage et des machines à sertir, des autoclaves, une machine à vapeur et sa chaudière ainsi qu’une cuisinière [1].
[1] Archives Départementales – Série 1 M 1559.
Toutes les entreprises de l’époque n’ont toutefois pas ce modernisme. Certaines en sont encore à l’écossage à la main. D’autres ont recours à l’écosseuse mais leurs moyens de cuisson restent encore les bassines en cuivre, voir même le bain-marie.
Un premier texte nous donne une description de ce qui peut être fait dans une entreprise qui utilise écosseuse, crible, sertisseuse et autoclave (éléments de modernisme) combinés aux bassines basculantes pour obtenir la meilleure préparation des petits pois selon les formules anciennes : “La base de la formule est la suivante : “Il n’y a rien à y changer” sauf que le doigté, l’expérience du cuiseur devra doser d’après son jugement, la quantité de grains de petits pois à mettre dans le jus. C’est donc une affaire de métier, un tour de main, et, pour cela, les bassines basculantes sont seules pratiques.
“Dans une bassine de 125 litres de capacité, mettez 60 litres d’eau, 1 kg 500 d’oignons épluchés et coupés en quatre ; deux grosses laitues pommées et fendues ; une main de persil frais ; un gros bouquet de sariettes fraîches (tous ces légumes doivent être mis dans un sac de mousseline) ; 2 kg 500 de sel ; 1 kg 800 de sucre ; faites partir en ebullition, écumez, donnez vingt minutes de cuisson (mais doucement) ; pesez alors 30, 35 ou 40 kilos de petits pois ; vous jugerez dès la première opération, quelle quantité de jus pourra absorber la variété de pois que vous employez ; ouvrez alors la vapeur en grand et versez les petits pois ; l’ébullition ne doit pas s’interrompre pendant ce versement.
“Comptez alors 10 minutes, puis basculez le tout, pois, sac et jus, dans un baquet de bois blanc, spécial à ce service et d’une exquise propreté. Le baquet doit avoir un couvercle qui s’y ajuste très bien ; sitôt le baquet plein, couvrez le et laissez infuser 45 minutes. Retirez alors le sac de légumes et procéder à l’emboîtage au moyen de cuillers à pot, jaugées et contenant juste 420 grammes ; il reste donc 80 grammes pour le métal. En emboîtant à la louche, pois et jus, vous devez trouver une masse bien équilibrée, en jus et en pois. C’est cette première opération qui vous guidera pour les quantités suivantes : les boîtes 4/4 [1] doivent être remplies avec deux cuillers, ce qui fera 840 grammes ; restera 150 à 160 grammes pour le fer-blanc…
“Dès que l’emboîtage est fait, les boîtes toutes chaudes passent rapidement sous la sertisseuse et à la stérilisation ; les pois du matin passeront à l’autoclave pour les 4/4, 35 mn à 112°, le soir 40 mn. Pour les 1/2 le matin 25 mn à 112°, le soir 30 minutes.
“Avec une série de 5 à 6 bassines basculantes de 125 litres, la fabrication tient tête à l’écosseuse et les 10 à 12.000 kilos de petits pois sont rapidement expédiés. L’usine, comme tous les appareils, doivent être lavés par des jets de vapeur dans tous les coins, et de l’eau fraîche à profusion ; il faut faire une guerre acharnée aux ferments qui pullulent de suite.
“Il y a bien des tours de main à mettre en fonction, suivant les natures et les variétés de petits pois, le manque de coloration, les teintes grises, la destruction de la chlorophylle par la cuisson ; l’épaisseur de Pépiderme et sa résistance…” [2].
[1] Dites de 1 kg dans le langage courant du consommateur.
[2] La Conserve Alimentaire – Janvier 1913 – p. 200-201.
Cette description de la fabrication des pois cuisinés est tout à fait caractéristique du discours entre professionnels, tantôt extrêmement précis dans son information, tantôt évasif parce que reposant sur un ensemble de connaissances déjà détenues et qu’il n’est pas nécessaire de répéter ; mais aussi de connaissances informelles partagées par l’ensemble de la profession.
La plupart des descriptions sont faites pour le traitement des pois de calibre fin ou extra-fin. Mais “pour les moyens, ainsi que les gros vous ajouterez dans le jus, pendant la cuisson, 20 grammes de bicarbonate de soude, afin qu’après quelques mois de boîtes, l’épiderme du grain soit presque éliminé”[1].
Enfin “les gros pois, hors crible qui à de certains jours représentent une grosse part de la fabrication, sont souvent, presque toujours, vu le peu de valeur du produit, plus ou moins bien cuisinés ; c’est un tort : aujourd’hui il faut utiliser même les déchets. Nous avons vu que, dans la préparation du jus, une notable quantité de laitues et d’oignons y étaient employés en les mettant à cuire dans un carré de mousseline ; vous pouvez les retirer presque entiers, c’est avec quelques soins, une garniture toute trouvée pour les gros pois cuisinés aux laitues, au lard, aux couennes, au confit d’oies et au mouton, au prix des denrées.
Tout cela n’augmente pas le prix de la boîte dépréciée par la qualité ; elle ne reprend un peu de valeur que par l’accommodement et les cous et poitrines de mouton, les confits d’oies d’arrière-saison, tout est utilisé”[2].
La cuisson à l’étuvée va conduire dans un premier temps à bricoler le matériel existant. Ainsi on adapte une cloche sur une bassine à blanchir (voir dessin). On y introduit des paniers perforés pouvant servir à la cuisson des légumes et des tomates. Ces paniers empilés reposent sur un panier cuvette permettant de récupérer le jus de cuisson ; “cette transformation peu coûteuse devrait, dorénavant exister sur toutes les bassines destinées à la fabrication des conserves alimentaires” [3]. Ce bricolage ouvre la voie à la construction d’appareils adaptés.
[1] Idem – p. 200.
[2] Idem – p. 201.
[3] La Conserve Alimentaire – Avril 1904 – p. 247.
Parmi ces appareils l’un d’entre eux ne fait que reproduire le principe du digesteur de PAPIN, et tente d’éliminer le goût produit par la vapeur :
“La vapeur a parfois un goût spécial. C’est toujours de l’eau qui a bouilli longtemps et s’est modifiée sous le contact immédiat d’un métal ; le mieux est de préparer les Pois sans addition d’eau, de les faire cuire dans leur propre jus, nouvelle manière qui se fait vite, simplement par la double autoclave, à vapeur ou à feu nu, de G. TALBOT à Lormont.
“Le moyen est à la portée de tout le monde mais il fallait y penser.
“Figurez-vous deux autoclaves dont l’une est dans l’autre, avec un couvercle qui est commun aux deux ; ainsi disposées, la plus grande, celle de l’extérieur, peut être en fer quand celle intérieure doit être en cuivre étamé ou non étamé. Dans celle-ci on met les légumes à cuire, même les viandes ; dans celle en fer, on met l’eau de la vapeur. Chauffée, cette autoclave communique sa température à celle intérieure : on cuit ainsi à la pression que l’on veut… ce n’est en résumé qu’une casserole qui cuit sous pression.
“Les pois sont ainsi sans autre jus que celui qu’ils ont fourni ; s’ils sont très tendres, il est relativement abondant, s’ils sont un peu durs il y en a peu et dans ce cas on peut ajouter la quantité d’eau que l’on croit nécessaire. Les viandes, les légumes traités par cet appareil n’ont rien de commun avec ceux que l’on prépare ordinairement…
“L’expérience ayant fait la preuve que les premières émanations de la cuisson n’étaient pas bonnes à concentrer [1], on a mis au centre du couvercle, un bouchon métallique que l’on laisse ouvert au début de l’opération et que l’on ferme aussitôt que l’odorat a indiqué qu’elles n’existent plus” [2].
[1] C’est ce qu’on appelle à l’époque le “goût du terroir”.
[2] la Conserve Alimentaire – Février 1906 – p. 22.
Une nouvelle explication “technique”, cette fois de la fabrication des petits pois à l’étuvée, nous montre une entreprise qui ne s’est pas encore équipée d’une écosseuse, mais qui par contre possède l’un des appareils à étuver :
“Choisissez toujours le petit pois très frais et le moins mûr : toutes parties de pois ayant des cosses jaunes et flétries a perdu sa valeur.
“Ecossez rapidement et avec de nombreuses petites mains ; que le grain retiré de la cosse soit de suite mis dans une sébille, à portée de la main de l’éplucheuse. Criblez au fur et à mesure avec un crible-aspirateur nouveau système qui nettoie très bien le petit pois.
“Rangez les petits pois dans les compartiments perforés construits pour servir de cuiseurs dans les autoclaves ou dans les bassines à cloche. Chauffez et concentrez toute la vapeur fournie par l’eau bouillante. Le petit pois doit être poché et non blanchi par la vapeur saturée ; cette cuisson est plus ou moins longue selon la qualité du petit pois ou la perfection de l’outillage. Si cette opération se fait dans une autoclave où la pression peut être obtenue, Montez rapidement à 115° pendant quelques minutes ; une seule opération vous en indiquera la durée. Vous serez fixé alors sur la qualité du petit pois et travaillerez à coup sûr, augmentant ou diminuant de quelques minutes la cuisson. Le petit pois étuvé à 115° est stérilisé, il est inutile de le stériliser une fois emboîté à haute pression, 35 mn à 106 degrés est suffisant.
“Le petit pois atteint et cuit, sitôt que possible, versez les compartiments dans de grandes terrines vernies ou des bassines en cuivre étamé, et arrosez tout ce petit pois ridé par la vapeur avec quelques litres de jus bouillant [1] dans lequel vous aurez ajouté le jus même provenant de la cuisson du pois et qui a été recueilli, pendant l’opération, dans la cuvette formant le premier compartiment. Sitôt les petits pois arrosés, couvrez-les pour en concentrer la chaleur.
“Lorsque vos terrines de petit pois auront repris leur forme naturelle, emboîtez alors, sans jamais vous servir d’une cuiller de fer mais de bois ou de cuivre étamé. Supprimez tout ustensile émaillé, c’est dangereux. Remplissez bien les boîtes, posez sur le dessus [2] petits oignons blanchis, un quart de laitue si c’est demandé. Finissez si le petit pois est encore sec avec quelques gouttes de bon jus bouillant ; ces petits pois à l’étuvée ne doivent pas être dans un bain de jus puisque ce jus fait partie intégrante de la conserve et ne doit pas être retiré. C’est donc le jus même du pois, son essence dont vous devez l’envelopper. Faites alors souder et passez à l’autoclave. Pour les 1/2, 35 mn à 106° ; pour les 4/4, 35 mn à 112° ; pour les flacons d’un litre ou d’un demilitre, 1H1/2 à 1000” [2].
[1] Le jus est fabriqué avec les mêmes ingrédients (légumes, herbes, sel, sucre, etc..) que pour les petits pois cuisinés.
[2] La Conserve Alimentaire – Juin 1904 – p. 276-277.
Le recours à la cuisson à l’étuvée permet la réutilisation des flacons en verre qui ne pouvaient se concilier avec les hautes pressions de l’autoclave. On peut mesurer en même temps le gain de temps que l’autoclave avait apporté dans la fabrication des conserves.
L’industrialisation ultérieure des conserves de pois conduira à privilégier un temps de cuisson à la vapeur qui peut être commun aux petits pois au naturel et aux petits pois à l’étuvée, la différence dépendra ensuite du type de jus qui sera incorporé pour faire gonfler les petits pois et remplir les boîtes (saumure pour les pois au naturel et jus décrit plus haut pour les pois à l’étuvée).
La période de l’entre deux guerres, dans les conserveries comme dans les autres industries est caractérisée par la recherche de solutions permettant de faire disparaître les discontinuités dans la production. Pour les petits pois une solution originale est utilisée : assurer le travail mécanique des pois dans des installations en cascades qui, selon l’expression de l’époque “assure l’automatisme pour ainsi dire complet de la fabrication et sa grande rapidité, condition nécessaire pour l’obtention de bons produits avec une utilisation aussi grande que possible des locaux industriels”[1]. Les petits pois sont déchargés à l’étage supérieur de l’atelier d’écossage mécanique. Les ouvriers les envoient dans la machine à écosser en les jetant dans les trémies. Les pois arrivent dans la partie supérieure de la machine à écosser ; celle-ci est constituée essentiellement par un cylindre percé de trous, à l’intérieur desquels se meuvent des palettes. Les gousses sont à la fois roulées et pressées ; les grains se détachent et tombent dans des trémies, qui les conduisent, à l’étage du dessous (salle de criblage), dans des trieurs mécaniques (cribles) où ils sont triés par grosseur (calibre). Ils descendent ensuite par des goulottes dans la salle de cuisson pour le blanchiment où la cuisson à l’étuvée, puis arrivent au rez-de-chaussée où s’exécute l’emboîtage et la stérilisation. Tout le mécanisme de continuité est fondé sur la gravitation.
[1] Encyclopédie illustrée des grandes inventions modernes. Paris Union Latine d’Editions – 3 volumes s. d. Voir aussi Le Monde et la Science n° 17. Les Grandes Publications Mensuelles Illustrées. Paris- Librairie A. GARRIGUES s. d.
III. UNE USINE EN 1960
En 1960, la Maison AMI EUX décrit la fabrication des petits pois dans son usine de Chantenay :
“Nous voici dans la grande cour de l’usine de Chantenay… Une camionnette bâchée vient d’arriver avec son chargement : elle se range devant la grande porte de droite, juste auprès des chaînes de machines réservées aux petits pois. Et tout de suite les manoeuvres s’affairent pour le transport des caisses en bois pendant que le réceptionnaire contrôle le chargement : grâce aux cartons de couleur fixés sur les caisses, il sait quelle est leur origine.
“Mon oncle,… il allait lui avec les chauffeurs. Il y avait plusieurs camions qui faisaient la navette forcément pour approvisionner l’usine. Ils allaient comme ça dans la nuit pour après revenir le matin pour qu’on ait du travail en arrivant”[1].
[1] Entretien avec une ancienne contremaîtresse de chez AMIEUX.
“Chaque caisse pleine est Immédiatement vidée dans un sasseur automatique où le petit pois subit un premier triage : il est séparé des gousses restantes et des “piochons”, c’est à dire des gousses non formées.
(Les hommes de la cour)… Ils déchargeaient les pois qui arrivaient dans des caisses et puis ils les empilaient dans la cour et après c’était mis sur palette et c’était rentré à l’intérieur de l’usine pour faire le travail qu’il y avait à faire dessus. Après c’était passé au tri… des trémies, et tout ça se trouvait au premier étage. C’était les hommes qui s’occupaient de cette manutention là.
Mais ils avaient besoin de femmes. Quelquefois ils pouvaient nous appeler pour faire marcher. On appuyait sur des boutons pour mettre en route les trémies et tout ça… Les hommes ils étaient bien une dizaine qui étaient là et qui pouvaient faire autre chose aussi.
Question : Ce n’était pas que des saisonniers ?
– Ah non, il y avait aussi des titulaires, mais on a travaillé pas mal à ce moment-là… C’était la grande période que dans la cour ils embauchaient les arabes. Il y a eu beaucoup d’arabes à travailler comme saisonniers et quand ils avaient plus besoin d’eux, eh bien ils les… Ils déchargaient les camions. Ils venaient en temps de presse nous alimenter, porter nos caisses, porter nos paniers pour qu’on ait un rendement encore plus… qu’on n’ait pas à se déplacer, pour qu’on aille plus vite [1].
[1]. Entretien ancienne ouvrière AMIEUX.
“Désormais il est pris en charge par les machines et marche inéluctablement vers sa “mise en boîte”. Trois opérations essentielles vont alors s’effectuer : le lavage, le criblage et la cuisson.
“A la sortie du sasseur, il est élevé par une chaîne à godets vers les ventilateurs : un préventilateur agit à sec pour faire voler les petites feuilles parasites, puis d’énormes ventilateurs à tamis trembleurs achèvent le travail. Alors le légume est déversé dans une cuve à eau où il subit un premier lavage. Une mousse blanchâtre déborde et se répand sur le sol humide avec les mauvaises graines qui surnagent. De cette première cuve, le petit pois est entraîné par une pompe dans les cylindres de décantation, dans les laveurs épierreurs qui retiennent les petits cailloux indésirables. A travers un grand cylindre laveur et de circuits en chicanes appelés échelles de Jacob, le petit pois est ensuite entraîné vers une deuxième cuve à eau et de là, il est pompé vers le second étage de l’usine. Une cheminée centrale qui aboutit à un bac d’expansion le répand dans deux gouttières latérales. Un tuyau de descente achève les opérations de lavage en déversant le petit pois au premier étage où vont s’effectuer le criblage et la cuisson. Un séparateur d’eau permet de récupérer le liquide en circuit fermé tandis que le petit pois, humide encore, se dirige vers les cribles.
“La chambre des cribles est vraiment impressionnante. Elle donne directement sur la grande terrasse du premier étage constamment ouverte à l’air libre. Quatre immenses cylindres évasés tournent ici sur leur axe horizontal d’un mouvement régulier. Ils sont tapissés de toile criblée et groupés par deux, l’un en haut, l’autre en bas. L’évasement du crible permet aux petits pois de rouler à l’intérieur du cylindre selon la ligne génératrice et de passer à travers les trous des cribles de grosseurs variables. C’est là que se fait le tri définitif : pois extrafins, très fins, fins, mi-fins, moyens n°1, moyens n°2. Chaque catégorie est prise en charge par un tapis roulant, sauf celle des extra-fins qui est recueilli dans les caisses et traitée ensuite à la main.
On les récupère dans les caisses qui sont là en-dessous… On n’était pas enchantées quand on arrivait dans la salle des cribles parce que là alors il fallait se baisser pour tirer cette caisse-là et en mettre une autre. Il y avait une dame qui poussait [1].
[1]. Entretien cité.
“A partir de là tous les récipients, chaînes ou machines sont munis d’une plaque marquée de la couleur correspondant à la qualité : le bleu pour les extra-fins, le blanc pour les très fins, le rouge pour les fins, le vert pour les mi-fins et le jaune pour les moyens.
“Naturellement toutes ces opérations sont étroitement surveillées par une main-d’oeuvre féminine attentive qui intervient à tous les stades du lavage et du triage en cas d’irrégularité. Des hommes compétents surveillent le fonctionnement des machines et des contrôles graphiques sont transmis au laboratoire.
“Avant de passer à la cuisson les extra-fins sont encore triés à la main, sur tapis.
(Dans les cribles) . Les extra-fins, ça tombe les premiers, c’est là qu`il y a les plus de saletés [1].
Il fallait enlever tous les grains qui étaient mauvais, toutes les petites saloperies. Alors on 25 ou 30 devant les tapis en trains de trier les petits pois [2].
[1] Entretien contremaîtresse déjà cité.
[2] Entretien ancienne sertisseuse C.G.T.
“Ils sont cuits dans des bassines spéciales (100 degrés pendant 6 à 7 minutes) et transportés en paniers à trous vers la chaîne d’emboîtage. Au moment du remplissage à la main, chaque boîte de conserve est pesée sur une petite balance Toledo.
“Les autres variétés sont rassemblées dans des trémies et déversées par catégories dans d’énormes cuiseurs cylindriques de deux tonnes à deux tonnes et demie. La salle des cuiseurs est attenante à celle des cribles. Des galleries surélevées permettent de surveiller les cylindres pleins fixés au plafond et qui répandent une chaleur d’étuve. Il y en a trois qui fonctionnent simultanément sans arrêt en pleine saison. Chaque cuiseur rempli à moitié d’eau, porté à cent degrés est muni à l’intérieur d’une vis sans fin. Le temps de cuisson ou de blanchiment varie selon le calibre et la qualité des pois ; il est scrupuleusement surveillé. Il dure de cinq à huit minutes…
“(Le petit pois) est soit séparé à chaud de son eau et conduit par un tapis aux trémies qui le déverseront à l’étage inférieur dans les boîtes toutes préparées, soit refroidi préalablement dans un labyrinthe d’eau fraîche.
“De toute façon, il descend directement dans les boîtes vides qui l’attendent à l’étage inférieur. D’où viennent donc les boîtes vides ? Elles sont stockées dans un immense grenier au troisième étage de l’usine avec les boîtes en carton.
Au 2ème étage c’était le stockage des boîtes vides et qui arrivaient à ce moment-là par camions, qu’on allait, même nous, décharger… Quand un camion arrivait et qu’ils manquaient d’hommes ou qu’il fallait que ce soit fait rapidement, que les hommes étaient pris à la cour, on allait décharger ces camions là. Ca arrivait par pochons, ça arrivait par cartons et on faisait notre stockage nous même chez AMIEUX… Il y avait des monte-charges ou alors vous savez un tapis. On aimait beaucoup aller faire ça. C’était notre plaisir parce qu’on travaillait à l’air. On prenait les paquets à deux… On était deux femmes…
C’était pas très lourd. Le camionneur nous attendait. Il nous faisait décharger son camion. Ca venait de chez CARNAUD, hein. Et puis quand le camion était déchargé, on retournait à notre poste où on était avant et puis lui partait avec son camion… Des fois il pouvait arriver deux ou trois camions dans la journée.
On avait peut-être des chances de retourner. C’était la récréation ça… (la contremaîtresse)…, supposons que j’étais en bas à travailler sur un tapis, on lui amenait un bon disant : il y a un camion de boîtes à décharger. Bon, ben elle prenait six filles…, elle arrêtait les six filles du tapis. Elle disait : bon, ben je vous arrête vous… elle riait, elle riait quand elle nous disait ça parce qu’elle savait bien que c’était un peu la récréation… On était contente [1].
[1] Ancienne ouvrière de chez AMIEUX.
“Là est maintenue une température et un degré hygrométrique constant. On évite ainsi rouille, moisissure ou déformation des matériaux. Une sorte de rail à rampe descend dans les étages inférieurs au niveau du tapis roulant et sert de glissière aux boîtes qui se meuvent par leur propre poids et s’entrechoquent dans un but sec et métallique, signe d’une activité fébrile…
Cette glissière qui descendait du 4ème étage avec des boîtes, ça faisait un bruit, un bruit… On l’entendait de la rue. C’était infernal. Alors qu’ils auraient pu mettre du caoutchouc ou quelque chose [1].
“Deux préparations sont prévues : le petit pois au naturel est arose d’une saumure concentrée à 2%, préparée dans des bassines et déversée au moyen d’une cuiller à plusieurs becs appelée “goguenot” I La deuxième préparation est la plus compliquée, c’est le pois “à l’étouffée” qui reçoit un jus spécial, longuement préparé avec du sucre raffiné, divers légumes et une décoction aromatique de sarriette fraîche et de thym. Ce jus est amené au-dessus de la boîte par un tuyau à robinets et poussé par une pompe spéciale. Par ailleurs, les ouvrières présentes de chaque côté de la chaîne, introduisent dans chaque boîte un morceau d’oignon blanc et une feuille de salade blanchie à la marmite. Le travail soigné et précis est remarquablement exécuté par des mains expertes.
Il y avait un chef cuisinier qui d’en bas mijotait le jus pour mettre sur les petits pois avec des oignons tout ça. C’était du vrai jus et alors il mettait un acide pour les garder verts qui donnait des eczémas terribles aux mains et aux pieds, parce que le jus tombait sur les pieds. On était trempé du matin au soir. Le tapis circulait et puis après ça tombait dans les boîtes. Les boîtes, si ells avaient pas leur ration de jus, il fallait remettre du jus ; alors à la Vitesse que ça passait, on regardait pas à une goutte près et ça coulait partout [2].
[1] Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX C.G.T.
[2] Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX C.G.T.
“Voilà donc notre boîte remplie de petits pois ; toujours mue par un tapis roulant, elle se dirige vers une petite étuve qu’elle traverse en meanders savants et où elle est “préchauffée”.
“Le but de l’opération est de chasser l’air avant la fermeture de la boîte et d’obtenir une préstérilisation intérieure. La boîte se dirige ensuite vers la machine sertisseuse qui procède à la codification et à la fermeture, à raison de 3.600 pièces à l’heure.
Il y avait encore une grande partie qui se faisait manuellement, au pied quoi. Vous travailliez au pied pour la commande de la machine. C’était très très dur… On est debout. Fallait toujours appuyer avec cette jambe sur une pédale qui levait et mettait les couvercles. Ca allait très très vite. C’était un nombre impressionnant de boîtes. Nous on prenait la boîte, le couvercle et … la pédale… Moi je sais que quand j’étais à la sertisseuse, que je faisais mes 11 heures devant la machine, on allait chercher des seaux, on se mettait les pieds pendant 2 heures dans les seaux pour pouvoir tenir. Quand vous aviez fait vos 2 heures là, vous alliez à ce qu’on appelait “au panier”. Vous aviez un petit banc devant vous, vous étiez assise et vous envoyiez vos boîtes de conserves pleines dans un panier à trous qui après descendait dans un autoclave… Les boîtes descendaient (de la machine) sur un tapis, il y avait une butée où arrivaient les boîtes et il fallait suivre le rythme de la machine, envoyer les boîtes une par une pour les mettre correctement empilées dans le panier…
Alors vous faisiez ça 2 heures et vous aviez de nouveau 2 heures à la sertisseuse. On tournait comme ça pendant toute la journée… Fallait les ranger les boîtes, fallait un coup de main pour les ranger. Le panier était grand. Vous commenciez par le fond, vous faisiez un rond, les boîtes debout les unes à côté des autres, et puis le rang de dessus décalé. Fallait un coup de main…
Quand on mettait quelqu’un de nouveau là-dessus, j’aime autant vous dire qu’il fallait arrêter la chaîne tout de suite. C’était très dur. C’était très très pénible. Il y avait beaucoup de travail manuel…
On devait être 10 ou 14 sertisseuses, 5 équipes de 2, quelque chose comme ça. Il y avait 5 ou 6 machines qui tournaient ; il y avait 25 ou 30 machines, mais elles ne marchaient pas toutes le même jour… Chaque equipe de 2 avait une remplaçante… Pour tourner à 2 dans chaque équipe, c’est nous qui décidions entre nous…
La sertisseuse automatique, la boîte passait devant, le couvercle se mettait dessus et puis elle se fermait et elle venait sur votre tapis… Vous étiez assise devant votre sertisseuse, et puis vous regardiez vos boîtes, vous surveillez votre machine… Il n’y avait qu’à regarder là. Si le couvercle bloquait dans sa chaîne, il vous fallait arrêter la machine, débloquer.
L’alimentation en couvercles était automatique… A la sertisseuse automatique il fallait qu’on remplisse la goulotte avec les couvercles. Quand notre panier était plein, on le roulait jusqu’à l’autoclave. C’est nous qui faisions ça, celles de la sertisseuse…[1].
1 Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX C.G.T.
“Nous pourrions croire que tout est fini, la boîte une fois fermée. Or il reste à réaliser pour le petit pois, ce que l’on réalise pour toutes les autres conserves : la stérilisation, le stockage, l’étiquetage et l’expédition.
“Pour la stérilisation, les boîtes une fois sorties sont rangées dans des paniers, sorte de grands cylindres en métal troués et ouverts par en haut. Le panier une fois rempli est conduit près de la salle des autoclaves, sur un chariot ou un plateau. Il est déposé dans l’autoclave, par une grue maniée avec grande précision.
“Voici comment se présente la salle des autoclaves : imaginez une galerie circulaire à laquelle on accède par des escaliers métalliques. Au centre s’élève la grue, tout autour, les autoclaves cylindriques avec leur tuyaux de chaufferie. La salle se trouve à proximité de la sortie de l’usine près d’une autre salle “à courant d’air” où aura lieu le refroidissement en cuve et le séchage rapide. Pour les pois, la stérilisation est faite à 115° et dure 35 minutes ; mais en tenant compte des temps de compression et décompression, le séjour en autoclave est d’une heure environ. Chaque opération est contrôlée automatiquement par un appareil enregistreur relié à chaque autoclave. Un graphique circulaire permet de lire le temps de chauffage et de le vérifier le lendemain au laboratoire.
Moi je sais que c’est moi qui changeait les graphiques. Il y avait des graphiques qu’il fallait changer le matin, des graphiques pour le temps de cuisson. Il y avait des volontaires qui venaient le matin pour changer les graphiques, une heure avant. C’était comme une minuterie. Il fallait remettre de l’encre dans l’aiguille, changer le papier, le graphique. Alors moi, je faisais ça ; parce qu’on était dans une telle situation financière alors… J’étais pas la seule. Il y avait des gens pauvres” [1].
[1] Entretien ancienne sertisseuse AMIEUX, responsable C.G.T.
“La stérilisation achevée, le panier est porté mécaniquement dans un bac d’eau courante froide et javellisée. Les boîtes brûlantes s’engloutissent dans un bouillonnement bruyant. Si une boîte est abîmée, elle flotte à la surface. La boîte normale dont le couvercle s’était dilaté au réchauffement s’aplatit après refroidissement pour reprendre ensuite sa dilatation.
“Le refroidissement ne doit pas se prolonger plus de 2 à 3 minutes. Ce temps écoulé, le panier est retiré et déposé sur un chariot dans le grand hall de sortie où il sèche au courant d’air en attendant d’être chargé sur le camion de l’annexe. Là-bas, auront lieu le stockage, l’étiquetage et l’expédition.
“C’est à l’annexe de l’usine que les boîtes sont déchargées dans leur panier métallique. Otées une à une, elles sont nettoyées par les femmes.
C’est les femmes qui retiraient les boîtes (du panier de l’autoclave). Il y avait une petite porte. Elle les retiraient à la main et puis toute courbée, la tête dans le panier comme ça. C’était dur à faire ça [2].
[2] Entretien contremaîtresse AMIEUX.
Elles sont ensuite stockées pour trois semaines. Ce qui permet de vérifier leur comportement avant l’étiquetage. Cette dernière opération est également mécanisée : une chaîne tournante entraîne la boîte sur un rail où elle roule sur une étiquette préalablement enduite de colle. Quatre machines fonctionnent ainsi, capables d’étiqueter 2.800 boîtes à l’heure. Un dernier stockage a lieu avant l’expédition. Il se fait dans des boîtes en carton empilées les unes sur les autres dans un ordre impeccable…
“En effet, les boîtes sont entassées “sur palettes”, c’est à dire que les chargements convenables sont supportés par des plateaux en bois à double fond. Entre les deux fonds peut se glisser le support du chariot élévateur électrique. Ainsi, des chargements importants de l’ordre de 800 à 1.000 kilos peuvent être déplacés de haut en bas ou de bas en haut sans déranger l’empilement. Trois équipes d’hommes travaillent au magasin modèle : les approvisionneurs, les emballeurs et les contrôleurs de pesée”[1].
[1] Vendre AMIEUX n° 2-3 – Septembre-décembre 1960.
IV LE JOUR LE PLUS LONG
La période des petits pois est symbolique du travail de la conserverie aussi bien pour l’embauche saisonnière que pour les conditions de travail dures et des journées de travail d’une longueur extravagante : “Quand on voyait preparer le casse-croûte à 9 heures (du soir), on savait que la journée allait être longue”[2.]
[2] Entretien contremaîtresse AMIEUX.
“Je me souviens d’avoir fait des journées longues et même très longues et d’être rentrée un soir – mes parents s’étaient inquiétés parce que je devais terminer ma journée sur les 22 heures. 4 heures du matin, je n’étais pas rentrée et j’étais toujours devant mes petits pois au premier étage, devant mes paniers… Ça pressait : une commande, une commande taillait finir. Alors ils sont venus demander. Tout le monde s’inquiétait. Il n’y avait pas que ma famille. Il y avait plein de familles dehors à nous attendre. Tous les gens s’inquiétaient parce qu’on ne nous prévenait pas. On nous disait dans la journée : ce soir ce sera très très tard.
“J’ai même vu une contremaîtresse un jour, elle a couru comme ça après une bande de filles, – j’étais dans la bande -, pour essayer de nous rattraper : ne partez pas, ne partez pas, ne me laissez pas comme ça, il y a tellement de travail. C’était au moment des petits pois, ça.
Question : Parce qu’au dernier moment un camion arrivait ?
“- Voilà… Au dernier moment il fallait qu’il soit déchargé et cuit et tout parce que tout ça, c’est compté comme denrée périssable. On pouvait pas nous, dans la branche où on était, l’alimentation, conserver tous ces produits-là. Fallait donner un bon coup de collier, de temps en temps… On nous payait en heures supplémentaires… C’était à prendre ou à laisser” [1].
“Les petits pois, je vous dirai que j’ai commencé à 5 heures du matin et j’allais jusqu’à 1 heure du matin, deux heures quelquefois. C’est pas croyable. Je me rappelle qu’une nuit, on attendait encore des boîtes qui étaient dans l’autoclave à ébullitionner. Et il y avait encore M. AMIEUX [2] qui passe. Il était levé et puis venu à l’usine pour voir. Et alors il me dit : c’est encore pas fini ? Je lui dit : non Monsieur parce qu’il y a encore des paniers à l’autoclave et on peut pas les laisser. Vous allez partir, il dit comme ça. Vous laissez le monsieur en bas se débrouiller avec ça (le monsieur en bas qui faisait la cuisson). Alors on était parties… “Je me suis vue un dimanche matin qu’on sortait de l’usine AMIEUX quand les gens sortaient la messe. On avait commencé le samedi comme notre journée commençait d’habitude” [3].
[1] Entretien ouvrière AMIEUX.
[2] II s’agit de M. Maurice AMIEUX, frère de Louis AMIEUX.
[3] Entretien contremaîtresse AMIEUX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Cette nécessité d’urgence de traitement des petits pois est tellement intériorisée qu’elle marque même les conflits sociaux. Ainsi les grèves de juin 1936 coïncidaient avec la saison des petits pois et l’on peut lire dans une note de la Mairie de Nantes en date du 12 juin 1936 : “Reçu le 11 juin une communication téléphonique de la Maison AMIEUX annonçant que son personnel se mettait en grève et occupait l’usine. Un certain stock de petits pois était en préparation et on me disait que ces petits pois seraient perdus si la mise en boîte ne se faisait pas immédiatement. J’ai répondu que je me mettais de suite en relation avec la bourse du travail, pour trouver le remède à cette situation.
“La bourse du travail m’annonçait quelques minutes plus tard que B. partait à l’usine AMIEUX pour engager les ouvriers à opérer cette fabrication pour éviter la perte de quelques centaines de boîtes.
“J’ai prévenu aussitôt la Maison AMIEUX…”[1].
Georges DOUART, à travers un témoignage qu’il collecte en 1965 nous donne une description de ce qu’il appelle “les petits pois de la sueur” : “Je rencontre des gars d’une vieillotte conserverie de la banlieue nantaise, aux produits dispersés aux quatre coins de France et d’Europe : …
“… A cause du temps, de ces denrées périssables, on n’a pas d’horaire. Un jour on fait quinze heures, le lendemain, rien I Ils recrutent des saisonnières, leur disent : venez lundi ; à 10 heures plus de légumes, ils les renvoient chez elles ; à la fin des petits pois, ils les débauchent en masse” [2].
[1] Archives Municipales de Nantes – F7 – Carton 9-5.
[2] Georges DOUART. L’usine et l’homme – Ed. Pion – 1967 – p. 119-120.
V UN CONTRAT DE REMPLISSAGE EN 1912
Un ensemble de documents sur la conserverie ALBERT va nous permettre de mieux saisir le déroulement d’une campagne de petits pois et de la replacer dans l’ensemble de l’activité sur plusieurs années.
Les documents utilisés [3] sont les carnets du conserveur dans lesquels il note au jour le jour :
– l’arrivage des petits pois avec le lieu de provenance, le nom du fournisseur et le prix.
– la main-d’oeuvre en coût et certaines années en effectif.
– les conserves faites avec le type de préparation et la taille des boîtes.
[3] Récupérés dans les locaux de la Conserverie ALBERT – Archives ALBERT
A – Huit ans de campagnes :
A partir de ces différentes données, il est possible de saisir un certain nombre de phénomènes. C’est d’abord la durée de la campagne. Nous entendons ici par campagne, non pas la période de production des petits pois mais la période pendant laquelle le conserveur fabrique des conserves de petits pois. La durée dépend alors de ses possibilités de vente, de stockage, de la quantité et de la qualité des pois disponibles ainsi que de l’étalement du mûrissement.
ALBERT s’industrialise à partir de 1912, ce qui explique le changement de volume traité mais aussi l’allongement de la campagne. En 1912, l’année est mauvaise et son approvisionnement vient dans un premier temps de Nantes, puis lorsque ce sera la saison, de Bretagne. Cette année là, les jours travaillés ne représentent que 32 % de la durée de la campagne. A l’inverse en 1910 et 1911, ils représentent 80 % de la durée de la campagne. Pour les autres années, c’est autour de 50 %.
Seconde caractéristique, les grandes variations de tonnage qui peuvent avoir lieu d’un jour à l’autre.
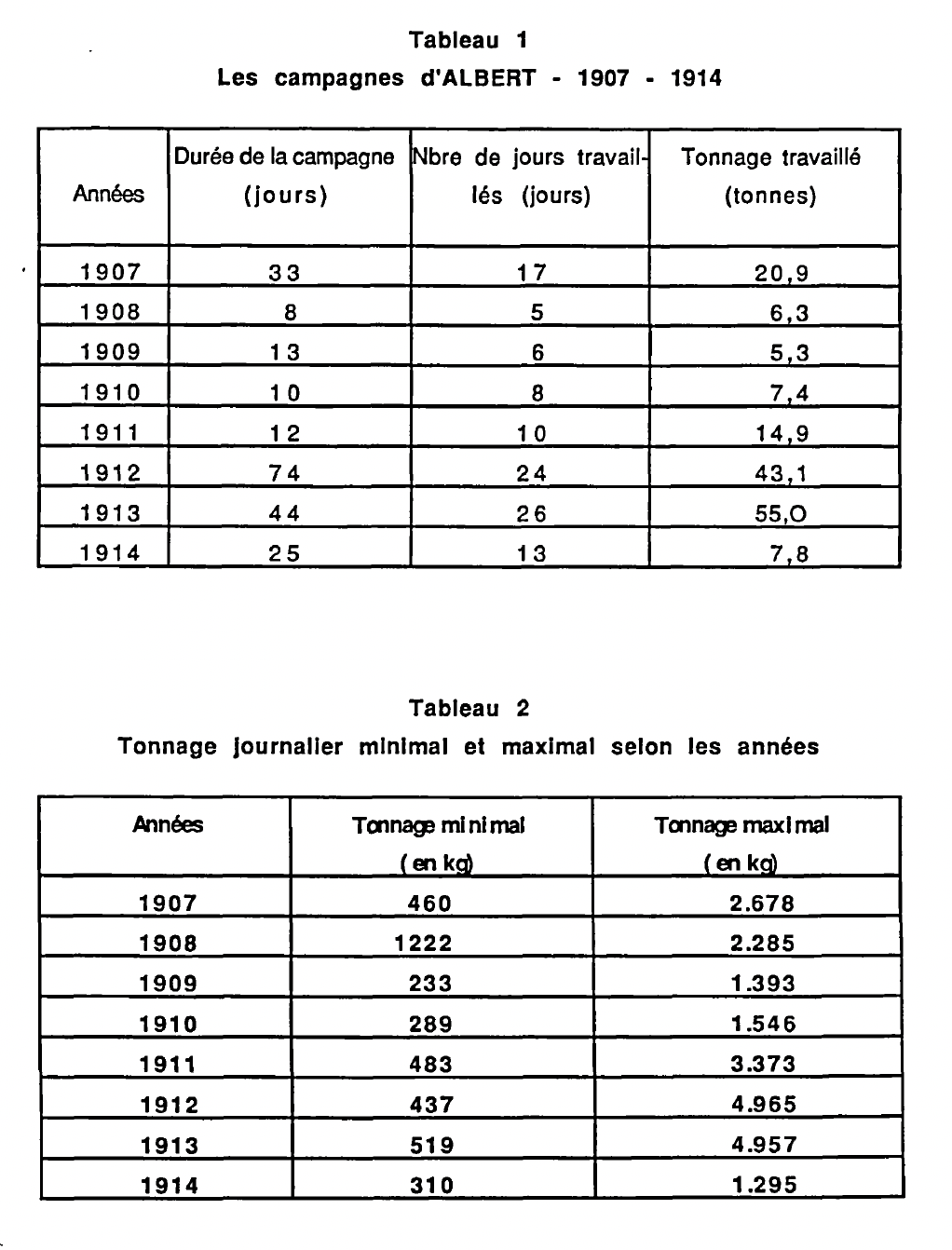
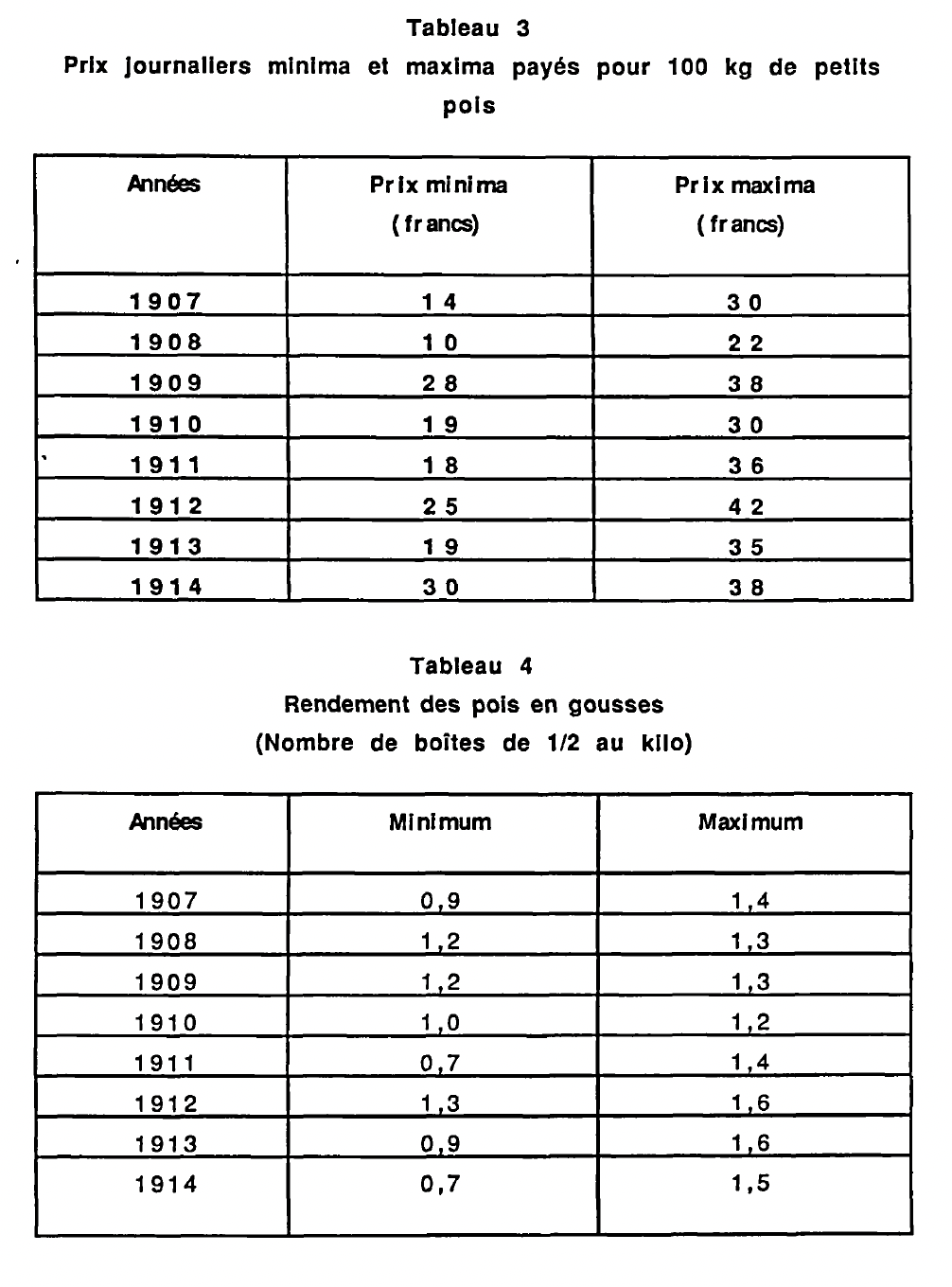
Les amplitudes d’arrivages vont dans cette période d’environ 1 à 2 en 1908 à 1 à 10 en 1912, ce qui pose à la fois le problème de la capacité de traitement et de possibilité de pouvoir à tout moment faire appel à de la maind’oeuvre supplémentaire. Il n’est pas étonnant que face à ces variations, les conserveurs aient cherché à rationaliser la production et les marchés comme nous le verrons plus loin.
Tout autant que le tonnage, ce sont les prix qui varient largement et qui peuvent conduire le conserveur éventuellement à différer ou annuler sa production, à acheter beaucoup certains jours et peu le lendemain.
A part l’année 1912, où ALBERT se sert dans deux régions, les autres variations ont lieu dans la même région, chez les mêmes fournisseurs. Les variations tiennent à la fois à la qualité du pois, à son rendement et à la concurrence.
Nous avons calculé les rendements en prenant comme unité la boîte dite 1/2 et en calculant combien de boîtes sont remplies avec 1 kg de pois en gousses.
On peut noter là encore des variations qui peuvent être importantes et qui tiennent pour une large part aux variations de calibre des petits pois. A une même période le poids de la gousse entre pour une part moins importante lorsque les pois sont plus gros. Mais il faut tenir compte d’un autre facteur. A calibre égal, le pois devenant plus farineux et donc plus dense au fur et à mesure que la saison avance, il “rend” plus dans la mesure où le remplissage de la boîte est fondé sur un certain poids de produit.
On peut comparer ici avec les données publiées par la Conserve Alimentaire pour 1913 : “Le 24 mai, 1 kg pris en cosses a donné 320 grammes de grains et 680 grammes de cosses, qui ont rendu au classement :
10 % en extra-fins – 32 gr.
55 % en fins – 176 gr.
30 % en moyens n°1 – 96 gr.
5 % en gros – 16 gr.
TOTAL 320 gr.
Le dernier jour, le kilo de petits pois écossés a donné 420 grammes de grains, 580 grammes de cosses et le pourcentage au classement de :
5 % en extra-fins – 21 gr.
30 % en fins – 126 gr.
25 % en moyens n° 1 – 105 gr.
40 % en gros – 168 gr.
TOTAL 420 gr. [1]
[1] La Conserve Alimentaire – Septembre 1913 – p. 328.
En janvier de la même année, la même revue signalait que le “goguenot”, c’est à dire la cuiller à pot jaugée pour remplir la 1/2 boîte contient juste 420 grammes, pois et jus compris. Si l’on prend cette référence, le premier échantillon fournira moins d’une boîte au kilo (à moins d’ajouter beaucoup de jus) et second plus d’une boîte. Il faut noter en second lieu l’accroissement de densité des grains (de l’ordre de 30 % pour les extra-fins), de telle sorte que, pour le même poids dans la boîte, la quantité de pois sera moindre, mais les pois se tiendront mieux à la cuisson.
A cette époque, pour se simplifier la tâche, les conserveurs considéraient qu’en moyenne, sur la saison, 1 kg de pois non écossés fournissait 1/2 boîte de conserve, pour le type de pois utilisé dans l’échantillon cité plus haut. Selon les régions, le rapport pouvait varier. La distribution entre les différents calibres influent sur cette répartition. La même année 1913, les petits pois traités chez ALBERT donnent :
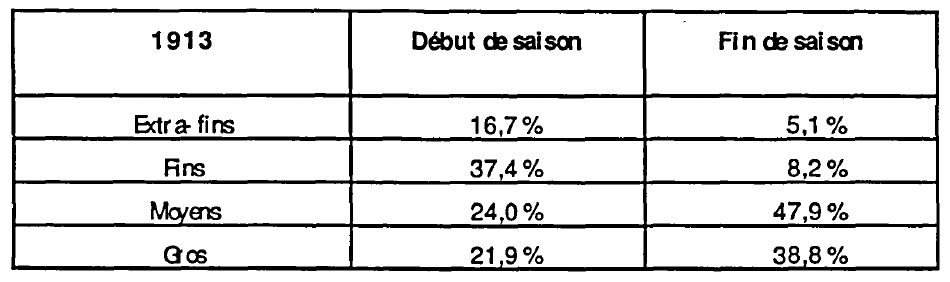
Entre temps les extra-fins ont pu tomber à 3 % et les gros atteindre 70 %. Quoique moins élevées, les variations annuelles restent relativement importantes :
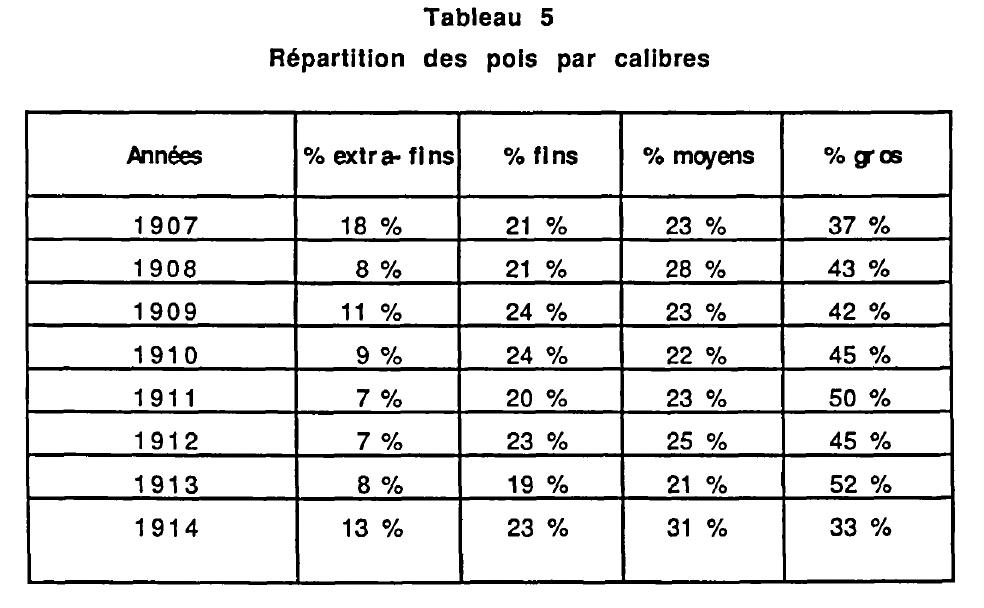
Cette répartition des pois posent des problèmes aux conserveurs.
Ceux qui ont une clientèle de luxe comme la Maison ALBERT (conserveur, traiteur et épicerie fine) ne vendent principalement que des pois fins ou extrafins. Il faut alors écouler le reste de la production ailleurs et ce ne sont pas les collectivités religieuses, clientes de chez ALBERT, qui permettent certaines années d’épuiser le stock.
Dernier paramètre que nous pouvons retenir, le coût de la maind’oeuvre. Nous avons calculé le coût pour 100 kilos de pois traités. A la période de l’écossage à la main, les femmes étaient payées à la mesure de petits pois écossés. Le prix de la mesure variait selon le rendement des gousses. En 1910, ALBERT payait 0,20 franc pour la mesure en primeur, c’est à dire en extra-fins et 0,15 franc en fins. Si l’on compare avec les salaires payés en 1912 avec le recours à la machine à écosser, on peut estimer la mesure de fin à 1 heure de travail (en moyenne). Selon les calibres et l’état des gousses, les coûts salariaux vont varier. De même, en cas d’abondance ou d’embauché tardive, le manque de main-d’oeuvre pourra conduire le conserveur à payer plus cher les femmes embauchées.
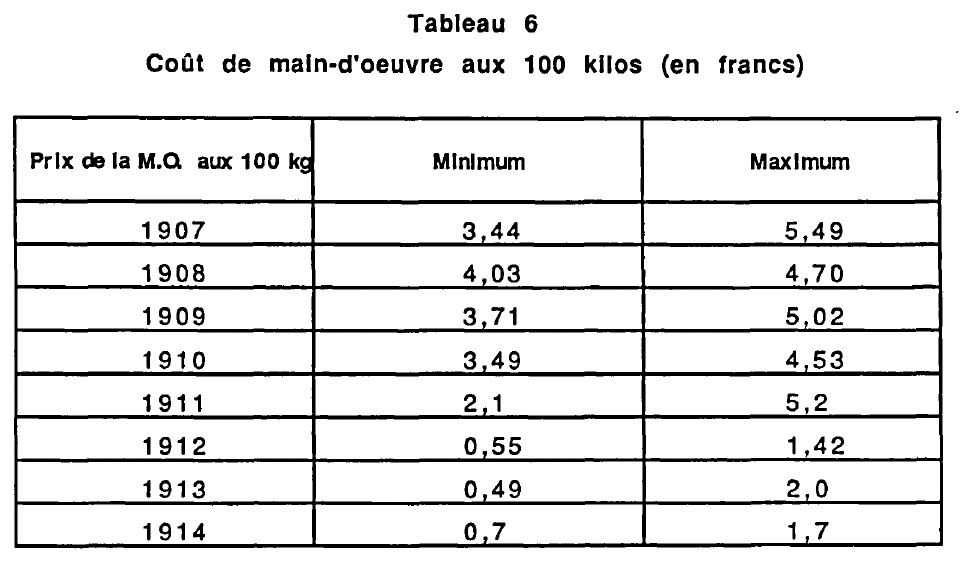
On notera d’abord la chute du coût de main-d’oeuvre avec l’introduction de l’écosseuse en 1912, mais en même temps une amplitude plus grande dans les coûts pouvant aller de 1 à 4, comme en 1913.
A la veille de l’arrivée de l’écosseuse, en 1911, on peut estimer que la part des différents coûts dans le prix de revient de la fabrication d’une boîte de petits pois n’a pas changé depuis 1907.
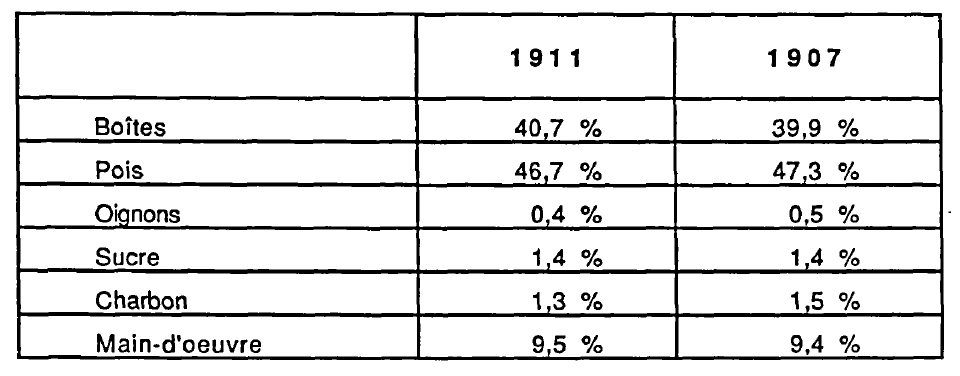
Avec l’arrivée de l’écosseuse, la main-d’oeuvre ne représentera plus que 2 % environ du coût de la boîte. Le taux serait encore plus faible si l’on faisait intervenir l’amortissement des investissements. En 1969, on estime le coût du pois à 35 % du prix de revient de la conserve.
On peut maintenant comparer le prix de vente de la boîte de petits pois (de qualité similaire) au salaire des ouvrières et au prix payé aux producteurs, en 1836-40, en 1913 et aujourd’hui. Nous l’avons estimé pour que cela soit comparable en temps de travail pour les ouvrières et en kilos de petits pois non écossés, pour les agriculteurs (en tenant compte des prix minima et maxima). L’unité de conserve retenue est la boîte 4/4 dites de 1 kilo contenant des pois de qualité supérieure.
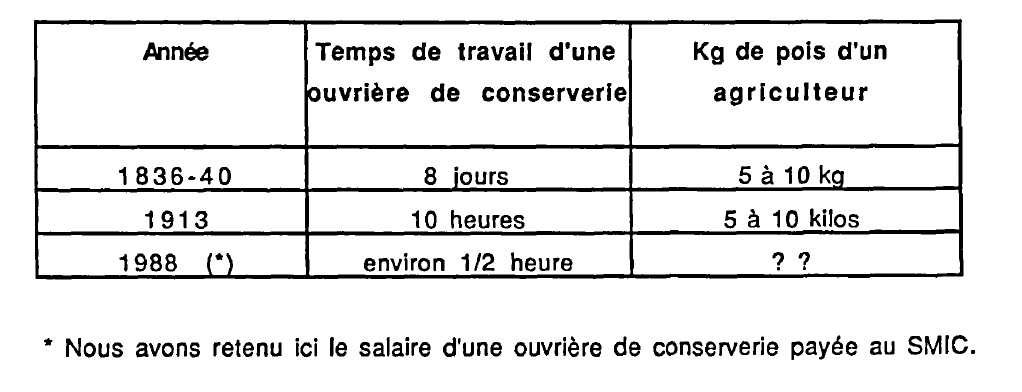
b La campagne de 1912 :
La conserverie ALBERT jusqu’en 1911 reste de type artisanal. Il y a en même temps la volonté de passer au stade industriel, de rejoindre le groupe des conserveurs industriels, auquel appartient leur voisin immédiat SAUPIQUET.
S’industrialiser signifie deux choses : agrandir ses locaux et moderniser son installation. Trouver des débouchés à la taille de sa nouvelle production. Enfin dans la mesure où la marque ALBERT se veut produit de qualité privilégiant les extra-fins et les fins, trouver un débouché pour les pois moyens et gros, c’est à dire assurer le remplissage pour un autre conserveur. Les frères ALBERT ont dû en parler autour d’eux et le 24 décembre 1911, ils reçoivent une lettre d’un autre conserveur “Conserves Alimentaires et Confitureries de l’Yonne – RENDU frères” – de Paris : “Messieurs, sous les auspices de Messieurs BERNIER et RIOM [1] de qui nous tenons votre adresse, nous vous demandons de bien vouloir nous dire si vous seriez disposés à faire pour nous du remplissage de boîtes à notre nom en pois au naturel et à l’étuvée, et dans l’affirmative, nous vous demandons de nous donner des prix dès que vous pourrez”[2].
A la suite d’une réponse immédiate des frères ALBERT, RENDU frères précisent : “La quantité que nous vous ferons faire dépendra des conditions ; 50.000 seraient facilement faites par vous, peut-être davantage. Nous vous demandons de nous envoyer des échantillons de votre fabrication et si possible de nous faire connaître vos prix, soit départ de Nantes, soit franco Paris. Nous prendrions livraison en quatre fois à peu près de juillet à décembre.
“Quant à la composition approximative en moyens, mi-fins et fins, nous vous la ferons connaître ultérieurement” [3]. S’engagent alors les négociations entre les deux conserveurs. Seules les lettres de RENDU frères nous permettent d’en saisir le contenu. Dès janvier, les négociations entrent dans leur phase sérieuse, l’accord de principe étant considéré comme acquis : “Nous sommes tout disposés à étudier le moyen de nous entendre dès maintenant car il nous faudra sans doute de nombreux échanges de lettres avant de tomber d’accord.
[1] Fabricants de boîtes nantais.
[2] Lettre du 23 décembre 1911.
[3 ]Lettre du 26 décembre 1911.
“La Maison BERNIER-RIOM se chargera des boîtes. Nous n’avons pas parlé avec elle des caisses, mais si cela vous est plus commode, nous pensons qu’elle acceptera de vous livrer les boîtes dans les caisses où elles seront expédiées pleines. Avez-vous le prix des caisses à titre de renseignement ? Dans votre région la caisse de peuplier est-elle plus avantageuse que la caisse de sapin venant des Landes ?…
“Avant de vous donner les quantités approximatives dont nous aurions besoin, veuillez nous dire laquelle des trois désignations suivantes vous avez l’habitude d’employer et le crible correspondant :
– moyens 2 ; moyens 1 ; mi-fins ; très fins ; extra-fins.
– moyens ; mi-fins ; fins ; très fins ; extra fins.
– hors crible ; moyens ; mi-fins ; très fins ; extra-fins.
“Il se produit souvent des confusions à cet égard.
“Avant que nous n’entrions en correspondance avec la Maison BERNIER, veuillez nous dire si votre personnel est habitué à une série de couleurs de fond correspondant à des dimensions de calibres, ceci afin d’éviter des confusions dans la mise en boîte. Voici notre série que nous pourrions modifier :
Moyens 2 : Vernis or
Moyens 1 : Chamois
Mi-fins : Vert
Très-fins : Jaune
Extra-fins : Rouge” [1]
[1] Lettre du 17 janvier 1912.
On voit ici la variation d’appellations qui peut exister d’un conserveur à l’autre. La série utilisée par ALBERT est encore différente : hors crible ; moyens, 27/28 ; fins, 26 ; très-fins, 25 ; extra-fins, 24 . Même si les appellations correspondent, il n’est pas sûr qu’elles renvoient au même numéro de crible.
Le 24 janvier, nouvelles précisions : “Cribles : cela nous parait bien. Boîtes et caisses : nous nous en occupons…
“Monsieur RENAUD a dû vous dire que nous ferions une quantité plus importante de pois au naturel que de pois à l’étuvée. La quantité de 1/2 boîte sera très inférieure à la quantité de 4/4. Sur 1.000 4/4 nous ne ferons guère que 100 à 120 1/2.
“Enfin sur cent caisses, la proportion serait à peu près la suivante pour les pois à l’étuvée et au naturel :
Moyens 48 %
Moyens ou mi-fins 23 %
Fins 16 %
Très-fins 10 %
Extra-fins 3 %
total 100 %
“Ces chiffres vous sont donnés simplement à titre d’indication et nous nous réservons de les modifier un peu dans l’avenir, suivant les besoins. Les boîtes à remplir vous seraient fournies en conséquence. Il est possible que nous augmentions la quantité de mi-fins et de fins.
“Ceci dit sans engagement de notre part. Il serait nécessaire que vous nous fassiez connaître également sans engagement pour le moment vos prix les plus réduits, dans les conditions ci-dessus énoncées, que vous nous fassiez parvenir quelque boîtes d’échantillons de chaque sorte ; enfin que vous nous assuriez que le remplissage des boîtes sera bien complet et conforme aux conditions”.
Les quantités demandées selon les calibres ne peuvent que réjouir les conserveurs ALBERT puisque l’essentiel de la demande porte sur les plus gros calibres, c’est à dire sur les qualités qu’ils ont peine à vendre.
Les brouillons des comptes effectués par les Frères ALBERT à cette époque nous permettent de savoir quels sont les prix proposés à RENDU frères et la base sur laquelle ils ont été calculés.
Laissant de côté le prix de la boîte métallique qui est fournie par RENDU, ils calculent le prix du contenu selon les calibres de pois. Ne différenciant pas les pois à l’étuvée et les pois au naturel, le prix obtenu se situera quelque part entre les deux, plus près du prix des pois à l’étuvée, car ils ont toujours fait plus de pois de ce type que de pois au naturel. Afin de tenir compte des bonnes et des mauvaises années, ils comparent les résultats de 1907 à 1911 pour pouvoir mieux juger de la dernière année. Les coûts de 1911 peuvent apparaître comme une bonne année de référence pour les prix à proposer d’autant que les prix des pois moyens «feiewt plus élevés que les autres années du fait du faible pourcentage de fins et d’extra-fins (27 %), le taux le plus faible depuis 1907. Ils calculent les prix sans inclure l’écossage, puis incluent ensuite l’écossage. Ce sont les prix avec écossage qu’ils vont proposer à RENDU. Comme ils vont écosser mécaniquement, les coûts de main-d’oeuvre seront plus faibles.
Par rapport au coût des pois au naturel de 1911, le prix proposé inclue donc une marge égale à :
M = (prix moyen – prix au naturel) + (prix écossage manuel – prix écossage mécanique).
Le prix des pois à l’étuvée est ensuite fixé à partir de cette base.
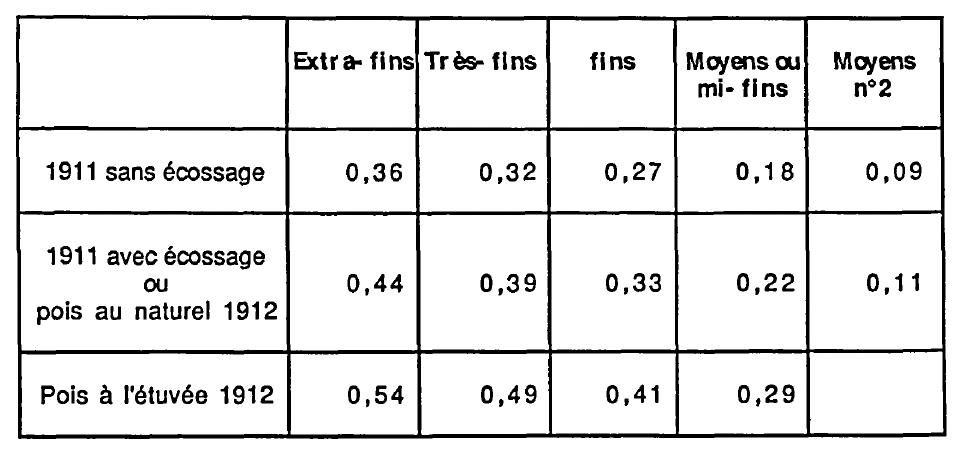
La marge est destinée à compenser les augmentations de prix éventuels et à pouvoir faire, au cours de la négociation des rabais éventuels.
Les conserveurs ne refont pas toujours les calculs dans le détail. L’expérience a conduit à une méthode de calcul simple. On part du principe que 1 kilo de pois non écossés fournit 1/2 boîte (rendement moyen). On calcule le prix moyen du kilo de petits pois (moyenne pondérée). Pour obtenir le prix des boîtes des différents calibres, on ajoute 65% au prix moyen pour les extra-fins, 25 % pour les fins, on retranche 35 % pour les moyens et 55 % pour les gros. Les prix obtenus sont les prix sans écossage. Appliqué à 1911, cette formule nous donne les prix exacts pour les extra-fins et les gros ; pour les fins, le prix est intermédiaire entre les très fins et les fins, ce qui est normal car ces deux catégories ne sont que la division de la catégorie fins habituelle ; le prix des moyens est par contre sous-estimé.
Commence alors le second acte des négociations portant sur les prix :
“Nous trouvons une différence considérable (avec les tarifs qui leur ont été faits l’année précédente par un autre conserveur – R.C.). Pour avoir le même prix de revient, il faudrait que vous puissiez baisser le prix des 1/2 boîtes que vous nous avez donné de 0,06 franc pour les mi-fins et de 0,10 franc pour les fins, très fins, extra-fins et encore, nous devrions pour vendre, appeler les Moyens I, mi-fins, et les fins, très-fins.
“Nous ne nous expliquons pas que la différence soit si grande. Le pois est-il plus cher que l’année dernière ? Les fers blancs ont certainement augmenté mais la Maison BERNIER-RIOM nous a assuré qu’elle nous donnait son dernier prix. Les caisses sont une augmentation importante mais nous ne voyons pas trop le moyen de faire voyager la marchandise en vrac.
“Dites nous néanmoins ce que vous pensez de notre demande de réduction de prix”[1]. Ce à quoi les frères ALBERT répondent par l’argument de la qualité, ce qui ne satisfait pas leurs interlocuteurs : “Comme vous le dites, la question de la qualité est importante et nous ne la négligeons pas. Nous discutons la question prix parce que, pour la revente, elle est capitale, la marge étant plus restreinte pour les affaires traitées à la commission que pour un fabricant. Il nous semble que vous pourriez étudier l’affaire qu’on vous propose parallèlement à la nôtre. Il ne nous est pas possible de vous donner une réponse definitive immédiate. Nous ne pouvons encore comparer les prix que nous pourrions faire avec ceux d’aucun fabricant. Il nous est nécessaire d’avoir au moins une impression à ce sujet et nous nous en occupons.
[1] Lettre du 31 janvier 1912.
“Nous retenons d’autre part la promesse que vous nous faites d’unescompte supplémentaire si l’année était très bonne.
“Pour préciser davantage les données antérieures, voici à peu près ce que vous feriez :
Pois au naturel – Pois à l’étuvée
Moyens 2: 320 caisses – 160 caisses
Moyens 1 ou mi-fins: 167 caisses – 83 caisses
Fins : 100 caisses – 50 caisses
Très-fins : 66 caisses – 33 caisses
Extra-fins : 14 caisses – 7 caisses
soit 1.000 caisses. Sur cette quantité environ 10 % de 1/2 et 90 % de 4/4″ [1]
[1] 1 Lettre du 7 février 1912.
Cette lettre montre que les relations commerciales sont encore très proches du marchandage, qu’il s’agisse de l’offre qui aurait été faite aux frères ALBERT ou la nécessité de comparer avec d’autres fabricants (alors que les prix de la saison sortiront beaucoup plus tard). Marchandage encore, la technique qui consiste à fournir les informations au compte-gouttes.
A travers la commande de RENDU Frères, on peut se rendre compte qu’il fournit une clientèle peu fortunée : les pois au naturel priment sur les pois à l’étuvée, la demande en pois très-fins ou extra-fins est très faible ; la demande de boîtes de 1/2 est elle aussi très faible.
Fin février, les grandes lignes du marché sont définies : “A la suite d’une correspondance avec la Maison BERNIER, nous avons dû supprimer les ½ boîtes étuvées en pois fins parce que nous n’en demandions pas une quantité suffisante pour faire un tirage illustré. Nous ne ferons pas de pois très-fins don’t nous n’avons pas la vente et augmenterons les pois moyens.
“Voici d’ailleurs l’affaire telle que nous la proposons :
– composition donnée au verso [1]
– boîtes et caisses fournies par nous
– expédition par wagon complet de fabrication à fin décembre à notre demande en port dû. Paiement à 30 jours et fin de mois, avec escompte de 3%…
“Nous demandons à ce que votre taille moyen [1] soit emboîtée comme mi-fins. Pour désigner les fins des extra-fins, il faudra mettre une marque à froid sur le couvercle et coller la bande de désignation passe-partout sur les boîtes…
“Nous attendons l’accord de la Maison BERNIER pour vous donner confirmation définitive”[2]. Et une semaine plus tard : “Nous attendons la réponse de la Maison BERNIER pour nous entendre définitivement. En principe nous sommes d’accord et maintenons les quantités données dans notre lettre du 22 février… Nous vous serions obligés si vous en avez occasion d’engager la Maison BERNIER-RIOM à hâter sa décision”[3].
Enfin début mars 1912 : “Nous nous sommes mis d’accord avec la Maison BERNIER-RIOM et vous prions de nous donner confirmation du marché d’après les conditions de nos correspondances” [4]. Les frères ALBERT renvoient immédiatement le projet de contrat. Si l’on compare aux prix proposés par ALBERT, les moyens au naturel n’ont pas bougé ; sont apparus les moyens à l’étuvée. Pour les mi-fins, il y a réduction de 2 c. au naturel et 1 c. à l’étuvée ; pour les fins 4 c. au naturel et à l’étuvée ; les extra-fins sont vendus au prix des très fins. Les concessions sont donc importantes sur les catégories qui représentent le volume le plus faible du contrat.
[1] Nous la retrouverons plus loin dans le projet de contrat rédigé par les frères ALBERT.
[2] Lettre du 22 février 1912.
[3] Lettre du 29 février 1912.
[4] Lettre du 5 mars 1912.
S’ouvre alors une nouvelle phase des échanges : préciser les détails de mise en pratique du contrat : “Nous sommes en tous points d’accord et précisons seulement quelques points de détail. Le crible extra-fin sera du numéro 24 ainsi que vous nous l’aviez écrit le 8 février.
“Les fins et extra-fins devant être mis dans le même boîtage rouge porteront une marque à froid sur les couvercles de boîtes :
- pois fins
- pois extra-fins
“Les boîtes rouges devant être munies d’un passe-partout de désignation (fins ou extra-fins), nous comptons sur vous pour le faire coller. De même pour marquer en noir ou à chaud sur l’un des bouts de la caisse la désignation du contenu comme :
4/4 pois mi-fins
ou 1/2 pois moyens-étuvés
“Nous vous prions de vous entendre avec la Maison BERNIER-RIOM pour les dates de livraison des caisses et boîtes. L’emballage devant être fait par vos soins, nous comptons sur vous pour mettre la quantité de sciure necessaire afin d’éviter la rouille…
“Nous vous serions obligés si, au moment de la récolte, vous voulez bien nous tenir au courant de la façon dont elle se présente.
“Au cas où des boîtes seraient reconnues mauvaises avant de les remplir, nous comptons sur vous pour les rendre à la Maison BERNIER et nous le signaler. De même et malgré la clause du contrat relative aux boîtes-fuites, si les maladresses ou les négligences répétées de votre personnel en étaient la cause, nous ne pourrions en supporter la perte (insuffisance d’ébullition, mauvais sertissage…?). Nous espérons que vous voudrez bien y veiller de façon sérieuse et ne vous faisons ces remarques que pour mémoire, sachant que vous êtes des fabricants consciencieux et de confiance”[1]
[1] Lettre du 9 mars 1912.
La lettre que nous venons de citer va bien au delà des précisions de détails. Elle vise à faire supporter de nouveaux coûts par le conserveurremplisseur.
Par son ton, elle marque le fait de la subordination du remplisseur au donneur d’ordre et marque un manque de méfiance totale (malgré la formule finale) envers les frères ALBERT. Cette méfiance va jusqu’à mettre en cause le savoir-faire et la conscience professionnelle du personnel de la conserverie aussi bien que du conserveur.
Nous n’avons pas la réponse des Frères ALBERT, mais dans la letter suivante, le ton a changé ; “Si vous êtes sûrs que les passe-partout tiennent, vous pouvez supprimer la marque à froid sur le couvercle. D’ailleurs, les caisses étant marquées en noir à l’extérieur nous ne ferons pas de confusion. Il serait plus facile que vous en fassiez si les boîtes ne sont pas étiquetées de suite.
“Pour la pose des passe-partout nous acceptons de payer la maind’oeuvre qui ne sera pas bien considérable. A combien l’évaluez-vous et êtes-vous sûrs de la colle que vous emploierez. Veuillez nous dire aussi si vous vous procurez vous-mêmes ces passe-partout ou si vous préférez que nous vous les envoyons. Etant sur place, vous pouvez plus facilement les faire faire d’après les dimensions de la place laissée sur le croquis de la boîte”[1]. Fin mars, nouvelle intervention : “De manière à limiter l’emploi des passe-partout, nous faisons imprimer sur corps la désignation fins sur toutes nos boîtes rouges. De cette façon il n’y aura à mettre des passe-partout recouvrant le mot fins que sur les extra-fins, c’est à dire pour 1.300 boîtes au total. Nous vous recommanderons de mettre la marque à froid sur le couvercle pour le cas où l’étiquette tomberait.
Nous comptons sur vous pour bien veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion”[2]
[1] Lettre du 18 mars 1912.
[2] Lettre du 25 mars 1912.
En dehors du contrat proprement dit, RENDU Frères sont amenés à faire une double demande. Ce sont d’abord des échantillons pour prendre les commandes avant le début de la récolte : “Nous allons être obligés de présenter des échantillons pour vendre des pois. Ceux qui nous restent de l’année dernière étant d’une fabrication moins bonne que la votre, veuillez nous dire si vous pouvez nous en envoyer une caisse de 1/2…” [1]
C’est un hommage indirect aux conserves des Frères ALBERT, la seconde demande porte sur les produits ALBERT eux-mêmes : “Nous aurions besoin sur la prochaine récolte de quelques caisses moyens 2 et moyens 1 au naturel à votre marque ou à l’une de vos contre-marque : TREBLA par exemple.
Cela pour ménager la susceptibilité d’un de nos clients qui ne veut pas voir la même marque que celle qui se vend chez un voisin avec qui notre voyageur a traité. Pourrions-nous compter sur vous pour nous les fournir en dehors du marché ? Il s’agit d’une douzaine de caisses. Le prix sera-t-il le même ?”[2].
Pour réaliser ce contrat, la conserverie ALBERT se modernise. Un nouveau bâtiment est construit pour accueillir notamment l’écosseuse et le crible. On peut avoir une idée de ce que sera la conserverie en 1912-13 à partir d’un inventaire fait à la veille de la première guerre mondiale : “Une Chaudière (générateur), une pompe d’alimentation (Petit cheval), une bassine en cuivre pour la cuisson, deux paniers en cuivre pour la bassine à cuire, un rafraîchisseur, deux autoclaves à vapeur, trois paniers (diaphragmes) pour les autoclaves, un autoclave à feu nu (monté en briques), deux paniers (diaphragmes) pour cet autoclave, une grue (treuil de sûreté), un treuil (palan différentiel) à chemin de fer, une sertisseuse automatique (BERNIER-RIOM), une écosseuse Navarre, un crible diviseur. Le bassin pour la condensation de la vapeur est dans la cour. Installation du service d’eau pour l’alimentation du bassin, de la chaudière, du rafraîcheur, de la bassine à blanchir et des deux autoclaves à vapeur. Installation de gaz (bec Auer et bec papillon), un compteur d’électricité et tout le branchement. Cabine du téléphone” [3]. Il faudrait ajouter à cette description des chariots pour transporter les paniers et tout le petit matériel nécessaire qui n’est pas prêté.
[1] Lettre du 22 mars 1912.
[2]. Lettre du 28 avril 1912.
[3]. Relevé fait avant de prêter les locaux à SAUPIQUET en 1914. Archives ALBERT
Tout ce matériel ne sera pas là au début de la campagne de 1912.
L’écosseuse, par exemple n’arrivera que le 4ème jour. De plus, dès le début mai, les frères ALBERT se rendent compte que la récolte sera mauvaise : “Nous avons reçu notre honoré du 1er et déplorons avec vous les mauvaises prévisions de récolte. Espérons encore qu’elle sera satisfaisante” [1].
Les premiers arrivages de pois se font le 14 mai. En 1911 la campagne avait débuté le 31 mai. La comparaison des deux années dans les premiers jours permet de comprendre les premières réactions des Frères ALBERT.
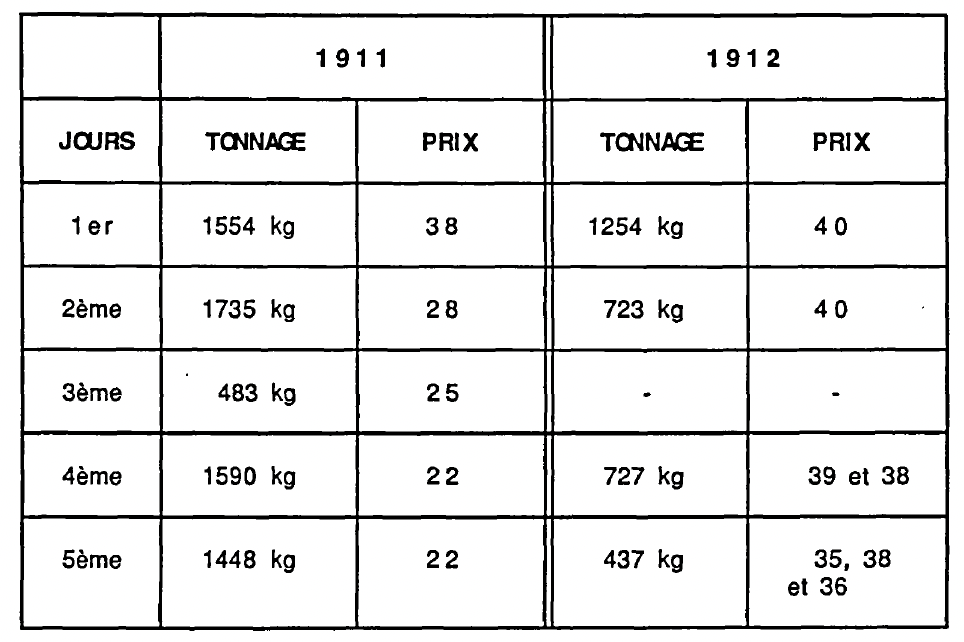
1] Lettre du 2 mai 1912.
Prix élevés, quantités faibles, écossage à la main car l’écosseuse n’arrive que le 5ème jour, les frères ALBERT sont perdants. Ils ont pendant ces cinq jours confectionné des pois au naturel pour RENDU. La quantité de fins et d’extra-fins atteint un taux de 46,4%. Sur cette fabrication, la perte financière est de 27 %. Le 6ème et le 7ème jour pas de pois. Les frères ALBERT écrivent alors à la maison RENDU. On ne connait pas le contenu de la lettre mais l’on peut supposer, vu les réactions de leurs interlocuteurs qu’ils ont fait référence à la clause de sauvegarde qui permet de résilier le contrat “si la récolte de pois venait à manquer”. La réaction est immédiate et se manifeste à travers une lettre qui cette fois est recommandée : “Nous recevons votre lettre du 20 mai dont certainement vous n’avez pas prévu toutes les conséquences. Vous ne pouvez vous dégager purement et simplement d’un contrat dont les clauses résiliatoires sont à établir. La raison qui vous fait agir nous parait être l’insuffisance de bénéfice que vous préjugez, par suite d’une récolte médiocre. Comme de notre côté nous avons déjà vendu environ 600 caisses et que nous ne pourrions nous libérer qu’avec des procès ou la perte de clients, nous n’acceptons pas une solution aussi simple et nous userons de tous les moyens en notre pouvoir pour la repousser.
“Nous espérons néanmoins que votre décision n’est pas définitive et attendrons une prochaine lettre pour savoir ce que vous avez résolu après de sérieuses réflexions.
“Nous vous faisons seulement remarquer que vous nous prévenez bien tard, après nous avoir entretenus jusqu’au 1er mai dans l’idée que nous pouvions compter sur vous” [1].
Deux jours après, sans attendre de réponse : “N’ayant jamais manqué à nos engagements, nous tenons avant tout à prendre une disposition pour tenir ceux de cette année et nous sommes limités par le temps. Nous pourrions à la rigueur fabriquer à Paris mais n’ayant pas d’appareils, ¡I faudrait que vous nous prêtiez pour quelques semaines votre écosseuse et votre trieuse. Comme vous n’en avez pas l’emploi, cela ne pourrait souffrir de difficultés. Veuillez nous dire ce que vous en pensez et nous pourrions nous entendre de vive voix, soit que nous allions à Nantes, soit que vous veniez à Paris pour cela.
“Nous avons d’autant moins compris votre dernière lettre que lamMaison BEZIERS et ANDIGAN de votre région acceptent tous les ordres sans aucunemrestriction et ont déjà pris des engagements considérables” [2.]
[1] Lettre du 21 mai 1912.
[2] Lettre du 23 mai 1912.
Les frères ALBERT n’avaient toutefois pas envisagé d’interrompre, du moins immédiatement, le contrat puisqu’ils remplissent des boîtes pour RENDU dès qu’ils ont à nouveau des petits pois, c’est à dire à partir du 21 mai. Les prix au kilo restent toutefois élevés (de 36 à 41 francs) mais les boîtes sont remplies cette fois à l’étuvée. Les pertes diminuent et le 23 mai le bénéfice est de 14 %, le 24 et 25 mai de 27 %. Dès le 22, ils avaient répondu à RENDU pour préciser le contenu de leur lettre : “Nous avons reçu votre lettre du 22 courant… Nous sommes heureux de vous voir disposés à faire votre possible pour trouver une solution à la situation actuelle, car en effet nous n’avions pas compris votre première lettre dans le sens que vous indiquez maintenant. Nous préférons que vous fassiez les quantités que nous avons vendues plutôt que d’entreprendre une fabrication à Paris où la récolte sera également médiocre et où nos frais d’installation pourraient atteindre un chiffre élevé. Bien entendu nous avons arrêté complètement la vente et l’aurions fait plus tôt si vous nous aviez prévenu en temps voulu.
“Nous écrivons à la Maison BERNIER-RIOM pour arrêter le montage des boîtes que vous ne pourrez remplir. Nous vous prions spécialement de faire votre possible pour nous donner la quantité vendue de pois moyens naturels… Nous espérons que la seconde récolte vous permettra de faire cette quantité. Veuillez nous prévenir dès que vous aurez fabriqué des quantités exactes don’t vous disposez dans chaque sorte” [1].
[1] lettre du 24 mai 1912.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Les pois déjà vendus, à la date du 24 mai par RENDU, ne coincident pas avec ce qui est déjà fait par ALBERT :
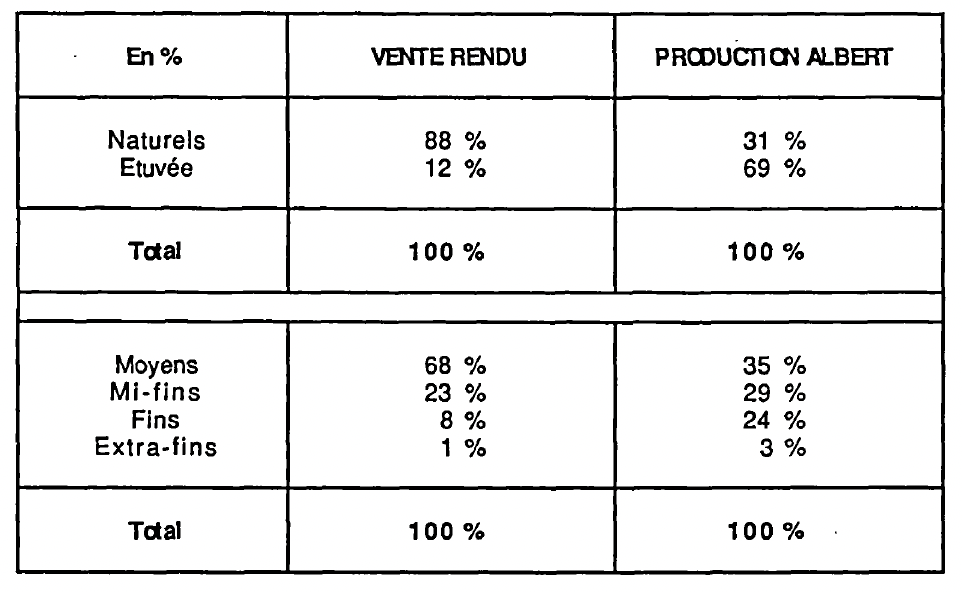
Malgré cette distorsion, les frères ALBERT continuent à fabriquer des pois à l’étuvée. Nouvelle lettre recommandée de RENDU : “La Maison BERNIER nous informe qu’elle a reçu de vous des instruction pour n’avoir à vous livrer que les boîtes pois à l’étuvée.
“Nous en concluons que notre lettre du 24 mai, dans laquelle nous vous donnions le détail de ce que nous avions vendu et confirmé à nos clients, ne vous était pas parvenue d’autant plus que vous ne nous avez pas accusé réception.
“Comme ces marchandises vendues sont celles qu’il convient de fabriquer avant tout autre, nous vous adressons à nouveau le détail…” [1]
[1] lettre du 29 mai 1912.
Nous savons qu’ALBERT avait reçu la lettre du 24 mai puisqu’elle est dans le dossier. Pourquoi ne pas en avoir tenu compte ? Trois raisons peuvent être avancées, raisons qui peuvent se conjuguer :
1) Comme il fabrique des pois à l’étuvée pour lui, il en profite pour remplir les boîtes RENDU.
2) Comme la récolte est insuffisante, il devra faire appel à des producteurs bretons, dont les pois sont de moindre qualité. En bon conserveur, il met à l’étuvée les pois de la meilleure qualité.
3) Ce n’est qu’en produisant des pois à l’étuvée qu’il fait un bénéfice. Sachant que la seconde récolte nantaise ne sera pas bonne et ignorant ce que sera la récolte bretonne, il préfère remplir ce qui lui rapporte un bénéfice puisqu’il n’est pas sûr d’assurer le contrat jusqu’au bout.
Méfiants, les frères RENDU se rendent à Nantes et tombent sur une journée sans arrivage de pois. La visite et les échanges qu’ils ont eu semblent les avoir rassuré : “nous vous exprimons le plaisir que nous avons eu de faire votre connaissance. Ce voyage nous a donné toute confiance en vous et en votre désir de nous donner les moyens de tenir nos engagements… Nous vous demandons de fabriquer d’abord ce qui s’impose le plus à notre besoin, ce savoir :
4/4 moyens au naturel
4/4 mi-fins au naturel
1/2 mi-fins au naturel
“Efforcez-vous donc avant tout de nous faire dans ces trois sortes, la quantité promise, soit la moitié de l’ordre primitif.
“Nous vous saurons gré également de nous tenir au courant des quantités que vous aurez fabriquées.
“Nous avons le plus grand désir de continuer pour l’avenir nos bonnes relations avec vous…” [1]
[1] Lettre du 1er juin 1912.
La campagne de petits pois nantais se termine le 5 juin. Sur 23 jours, il y a eu 8 jours sans arrivage de pois. Pendant cette période on peut comparer la production faite pour ALBERT et celle faite pour RENDU : 21 % pour les premiers et 79 % pour les seconds. La répartition interne de la production de chacun est encore plus intéressante :
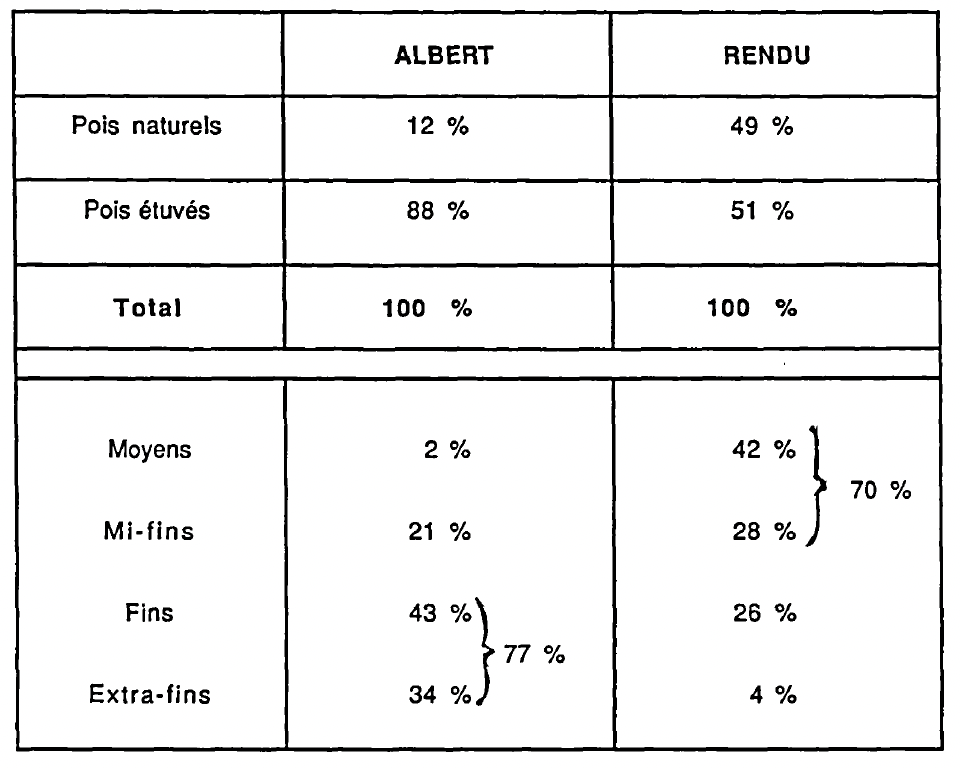
Dans les derniers jours de la campagne nantaise, les choses se sont dégradées pour ALBERT, les quantités à travailler ont baissé et les prix ont augmenté, atteignant 45 francs le dernier jour. En outre, obligés de produire des pois au naturel, les pertes financières réapparaissent, pour atteindre 36 % le dernier jour de la campagne.
Lors de la visite des frères RENDU à Nantes, les frères ALBERT ont pu les rassurer en leur prouvant qu’ils avaient engagé dès le 18 mai (jour de l’arrivée de l’écosseuse) des pourparlers avec des grossistes bretons pour acheter des pois dès le début de la récolte. La réponse du premier grossiste date du 21 mai 1912 : “M. L.M. auquel vous avez écrit m’a communiqué votre lettre du 18 mai touchant les petits pois ; nous serons prêts à expédier dans les 15/20 jours. Je représente ici la Maison CAILLE et MORIO1 et je ne demande pas mieux que de vous faire des envois de ce légume, dès l’ouverture de la campagne.
J’expédie dans mes sacs à me retourner en G.V. et je majore le prix d’achat de 2 francs pour 100 kilos pour mon travail. Mes pois sont à votre charge dès livraison en gare de Pont-Labbé ; je ne répond pas des déchets de route, ni de détérioration d’où qu’elle vienne. Les pois sont chargés sur wagons à 7 H 21 du soir et vous parviennent à Nantes vers 1 heure de l’après-midi le lendemain” [2].
Une seconde lettre apporte des précisions complémentaires : “Le port de Pont-Labbé à Nantes pour les petits pois verts – G.V. 14 [3] – est de 29,35 pour 1.000 kilos par wagon de 5.000 kilos et 32,40 pour 1.000 kilos par wagon audessous de 5.000 kilos.
“Nous chargeons les wagons de 5 à 6.000 kilos, quand les petits pois donnent ; au début de la campagne vous y mettons depuis 1.000 kilos jusqu’à 5.000 kilos, suivant les arrivages… Les petits pois sont en fleur, nous serons prêts vers le 15 juin”[4]
Ils reçoivent une lettre d’un deuxième grossiste de Pont-Labbé : “A mon retour de voyage, je trouve votre lettre du 18 mai… La cueillette commence ici vers la fin de la semaine. La quantité se fera normalement en augmentant journellement d’ici à 3 semaines. La concurrence sera forte vu les demandes de chaque côté.
“Mes conditions sont les suivantes. Prix – le cours du jour – augmenté de trois francs par cent kilos pour ma commission et autres frais de sous-commission qui sont à ma charge et nécessaire aux achats. Payer les rabatteurs qui courent la campagne, etc.. Marchandise acceptée et agréée au départ, paiement à ma volonté par chèque”[5]
[1] Conserveur nantais.
[2] Lettre de F BILLANT du 21 mai 1912.
[3] G.V. = Grande Vitesse.
[4] Lettre de F. BILLANT du 29 mai 1912.
[5] Lettre de F. CLERGEAU du 27 mai 1912.
Ces trois lettres servant de preuve de la bonne volonté des frères ALBERT, les frères RENDU peuvent repartir rassurés. Les choses n’iront pas pourtant aussi simplement. Ce sont d’abord les conserveurs nantais, qui, confrontés au même problème que la Maison ALBERT, vont former une entente pour contrôler le marché et se répartir les pois au prorata du nombre d’écosseuses qu’ils détiennent. Dès lors le représentant de CAILLE et MORIO ne peut plus leur vendre de pois. En second lieu, la récolte n’est pas aussi bonne qu’on pouvait l’escompter : “Les quantités de pois qui arrive sur notre marché sont insignifiantes. J’espère que dans 10 ou 15 jours, je pourrai vous donner satisfaction ; la demande est énorme de tous les points de France et les prix seront forcément élevés” [1]. Les frères ALBERT se rendent sur place pour essayer de traiter directement, ce qui semble avoir réussi : “Nous sommes heureux du résultat de votre voyage en Bretagne qui nous laisse l’espoir de recevoir une bonne partie des quantités promises” [2]. Cependant l’entente des conserveurs semble bien contrôler le marché : “Je pense que si vous vous adresser à M. GAUQUELIN, directeur de la Maison SAUPIQUET, vous aurez une partie des pois qui vont journellement à Nantes. C’est à mon avis la meilleure voie à prendre” [3].
[1] Lettre de F. BILLANT du 12 juin 1912.
[2] Lettre de RENDU du 14 juin 1912.
[3] Lettre de F. BILLANT du 20 juin 1912
A partir du 24 juin, la Maison ALBERT reprend la production avec des de Bretagne qui lui sont fournis par des membres de l’entente, les conserveurs nantais TIROT, CAILLE, SAUPIQUET, TERTRAIS. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils obtiendront des pois directement. Les trois derniers jours de fabrication seront faits avec un nouveau grossiste de Pont-Labbé, l’entente ne fonctionnant plus, soit que la campagne des autres conserveurs soit terminée, soit que l’entente ait volé en éclats.
Ces pois, qui semblent bon marché par rapport aux prix nantais, se révèlent être chers si l’on ajoute les commissions, les frais de transport et les déchets. Pour des pois ayant de très faibles proportions de fins et extra-fins, les prix atteignent 30 à 35 francs les 100 kilos. Ne fabriquant plus que des pois au naturel pour RENDU, les coûts de production seront toujours au-dessus des prix du contrat. D’où une perte tous les jours de production pouvant atteindre certains jours 28, 29, 30%.
Les arrivages sont aussi extrêmement irréguliers. Sur 34 jours (du 24 juin au 27 juillet) 10 jours seulement seront travaillés. La quantité travaillée pendant ce temps sera cependant supérieure à celle des 14 jours de travail de la campagne nantaise. Comment se répartit la production pour ALBERT et pour RENDU dans cette campagne bretonne, comparée à la campagne nantaise :
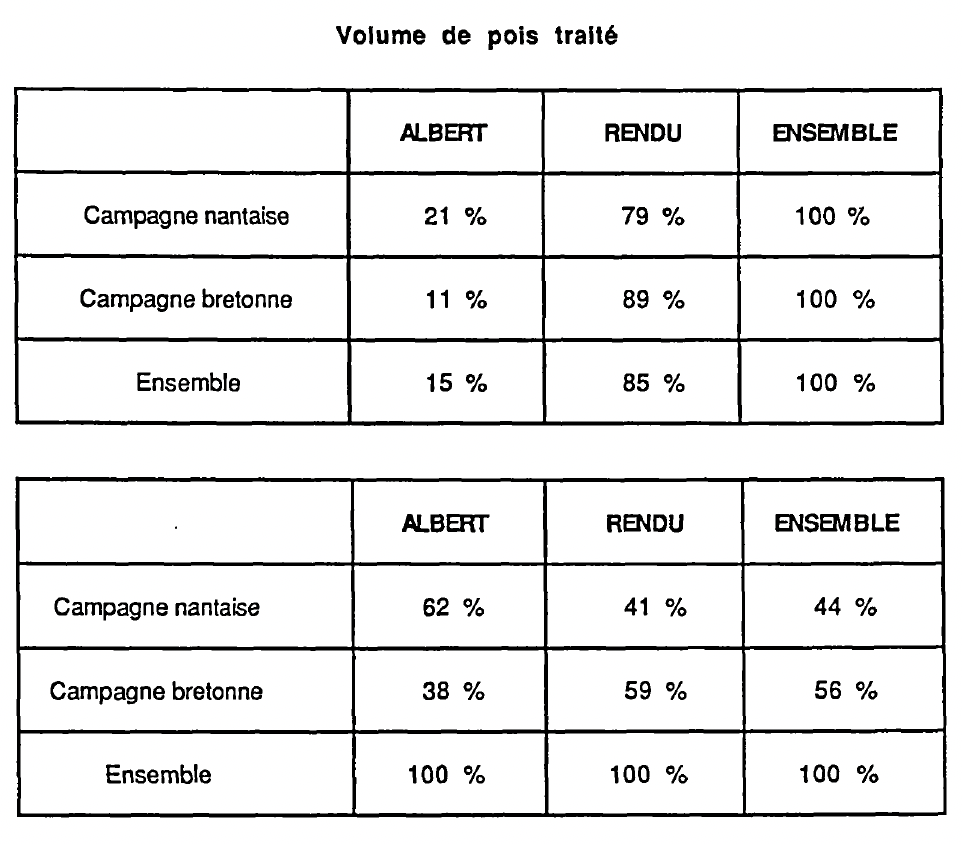
La production ALBERT pour 1912 sera du même ordre de grandeur que leur production de 1908, 1909, et 1910. Alors que la production de ces années-là était totalement nantaise, une partie importante aura été faite cette fois avec des pois bretons. Par contre ALBERT n’assurera que 49 % du contrat prévu avec RENDU. La répartition entre pois au naturel et pois à l’étuvée est une seconde partition à retenir pour caractériser les produits de la campagne.
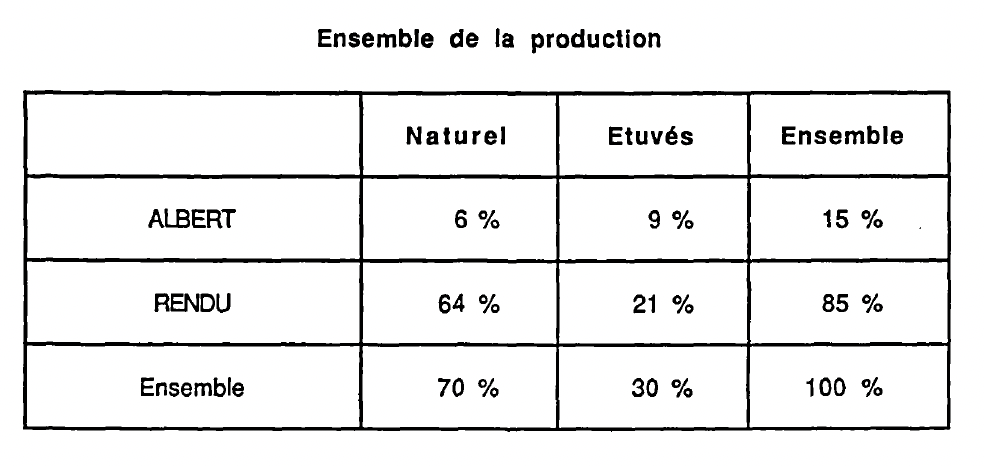
On voit l’importance des pois à l’étuvée dans la production pour ALBERT: 30% de la production des pois étuvés et 7 % seulement de la production des pois au naturel, ce qui donne 60 % d’étuvés pour sa production personnelle.
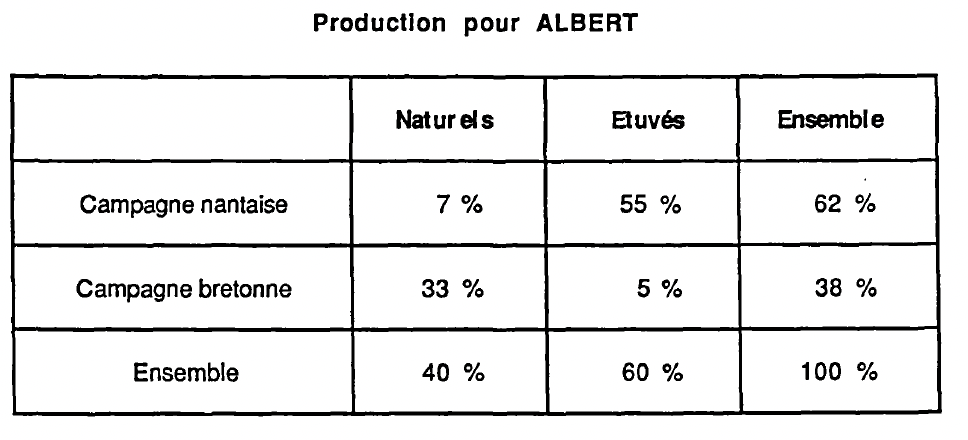
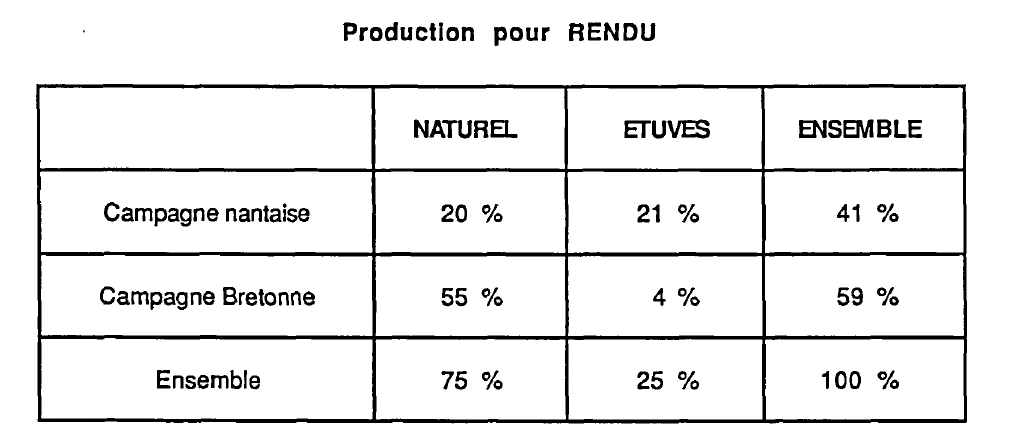
Dans le contrat initial, la part de pois étuvés pour RENDU était de 33%. Dans leur lettre où ils annoncent les pois vendus, cette part n’est que de 12%. A la fin de la production, elle représente 25%. Ces pois à l’étuvée avaient été produit pour l’essentiel (84%) pendant la campagne nantaise. Pour ALBERT, on voit que l’essentiel du pois à l’étuvée est produit par la campagne nantaise (92%) et l’essentiel des pois au naturel par la campagne bretonne (82%).
Le contrat initial prévoyait 15% de fins et d’extra-fins ; les ventes n’en comportent plus que 9%. La production réalisée par ALBERT en contient 23%. La distorsion ici est encore plus grande.
Si l’on prend les proportions de fins et d’extra-fins selon les préparations, le contrat en prévoyait le même pourcentage pour les pois au naturel et pour les pois à l’étuvée. Au lieu des 15% prévus, on en trouve 21,6% parmi les étuvés et 23,8% parmi les naturels.
Ces pourcentages sont toutefois bien inférieurs à ceux des conserves ALBERT. Si l’on retient le pourcentage d’étuvés et les pourcentages de fins et d’extra-fins comme des critères de qualités de conserve, on obtient les résultats suivants :
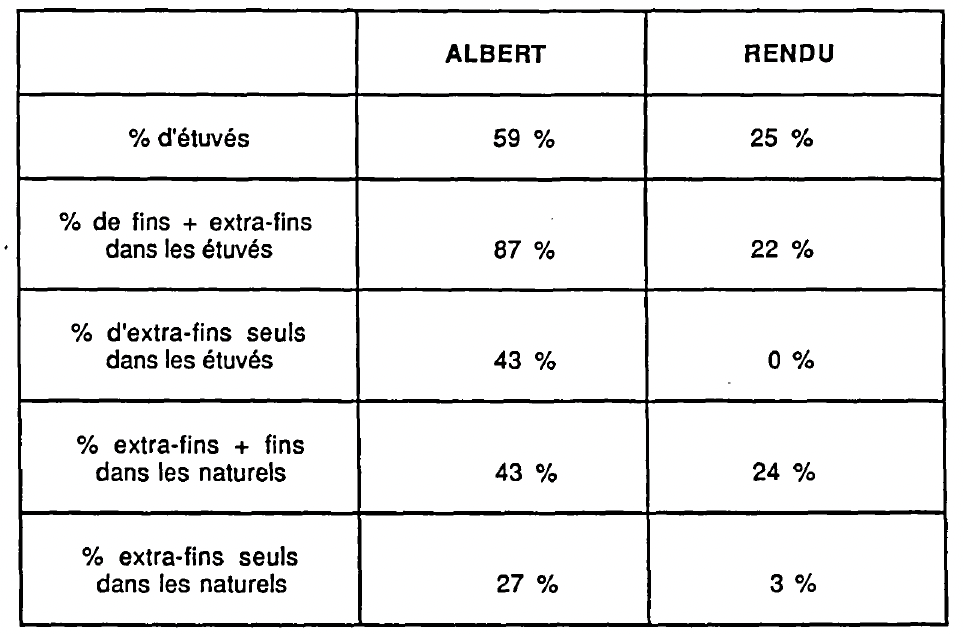
Les pertes pour ALBERT sont toutefois moins lourdes qu’il n’apparaît au premier abord. Le contrat de remplissage a permis d’atteindre un de ses buts: se débarrasser d’une partie des moyens et des gros et avoir ainsi un plus gros pourcentage de boîtes de fins et d’extra-fins d’autant plus que, la récolte étant faible, le prix de vente des pois sera élevé. En second lieu, l’amortissement des nouvelles installations est payé en grande partie par le contrat. En troisième lieu, tenant compte de la marge qu’ALBERT s’était donnée, les pertes ne sont réelles qu’au delà de 10%.
Le contrat avec RENDU sera reconduit l’année suivante dans de bien meilleures conditions pour les frères ALBERT.
Les carnets de comptes nous renseignent sur le personnel de la conserverie. Pour l’année 1912 les données sont imprécises : tantôt sont notées les personnes, tantôt le coût du personnel. Par contre les données pour 1913 sont bonnes pour 23 jours sur les 26 de production.
L’effectif maximum employé est de onze femmes et un homme. Nous laisserons de côté l’homme qui est à coup sûr le chauffeur mécanicien et dont le temps de travail est moins dépendant des fluctuations de la production. Sur 44 jours de campagne, les femmes n’ont travaillé qu’un maximum de 26 jours. Elles n’ont toutes été embauchées que pendant quatre jours ; pendant une journée, quatre d’entre elles seulement ont été embauchées. Pour les 3/4 des jours travaillés, il y avait au moins huit femmes. C’est à dire que le travail est concentré sur un petit nombre. On peut en avoir une idée si l’on tient compte de l’horaire maximum de la journée. 78% des journées-femmes effectuées correspondent au temps journalier maximum. Ce temps journalier maximum s’étale de 4 H 30 à 12 H selon les jours. 44 % des journées travaillées ont plus de 8 heures, 26% sont de 8 heures et 30% de moins de 8 heures.
On peut considérer, vu le tonnage traité, que l’écosseuse marche à plein avec onze femmes assurant des journées de dix à douze heures et un homme. Or nous savons par ailleurs que les conserveurs considèrent l’écosseuse comme une bonne mesure de l’entreprise et fondent là-dessus les répartitions de frais ou de récolte entre entreprises. En prenant la liste des conserveurs ayant formé une entente, on peut avoir une idée de la population maximum employée pendant la campagne des petits pois sur Nantes, deux conserveries extérieures à Nantes compensant les petites conserveries nantaises absentes:
C’est donc sur Nantes un maximum de 600 personnes qui assurent la production des pois. Reste la question de l’écossage à la main. Si l’on reprend les chiffres de chez ALBERT, il fallait pour une même quantité de pois de 2 à 5 fois plus de personnel qu’avec l’écosseuse pour une même quantité de petits pois, cette fourchette traduisant les variations liées à la qualité du pois (primeur extra-fin ou gros). Mais en même temps la production était de 3 à 4 fois moindre. On peut donc estimer qu’à la période d’écossage à la main, c’était de 1.000 à 1.500 femmes qui étaient concernées, mais concentrées dans certains quartiers, ce qui permettait d’en imaginer un effectif beaucoup plus élevé qu’il n’était en réalité.
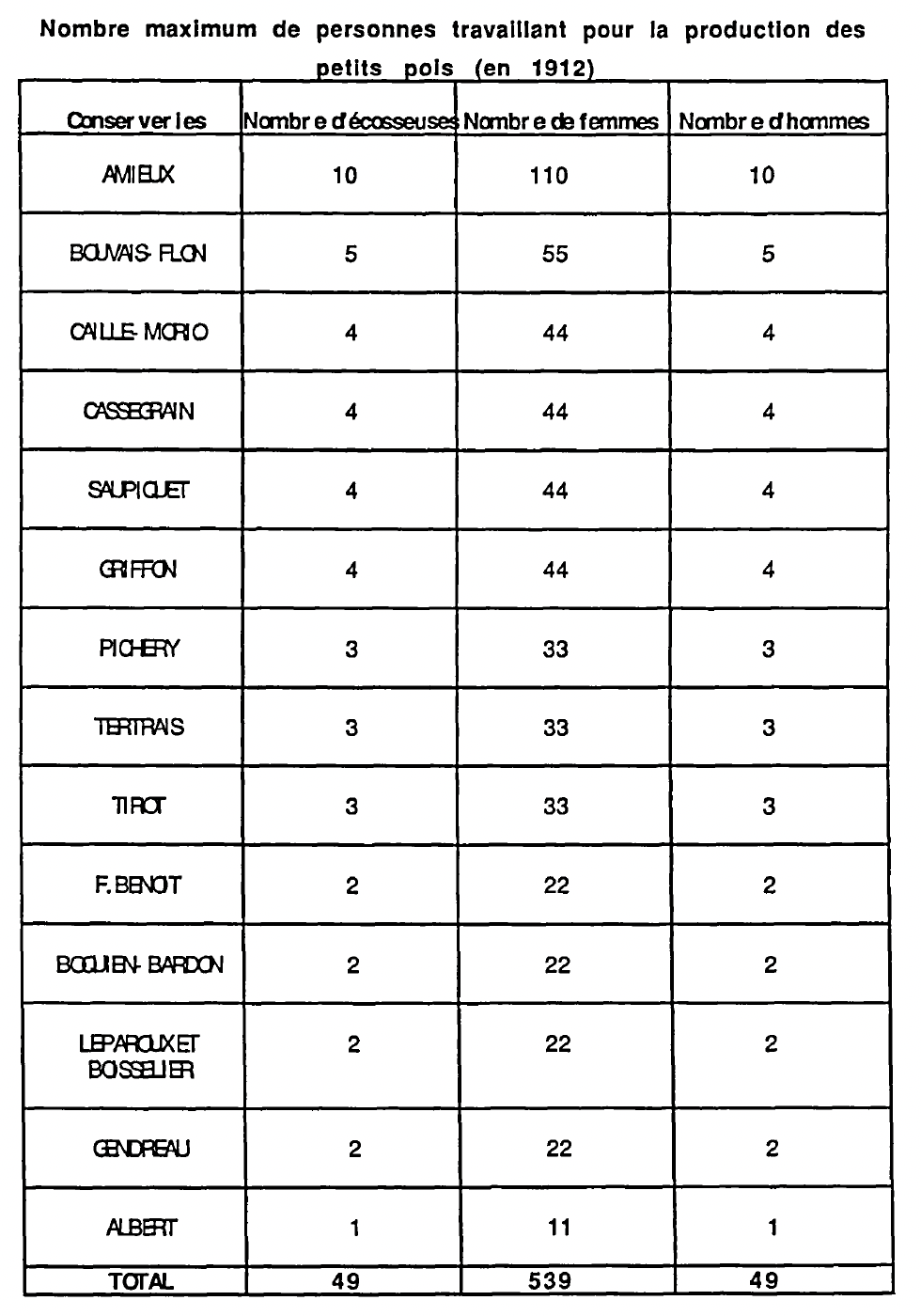
VI CONSERVEURS ET PRODUCTEURS DE LEGUMES :
Au cours du XIXème siècle, les conserveurs se sont d’abord adaptés aux rythmes des productions agricoles, pour leur fabrication de conserves de légumes. Ils subissaient comme les agriculteurs, tous les aléas de la nature, se trouvaient aussi bien dans l’incapacité de produire des conserves de tel ou tel légume parce que les récoltes en avaient été nulles, détruites par quelque cause naturelle, et de tout façon ne pouvaient réaliser leur fabrications qu’en se pliant totalement au rythme des récoltes, surchargés certains jours par des arrivages qu’ils ne pouvaient traiter entièrement dans la journée, puis pouvant rester sans matière première à travailler pendant plusieurs jours. Les conserveries s’étant rapidement développées dans la seconde moitié du XIXème siècle, c’est surtout à des problèmes de pénurie de légumes que les conserveurs ont eu d’abord à faire face dans leur rapports avec les maraîchers. Dès la fin du XIXème siècle, on voit ainsi les conserveurs se préoccuper directement des problèmes de l’agriculture, et au cours du XXème siècle, on assiste à l’établissement progressif d’une véritable réglementation des cultures de légumes pour conserves. Dans le développement des rapports entre conserveurs et producteurs de légumes, on voit les préoccupations des conserveurs se ramener à 3 ou 4 points essentiels pour eux : produire suffisamment de légumes, produire les légumes au moindre coût, produire les qualités de légumes les plus commercialisables en conserve, adapter le rythme de production des légumes à celui de la fabrication des conserves.
A la recherche d’une production suffisante de légumes :
C’est sans doute d’abord l’insuffisance des quantités de légumes produites par les agriculteurs, qui a amené les conserveurs à se préoccuper de plus près des problèmes des cultures.
Défendre ensemble les cultures :
La lutte contre les hannetons et les vers blancs détruisant les plantations de petits pois et de haricots verts, semblent être la première action concertée des conserveurs dans le secteur agricole. Dans le Petit Ecomoniste [1] du 15 avril 1893, puis du 15 mai de la même année, on trouve l’organisation d’un syndicat inter-communal de lutte contre les hannetons, à l’initiative du syndicat des Fabricants de Conserves de Nantes :
“Le syndicat des Fabricants de Conserves de Nantes, que les ravages portés par les vers blancs dans les cultures de petits pois et de haricots verts avaient forcé l’an dernier de réduire notablement leur fabrication, a pris l’initiative de l’organisation d’un syndicat comprenant la ville et 20 communes suburbaines”.
Les hannetons étaient sans doute à l’époque la cause la plus courante de destruction des récoltes. Un autre journal local, l’Industriel Nantais [2], du 1er mai 1890, fait état de ce problème des hannetons pour l’agriculture, nous montre que ce devait être une lutte répétée chaque année, avec plus ou moins d’ampleur, et que l’envahissement de cet insecte pouvait prendre des proportions importantes, au point qu’il soit envisageable de tirer partie de cette plaie et de transformer les hannetons en engrais ; c’est en tous cas le conseil que donne le journaliste :
“Lors de la fameuse hannetonée de 1887, l’embarras de nos agriculteurs fut grand en présence des cadavres entassés de leurs infortunées victimes. Cette masse Inanimée ne tardait pas à entrer en putréfaction et à répandre une odeur infecte, et vite on procédait à un profond enfouissement. Il y avait là cependant un précieux engrais, mais la précipitation avec laquelle l’opération était faite ne permettait pas dans la plupart des cas d’en tirer tout le parti possible. Le journal d’Agriculture pratique du 16 mai, nous donne sur les hannetons une analyse de M. Victor CAMBON, ingénieur des Arts et Manufacture à Lyon [3], très digne d’intérêt”. Suit l’analyse chimique de 100 grammes de hannetons, qui fait ressortir la valeur du hanneton comme engrais, et le faible coût de cet engrais, puisque “100 kilos de hannetons équivaudraient à 800 kilos de bon fumier de vache”.
[1] Le Petit Economiste – Archives Municipales de Nantes – Presse 166.
[2] Archives Municipales de Nantes.
[3 ]Auteur également de plusieurs ouvrages. L’allemagne au Travail, La France au Travail, etc..
Cependant le journaliste ajoute que “les hannetons ont parait-il la vie assez dure, et l’on n’est pas encore bien fixé sur un procédé sûr et économique pour les exterminer”. Nous ne savons pas exactement quelles mesures de défense contre cet insecte, a pu prendre le syndicat intercommunal créé à cet effet.
Accroître la production de légumes et la répartir :
La défense des cultures existantes ne suffisait pas pour atteindre une production de légumes assez volumineuse pour toutes les conserveries. Les conserveurs ont donc éprouvé le besoin de se regrouper pour se répartir les volumes de production, notamment de petits pois, de façon équitable, c’est à dire en fonction des capacités de production de chaque usine. Mais en même temps, leur but était d’accroître les ensemencements, et pour cela d’informer les agriculteurs.
C’est semble-t-il la Société SAUPIQUET [1], représentée par son directeur Jules GAUQUELIN qui est à l’origine du “Groupement des Fabricants de Petits Pois”. Nous ne savons pas exactement à quelle date ce groupement a commencé à fonctionner. Les procès-verbaux des réunions au cours desquelles les objectifs du groupement sont discutés, datent des 6 et 15 novembre 1912.
Cependant, une lettre adressée aux Frères ALBERT et les informant “que tous les fabricants de pois de Nantes et de Bretagne ont formé un groupe pour se partager les produits de Pont-Labbé”… est datée du 9 juin 1912. D’ailleurs, le correspondant des Frères ALBERT, auteur de cette lettre, signale que c’est à
“Messieurs SAUPIQUET et Cie (par CAUQUELIN, Directeur)” qu’il faut faire la demande d’inscription au Groupement, – ce qui confirme le rôle important joué par cette Maison dans le Groupement.
[1] Procès verbaux des réunions du Groupement, sur papier à en-tête de la Société SAUPIQUET. Archives ALBERT
Les Maisons participant à ce Groupement sont Messieurs AMIEUX, Fd. BENOIT, BOQUIEN, BOUVAIS-FLON, CAILLE et MORIO. CASSEGRAIN et Cie, DUPAS, LEPAROUX et BOISSELIER, MARTINEAU, PICHERY et Cie, Société SAUPIQUET, TERTRAIS et fils, TIROT et Cie de Nantes ; GENDREAU, MORIN et Cie de la Rochesur- Yon, GRIFFON, PAPILLON et Cie de Cholet.
Les objectifs discutés lors de la réunion du 15 novembre 1912, sont :
“1° augmenter les ensemencements de petits pois.
2° surveiller la récolte.
3° la répartir”.
“De la discussion qui s’engage sur les meilleurs moyens à prendre pour chacun, pour contribuer à l’extension de la culture des petits pois, il résulte que :
1° il faut s’adresser de préférence aux gros propriétaires seuls capables de faire un essai probant.
2° choisir les terrains de culture en dehors de ceux existants déjà.
3° contracter pour le compte du Groupement”.
Les “gros propriétaires” à choisir devraient être en fait ceux qui pouvaient ensemencer 4 ou 5 hectares en légumes-primeurs, par opposition aux maraîchers fournissant jusque là les conserveries, qui ne cultivaient que des parcelles très petites. Le texte édité par le Groupement en vue d’informer largement ‘les propriétaires et cultivateurs”, “Petit Traité Pratique pour la Grande Culture des Pois non rames destinés à la fabrication des Conserves Alimentaires”, expose les défauts de la culture maraîchère dans les environs de Nantes :
“Dans les environs de Nantes, la culture du pois est restée maraîchère et la grande culture ne s’y intéresse pas.
“Dans les environs de Paris, au contraire, c’est la grande culture qui cultive le pois à conserve et certains fermiers ensemencent 12, 15 et même 20 hectares de pois chaque année.
“En Belgique, il existe des organisations agricoles cultivant des centaines d’hectares de pois chaque année.
“S’il n’en est pas de même à Nantes, cela tient à ce qu’on continue à considérer le pois comme un article de jardinage que l’on cultive à frais considérables : travail de la terre à la bêche, semage à la main, frais de ramage importants, et surtout obligation de faire faire la cueille très lentement, par des personnes compétentes et sérieuses, et cela juste à l’époque où la main-d’oeuvre fait défaut.
“Si la grande culture veut s’intéresser au pois avec toute chance de réussite, il est absolument nécessaire qu’elle procède tout autrement”.
Ces zones de cultures maraîchères, fournissant jusque là les conserveries nantaises, nous les connaissons notamment par la liste des communes pressenties en 1893, pour participer au Syndicat Intercommunal de lutte contre les hannetons. Au nord de la Loire et de Nantes, et d’ouest en est, ce sont, outre Nantes, Chantenay, Saint-Herblain, Couëron, Sautron, Orvault, La Chapelle sur Erdre, Sucé, Carquefou, Sainte-Luce, Doulon, Thouaré, Mauves. Au sud de la Loire, Saint-Julien-de-Concelles, Basse-Goulaine, Saint-Sébastien, Vertou, Rezé, Bouguenais, Saint-Aignan. Ces communes sont toutes proches de Nantes, situés au plus à une douzaine de kilomètres. Cependant les productions en petits pois de ces communes étaient si insuffisantes pour l’ensemble des conserveries de Nantes que celles-ci devaient en acheter et faire venir de Bretagne. C’est sans doute pour éviter ces transports, que les conserveurs de Nantes avaient décidé d’accroître les productions sur le Sud-Loire.
Les nouvelles zones d’implantation de cultures prospectées par le Groupement des conserveurs, furent plus éloignées de Nantes, jusqu’à 30 à 40 kilomètres, essentiellement au sud de la Loire, sur les communes de La Planche, Vieillevigne, Saint-Jean-de-Corcoué, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, La Marne. Lors de la réunion du 15 novembre 1912, les conserveurs présents estimaient “à 150 le nombre d’hectares nouveaux à prévoir”. Dans le numéro 2-3 septembre décembre 1960 du journal AMIEUX, Vendre AMIEUX, il est dit qu’entre 1918 et 1930, “600 hectares de culture sont venus s’ajouter à ceux qui existaient auparavant dans la région nantaise”.
En fait, l’accroissement des ensemencements devait aussi aboutir à un abaissement des coûts de production des petits pois, par la mise en place de techniques modernes d’agriculture. Cette volonté de transformation des techniques agricoles était sans doute une des raisons du changement de zone pour cette culture. II devait paraître plus aisé et d’un succès plus sûr, d’implanter de nouvelles techniques concernant une plante, chez des cultivateurs n’ayant jamais pratiqué cette culture, plutôt que chez ceux qui avaient déjà des habitudes dans ce domaine. Les innovations techniques reposaient à la fois sur l’utilisation d’instruments agricoles à la place du travail à la main, et sur un changement de procédé agricole : remplacement du ramage des petits pois par la pratique du pinçage.
“1° Que les labours, ensemencement, binage, e t c . , puissent se faire, comme pour le froment, avec des instruments agricoles et non à la main ;
2° Supprimer les frais de ramages et économier par ce fait le bois et la main-d’oeuvre nécessaires ;
3° Pratiquer le pinçage qui permet une cueillette tout aussi fructueuse, en une seule fois, ainsi qu’il est expliqué ci-après, cueillette qui peut se faire en employant une main-d’oeuvre inutilisable pour d’autres travaux, vieillards, enfants.
“Rien de plus facile, et nous donnons ci-dessous la façon d’opérer avec les renseignements sur les frais de toutes sortes et le rendement moyen par hectare”.
Les innovations apportées dans cette culture, doivent aussi passer par l’emploi de semences nouvelles, choisies par les conserveurs, pour leurs capacités de rendement, mais surtout pour leur caractère primeur ou au contraire tardif, permettant d’étaler les récoltes. Cette mesure était la première qui amenait un contrôle direct des conserveurs sur les cultures. Car, non seulement ils choisissaient eux-mêmes les semences à planter, mais encore ils les fournissaient eux-mêmes aux cultivateurs.
A la réunion du 15 novembre 1912, si les conserveurs présents se mirent facilement d’accord sur le fait “de fournir la semence, mais d’en récupérer la valeur sur l’achat des pois”, par contre ils ne s’entendirent pas sur le choix des semences : “M.GAUQUELIN est d’avis de choisir des sortes tardives pour prolonger la récolte. M.AMIEUX est au contraire d’avis de prendre des sortes primes pour amener l’abondance”. Il est par conséquent décidé “que la liberté complète soit laissée à chacun des membres d’opérer pour son compte et comme bon lui semble pour propager la culture des petits pois”.
Les relations entre conserveurs et cultivateurs devaient être fixées du moins pour certains points, par contrat écrit. Le Groupement laissait chaque conserveur libre d’établir, avec ses producteurs de légumes, le contrat qu’il voulait, mais il suggérait un certain nombre de points à préciser : “En étudiant les divers projets de contrat qui nous ont été soumis, nous avions d’abord songé, à dégager par éclectisme, le contrat type. Mais en y réfléchissant, il nous a paru que ce contrat, s’adressant à des milieux divers, éducation, relation, situation de terrains, etc.. il nous a paru qu’il valait mieux signaler les points essentiels d’un contrat, en laissant à chacun le choix d’un texte approprié aux circonstances et aux personnes… Toutefois, comme nous nous adressons à des néo-cultivateurs, ce contrat serait incomplet, si nous ne les mettions en garde contre certains écueils, justement prévus par la Maison BOUVAIS.
“1° Le pinçage a l’avantage de nourrir les pois de pieds, et éviter ces pois ratés ne contenant aucun grain, appelés piochons, et refusés par la conserve.
“2° Les pois jaunes, indices d’une mauvaise cueillette, seront refusés n’ayant sur les marchés de pois frais, aucune valeur.
“3° Les pois cueillis dans la journée sont livrés le jour même à la gare où la réception se fait.
“4° Le pois est cueilli sans pied ou queue, la gousse seule est marchande”.
Toutes ces précisions ont pour but d’avertir nettement les cultivateurs des exigences des conserveurs, quant à l’état des petits pois qu’ils accepteront d’acheter. Le cultivateur reste apparemment libre de mener la culture et la récolte comme il l’entend, mais c’est au risque de ne pas pouvoir vendre sa production. D’ailleurs, dans plusieurs contrats proposés, on trouve des conditions strictes de culture et même parfois le droit du conserveur à contrôler les cultures : “Dans l’intérêt commun, la culture devra être soignée et pour cela les pois montés à la 5ème ou 6ème fleur devront être pinces au-dessus… La cueillette se fait dans la quinzaine qui suit le pinçage…”. “M. X. s’engage à ensemencer, sous culture spéciale…”. Ou encore, le conserveur “devra indiquer à M…. dans quelles conditions et à quelle date de préférence les ensemencements devront être faits…”, “M. B.B. se réserve le droit de visiter et surveiller la culture”.
Bien sûr ces contrats comprennent aussi la fourniture des semences par les conserveurs, moyennant un prix fixé, à payer par le cultivateur. Ils comprennent parfois les surfaces à ensemencer, mais même si elles ne sont pas spécifiées, elles sont déterminées par les quantités de semences fournies. Par contre, parfois, le contrat spécifie seulement une quantité de pois récoltés à fournir au conserveur, et parfois même “à raison de x kilos par jour”. C’est dire que le cultivateur s’engage alors à un certain rendement calculé à partir de la quantité de semences fournies. Bien sûr le cultivateur doit fournir au conserveur la totalité des produits issus des semences fournies. “Il est bien entendu qu’il ne sera pas livré d’autres pois que ceux provenant de la graine ci-dessous spécialement indiquée… Aucune graine mélangée ne sera tolérée…”. Inversement les conserveurs s’engagent à prendre la totalité de la récolte provenant des semences fournies. Enfin, les contrats comprennent les conditions de livraison des petits pois et surtout les pois payés pour la récolte.
La question du prix à payer a été, avec celle de la répartition des quantités récoltées, une des plus longues et des plus délicates à régler. Comme pour les accords passés entre conserveurs face aux pêcheurs, ces accords sur les prix et les partages n’ont pas résisté face aux pénuries de produit. Dans une lettre déjà citée adressée aux Frères ALBERT par un commissionnaire de Pont-Labbé, le 9 juin 1912, ce dernier leur indique, outre l’existence du Groupement de conserveurs, que “les pois achetés par les commissionnaires de Pont-Labbé seront adressés en bloc à Nantes où ils seront partagés suivant le nombre d’écosseuses des fabricants… Si vous ne faites pas partie du Groupe vous paierez 3 F de commission par 100 kg au lieu de 1,50 F, et vous ne serez pas bien placés pour travailler”. Il est clair que les conserveurs s’étaient déjà mis d’accord, en juin 1912, sur un partage des quantités de petits pois disponibles, qu’ils devaient obtenir à un tarif unique, par région au moins, unifiant même les prix payés aux commissionnaires. Il s’agissait bien d’une première entente entre conserveurs pour limiter entre eux les effets de la concurrence face à l’achat des matières premières à transformer. La répartition entre eux, en fonction du nombre d’écosseuses, correspondait aux capacités productives de chaque Maison. Mais ce début d’entente ne semble pas avoir résisté, à cette campagne là, face au manque de petits pois pour couvrir tous les besoins. Une autre lettre du commissionnaire de Pont-Labbé aux Frères ALBERT, du 12 juin 1912, leur dit :
“Les quantités de pois qui arrivent sur notre marché sont insignifiantes ; j’espère que, dans 10-15 jours, je pourrai vous donner satisfaction ; la demande est énorme, de tous les points de la France et les prix seront forcément élevés”. Entre le 9 et le 12 juin, le Commissionnaire de Pont-Labbé a donc changé de position face aux Frères ALBERT et après leur avoir conseillé de passer par le Groupement de Conserveurs Nantais pour acheter des petits pois, il est prêt à leur vendre directement. Nous n’avons pas les lettres envoyées par les Frères ALBERT et nous ne connaissons pas leur position. Mais il y a cependant dû y avoir un relâchement dans les décisions d’entente du Groupement. Cet échec de l’entente pour la campagne de 1912, se confirme dans la réunion du 15 novembre 1912, lors d’échanges de vues entre M. F. BENOIT et M. AMIEUX. Selon M. F. BENOIT, “l’entente à l’achat devrait être le sujet de la discussion initiale”, les questions de l’extension de la culture à l’ordre du jour à cette réunion, “en restant le corollaire”. “M.AMIEUX estime au contraire que l’extension de la culture conduit à l’abondance et que d’une abondance suffisante peut naître une entente”. AMIEUX sait en effet, pour l’avoir expérimenté en tant que Président du Groupement des Fabricants de Conserves de sardines, que face à la pénurie de matières premières, et à la moindre entente entre producteurs, les conserveurs achèteront chacun pour leur compte par tous les moyens. De plus, la Maison AMIEUX est alors la plus importante du Groupement pour la production des petits pois, puisqu’elle a 10 écosseuses, et que la Maison venant juste après elle n’en a que 5 (les autres sont toutes en-dessous de 5). AMIEUX a donc besoin d’une grande quantité de petits pois à travailler.
C’est seulement en avril 1914 que l’on trouve de nouvelles lettres et notes concernant le Groupement et surtout l’entente pour l’achat des petits pois.
Le 22 avril 1914, est envoyée, aux membres du Groupement, une “note modifiée relative à l’accord pour les petits pois”. Le texte de cette note, en 10 points, est une réglementation stricte et détaillée des conditions d’achat des petits pois. Ces conditions sont de trois ordres : les prix, les moyens de contrôle du Groupement pour l’application de ses décisions, et les moyens pour se défendre contre des acheteurs concurrents ne faisant pas partie du Groupement.
– Les prix d’achat :
“1° Chaque matin le cours à payer sera fixé par un bureau composé de 3 membres… Bien entendu, les membres désignés ci-dessus devront pour l’établissement de ce cours, tenir compte des observations qui pourront être formulées par leurs collègues, également des cours pratiqués aux halles de Paris et au marché de Nantes.
“2° Le cours ainsi fixé doit être appliqué à tous les achats de pois faits par les Commissionnaires. Mais les pois portés directement par les cultivateurs, le soir, dans les usines, ou achetés le matin sur le marché de Nantes, pourront être payés 1 F de plus”.
Cette dérogation, réglementée, dans le prix d’achat des petits pois, était en fait un encouragement aux cultivateurs à amener leur production la veille au soir ou le matin très tôt, pour que ces petits pois puissent être travaillés dans la journée. Il était plus difficile aux conserveurs – encore qu’ils utilisaient largement les heures de travail de nuit – de faire traiter d’un seul tenant, une masse de petits pois arrivés au cours de la journée. L’embauche du personnel devait se faire le matin, et il était important pour les conserveurs de connaître les quantités de pois reçus pour la journée, pour pouvoir y adapter une quantité de main-d’oeuvre correspondante.
“4° Les fabricants seront toujours libres de faire payer au-dessous des cours fixés…”.
La liberté était laissée aux Conserveurs de trouver des cultivateurs qui accepteraient d’être payés en-dessous des cours. Ils risquaient surtout de ne pas trouver de petits pois à acheter. Par contre bien sûr, ils n’avaient pas le droit de payer au-dessus des cours fixés.
– Les moyens de contrôle du Groupement :
Les conserveurs, traditionnellement, avaient chacun leurs commissionnaires, intermédiaires entre eux et les producteurs, qui sur place dans les communes productrices, achetaient les quantités de légumes demandées par le conserveur. Un commissionnaire pouvait travailler pour plusieurs conserveurs. C’étaient également par les commissionnaires que passaient les semences fournies par les conserveurs, les textes des contrats à signer et toutes les décisions à transmettre aux cultivateurs. Par cette note d’avril 1914, le Groupement se donne donc les moyens de contrôler les commissionnaires de tous les conserveurs membres.
“4° (suite)… Les commissionnaires ne doivent pas être payés plus de 2 F par 100 kilos, commission d’achat et de transport à l’usine comprise, ou 1,80 F pour achat et remise en gare départ”.
Il s’agit d’interdire de sur-payer des commissionnaires dont on pourrait alors obtenir des dérogations illicites par rapport aux décisions du Groupement.
“5° Chaque fabricant s’engage à donner la liste complète de tous ses commissionnaires, et les commissionnaires en question devront de leur côté donner la liste très exacte des sous-commissionnaires qu’ils peuvent employer.
A réception de ces listes, chaque fabricant écrira à ses commissionnaires pour leur interdire de créer de nouveaux postes.
“6° Pour éviter tous risques d’erreurs ou de malentendus, il est spécifié que tous les adhérents aux présentes devront transmettre leurs instructions à leurs commissionnaires par l’entremise d’un employé unique choisi par le Groupement, lequel sera en outre chargé de surveiller si les instructions données aux commissionnaires sont rigoureusement appliqués par eux”.
“10° le prix fixé sera remis comme suit, par lettre, à tous les commissionnaires :
“L’agent acheteur aura à sa disposition 2 autos et à une heure convenue à l’avance, probablement de 5 à 7 heures du soir, il fera la tournée de tous les commissionnaires et leur remettra par écrit les prix qu’ils devront payer dans la soirée. Aucune demande de communication de prix ne devra être donnée par téléphone”.
Le Groupement fait preuve d’une grande méfiance, tant à l’égard de ses membres, qu’à l’égard des conserveurs concurrents hors du Groupement.
– Moyens de lutter contre la concurrence :
“9° Si, sur un point, il était nécessaire de lutter contre les acheteurs non adhérents, l’agent des fabricants aurait le droit de faire exceptionnellement une hausse momentanée, étant entendu que toutes les fois qu’il lui sera possible, il devra prendre l’avis du Comité directeur avant d’en arriver à cette extrémité.
Les adhérents qui recevront les pois payés à un cours supérieur du fait de l’alinéa ci-dessus, pourront réclamer à la Caisse du Groupement la différence existant entre le cours établi et le prix réellement payé”.
L’agent unique choisi expose, par une lettre du 9 mai 1914, aux membres du Groupement, la situation sur le terrain : tout d’abord ¡I estime que le “Groupement deviendrait maître du marché à la condition toutefois de n’avoir pas de dissidences appréciables”. Il propose de convaincre non “par la guerre…(qui) coûte cher”, mais par la persuasion, tous les acheteurs de petits pois, y compris “les expéditeurs pour Paris”, à faire partie du Groupement. Le deuxième point sur le terrain, qui ne lui parait pas totalement réglé par la note du Groupement, est celui des rapports des commissionnaires avec le Groupement. Selon lui, il est mauvais que les commissionnaires restent des agents de liaison entre tel conserveur et tel cultivateur. Il faut rompre ces relations individuelles pour établir un ensemble de liaisons impersonnelles :
“Actuellement, les commissionnaires sont, d’une part en butte aux exigences quelquefois exagérées des cultivateurs et, d’autre part, solliciter de façon différente par plusieurs fabricants. Ces conditions défavorables ne peuvent que contribuer à les rendre plus exigeants. Il me semble qu’il y aurait intérêt à ce qu’ils fussent tous à la disposition de votre acheteur unique qui leur indiquerait les transports à faire chez tel ou tel fabricant indistinctement,… Il ne peut être à mon avis question de supprimer brusquement aux commissionnaires les avantages qu’ils ont acquis dans les contrées qu’ils desservent.
“…Il y a donc une situation de fait dont il est prudent et loyal de tenir compte. Mais il me parait nécessaire d’imposer à chacun d’eux un contrat de 3 ans par exemple, aux termes duquel ils seraient assurés du monopole des transports dans une circonscription déterminée sur une carte. En revanche, ils s’engageraient à ne faire aucun transport sur les circonscriptions voisines, ni pour d’autres acheteurs que les membres de votre groupement. Un tel contrat est parfaitement légal. Il permettrait aux commissionnaires de résister avec succès aux exigences exagérées des cultivateurs et de conserver la situation acquise”.
Ainsi, le Groupement se donne les moyens de contrôler totalement les quantités achetées et les prix, par l’intermédiaire d’un agent unique. C’est une entente qui élimine la concurrence, entre les membres du groupe, sur le marché de l’Ouest des petits pois. Cependant, les responsables du Groupement, ne tenaient pas à faire connaître l’existence de cette entente en dehors du milieu même des conserveurs, car par une lettre du 11 mai 1914, il est fourni une copie de la lettre d’avis à envoyer à tous les commissionnaires : “Nous la faisons aussi courte que possible, estimant qu’il n’est pas utile de leur donner de renseignements”.
Cette lettre se présente en effet comme celle d’un conserveur agissant individuellement, et ayant recruté à ce titre un agent pour l’aider dans ses démarches : “Le surcroît de besogne que nous occasionne la saison de fabrication des petits pois nous empêche de suivre utilement les rapports avec nos commissionnaires. Nous avons, pour la campagne 1914, chargé M. ENEAUDEAU de vous faire parvenir chaque jour les instructions concernant les achats à faire pour notre compte, notamment le prix à payer. Monsieur ENEAUDEAU va vous rendre visite ces jours-ci ; vous voudrez bien le considérer comme ayant qualité pour vous demander tous renseignements concernant l’achat des petits pois”.
Nous n’avons pas, pour la suite, de documents nous permettant d’apprécier la manière dont ces mesures s’appliquèrent et ce qu’il advint de cette entente. La guerre fut de toutes façons un coup d’arrêt pour ces productions.
Produire au meilleur coût :
Avant la première guerre mondiale, le souci principal des conserveurs était d’obtenir une production suffisante de petits pois et d’en faire un partage équitable notamment par le biais du contrôle des prix. Dans l’entre- deux-guerres et après 1945, c’est le prix de revient des petits pois qui devint leur souci numéro un.
Après la guerre de 1914-18, il semble que les expéditions de petits pois sur Paris, augmentèrent beaucoup, les cultivateurs y trouvant des prix plus élevés. C’est du moins ce que dit un conférencier de la Direction des Services Agricoles en 1946 [1]. Par ailleurs, les coûts de main-d’oeuvre pour la cueillette et le triage des petits pois devinrent trop élevés, au goût des conserveurs. Dans un numéro du journal d’entreprise, “Vendre AMIEUX” [2], il est expliqué que, devant les difficultés pour trouver une main-d’oeuvre suffisante dans la région nantaise, “cent cinquante à deux cents cueilleurs de plus en plus exigeants, … il fallut se tourner vers d’autres terres de production, le Finistère notamment, où la main-d’oeuvre était plus abondante et les familles nombreuses de 5 à 6 enfants assez répandues”. AMIEUX installa donc une usine de traitement de petits pois à Quimper en 1936. Mais, ce qui apparaît de plus certain, c’est que dans l’entredeux-guerres, la propagande faite par les conserveurs pour l’abandon des pois rames et leur remplacement par les pois pinces, ne porta pas ses fruits ; peutêtre les conserveurs ne poursuivirent-ils pas leurs buts jusqu’au bout. Pour une raison ou une autre, il faut constater qu’en 1946, les cultivateurs de la région nantaise pratiquent toujours la culture des petits pois rames, méthode alors très archaïque et coûteuse : “Pour la conserverie, où il faut atteindre des prix de revient très faibles, il ne peut être question d’employer cette méthode”.
Tandis que la méthode du pois pincé “est pratiquée de longue date dans la région parisienne et en Bretagne”, nous dit le Paysan Nantais [3]. Dans ces conditions, il est évident que cette culture maraîchère, sur petites parcelles, peu mécanisable, devait avoir des coûts de production beaucoup plus élevés que dans d’autres régions.
[1] Conférence de M. BITEAU dans le journal Le Paysan Nantais du 12.01.1946 – Archives du CDMOT.
[2] “Vendre AMIEUX” n° 2-3 – septembre-décembre 1960 – Archives privées.
[3] Le Paysan Nantais – 12.01.1946 – Archives CDMOT.
Dans le Paysan Nantais du 26 janvier 1946, un article sur la culture des petits pois pour la conserve, se termine par une mise en garde des cultivateurs : “Du côté des industriels conserveurs, il y a une volonté évidente de reprendre et de poursuivre la fabrication. Ils continueront à travailler avec les cultivateurs de la région si tant est que ceux-ci veuillent bien reprendre la culture sur une échelle suffisante. Sinon ils s’adresseront ailleurs, ce qui peut être pour nous, cultivateurs, un manque à gagner, et pour les ouvriers, employés dans les usines, un handicap sur leur travail”.
C’est la Direction des Services Agricoles, sans doute encouragée par les conserveurs – à moins que ce ne soit à leur demande – qui reprit en 1946, une action de propagation de nouvelles méthodes de cultures, par le moyen de conférences dans les communes du sud de la Loire, jusqu’en Vendée et dans le Maine et Loire. En outre, pour les cultivateurs de ces communes [1], les fabriquants de conserves de Nantes organisèrent des visites, dans le Finistère (régions de Rosporden, Scaer, Banalec et de Coray), de cultures de petits pois à grande échelle.
En fait, la région Sud-Loire ne suffira pas pour approvisionner les conserveries nantaises en petits pois. Dans le Conseil d’Administration d’AMIEUX [2] d’avril 1954, on constate que 22 % seulement des petits pois traités par cette société, viennent des régions du Sud de la Loire, le reste étant produit en Bretagne : “Les nouvelles régions [3] ont été sollicitées sur ce total (prévisions de 2.300 tonnes) pour : 500 tonnes dont 350 à 400 tonnes en pois battus. Pour la région du Morbihan, 600 tonnes pois en gousses travaillées par Chantenay.
Finistère : 600 tonnes également en gousses traitées à Chantenay – Saint- Guénolé, 600 tonnes à travailler sur place, en grains issus des batteuses que nous installons”. Pour les prévisions d’avril 1956 [4] “le programme envisagé (en petits pois) est de l’ordre de 2.000 à 2.500 tonnes, la moitié étant fournie par les cultivateurs du Sud de la Loire qui ont été approvisionnés par nos soins en semences, l’autre moitié provenant de Bretagne”.
[1] Le Paysan Nantais – 3 août 1946 – CDMOT.
[2] Archives AMIEUX – La CANA – Ancenis.
[3] Définies dans le Conseil d’Administration du 10 décembre 1953 : “Les régions Sud de la Loire, proches par conséquent de notre usine principale”.
[4] CA. AMIEUX – 11 avril 1956.
Cependant progressivement, la Bretagne comme la région du Sud-Loire, seront fortement concurrencées pour la production de légumes de conserverie, et plus spécialement les petits pois, par les régions situées au Nord de Paris. En 1952, le Finistère seul fournissait 53 % de la production nationale de petits pois. Dix ans plus tard, en 1962, il n’en fournissait même plus le quart (24 %) [1]. Pour les haricots verts classiques, le même phénomène s’est produit : en 1952, le Finistère produisait 36 % de la production nationale, et en 1964, il n’en fournissait plus que 9 %.
Pour 1966 [2]
PETITS POIS %
Picardie et Haute Normandie 49 %
Bretagne 22 %
Nord 16 %
Ile de France 6 %
Centre 3 %
Pays de Loire 2,5 %
Autres régions 1,5 %
Les raisons de ce déclin tiennent essentiellement à la différence de taille des exploitations. Dans un numéro de Nantes-Réalité [3] de 1965, la nécessité d’organisation des rapports entre agriculteurs et conserveurs, est soulignée “d’autant plus que la production des légumes dans notre région s’effectue dans de très nombreuses exploitations agricoles de faible importance, alors que les principales régions de production situées au nord de Paris sont constituées, au contraire, de grandes unités d’exploitation bénéficiant de prix de revient moins élevé et d’une rentabilité meilleure à l’hectare et offrant à l’industrie les avantages d’une organisation plus simple et moins coûteuse”.
[1] Rapport de M. COUGAL, contrôleur du Travail : Evolution de l’emploi et des conditions de travail dans l’industrie de la conserve du Sud-Finistère – mai 1965 – Ronéo – 20 p.
[2] Les Nouvelles des Forges – n° 50 – 3/1969.
[3] Nantes-Réalité – n° 5 – février 1965 – Archives Départementales de Loire Atlantique.
Dans son rapport sur l’emploi dans les conserveries du Finistère; M. COUGAL [1] donne des détails sur la taille de ces exploitations bretonnes : “Ici, les parcelles ensemencées en pois vont de quelques ares à 2 ou 3 hectares, rarement plus. En 1964, les usines du département ont travaillé la récolte de 7.500 producteurs par l’intermédiaire de 200 courtiers. Il en résulte des déplacements anarchiques de batteuses et de véhicules transportant les pois en grains aux usines. Dans le nord, les exploitations sont plus importantes, donc moins nombreuses et ont bénéficié d’installations préexistantes. La solution des problèmes de planification y a été plus facile, ce qui a permis de mieux étaler la récolte par l’emploi de variétés précoces et tardives… Les prix de revient sont plus favorables. Il n’y a pas de courtiers, les transports sont plus réduits et le battage effectué par le récoltant et à ses frais”.
Pour les zones du sud de la Loire, la diminution du nombre de producteurs est aussi importante. Le syndicat des Producteurs de légumes de conserve de Loire et Sèvre [2] indique qu’en 1972, il regroupait environ 1.100 contrats de producteurs de pois et 425 de flageolets. “La totalité de la production de légumes de conserve de la région est traitée par la conserverie nantaise”. Or un article de Presse-Océan3 donne pour 1963, le chiffre de 2.550 contrats de producteurs de petits pois, soit plus du double 10 ans plus tôt ; et pour 1974, chute vertigineuse, il n’y aurait plus eu que 350 contrats, ce qui correspondrait à une diminution de plus des 2/3 des exploitations traitant ce légume.
Cependant toutes les productions de légumes de la région nantaise ne furent pas en déclin. La culture du céleri notamment, qui est restée une culture maraîchère, fournissait en 1965 la moitié de la production nationale [4]. La culture du flageolet se développa également de façon importante, dans cette région du sud de la Loire, surtout vers la Vendée.
[1] M. COUGAL – rapport cité – p. 5.
[2] Archives FDSEA – Section légumes de plein champ – CDMOT – Bte 190.
[3] Presse-Océan – 12-13 octobre 1974 – Archives CDMOT – Bte 190.
[4] Nantes-Réalité – n° 5 – Février 1965 – Archives Départementales de Loire Atlantique.
Un des problèmes qu’ont dû résoudre au meilleur coût, les conserveurs de la région nantaise, par rapport à la culture du petit pois, à été celui de la cueillette. Jusqu’au lendemain de la deuxième guerre mondiale, ce travail se faisait à la main, c’est à dire que les gousses étaient enlevées une par une des tiges (égoussage). C’était un travail long et demandant beaucoup de maind’oeuvre.
Dans le Paysan Nantais du 14 septembre 1946, nous avons une description de ce travail tel qu’il se pratiquait alors dans le Finistère :
“L’enlèvement des gousses est fait directement à la main, sur le champ, par les vieillards, les femmes et les enfants des écoles, après la classe et pendant les vacances. Il n’est pas rare de voir 100, 200 et même 300 personnes sur le même champ. Les pois sont arrachés, retournés et les gousses enlevées très rapidement. Les fanes sont rejetées ensuite derrière le cueilleur. Ainsi, selon le personnel employé, appelé à son de trompe dans le village quand les pois sont mûrs, un champ de plusieurs hectares est-il vivement “nettoyé”. Les gousses sont mises en sac sur le champ et transportées dans la journée par camions, à l’usine. Les cueilleurs sont payés aux pièces, au kilo et immédiatement après la récolte. De plus, ils ont droit à une soupe chaude servie le midi par le fermier.
Les cueilleurs qui font 100 kilos dans leur journée ne sont pas rares et on a vu des femmes, très entraînées, faire 150 kilos dans une journée évidemment bien remplie”. Cependant, cette méthode, égoussage à la main mais directement sur le champ, est déjà un progrès par rapport à la méthode employée dans la région nantaise, où il y a d’abord un temps d’arrachage des pois, puis transport dans des familles où se fait alors l’égoussage.
Cependant, en 1945-46 commence à être utilisé dans le Finistère une “machin à égrainer”. “Dans cette machine, construite sur le thème des écosseuses dans les usines, les pois sont enfournés entièrement avec leur fanes, et à l’autre bout le grain sort d’un côté et les fanes de l’autre. Cette machine fut l’objet d’une attention très soutenue de la part de nos cultivateurs, pour qui c’était quelque chose de nouveau” [1]. En fait, il existait déjà avant la guerre de 14, sur le marché français “une machine pour écosser les pois avec les tiges”. C’était une machine venant des U.S.A., vendue en France sous le nom de “écosseuse La Viner”, dont la marque était SHISHOLM-SCOTT et Cie. “Cette machine qui produit environ deux fois le travail d’une machine ordinaire, économise la main-d’oeuvre de la cueille sur champs, son travail est parfait”, dit la publicité qui la présente dans La Conserve Alimentaire de février 1912. Une machine semblable était construite en France, dans l’entre-deux-guerre par le constructeur P. NAVARRE et Fils [2]. Le numéro de février 1912 de La Conserve Alimentaire consacre un article à l’industrie américaine des conserves, notamment des petits pois ; l’auteur y expose les avantages des machines Viner’s : “Depuis l’invention des Machines Viner’s, c’est à dire les écosseuses travaillant les ramures fauchées et les cosses, un des points principaux, le point noir de l’agriculteur, qui consiste à trouver pendant le peu de temps que dure la récolte le personnel suffisant pour ramasser les cosses, n’existe plus. Cela a fait une révolution dans la culture. Les variétés de pois nains ou demi-nains sont alors préférés, les semailles d’automne profitent mieux, la date de la récolte est avancée de près de vingt jours ; la quantité est doublée, triplée ou sextuplée, ce qui permet de faire la cueillette à la faucheuse.
Le battage des ramilles a encore cet avantage d’éviter plus longtemps la fermentation du pois, les cosses étant moins tassées et la fraîcheur des ramilles entretient pendant quelques heures la sève des cosses… La batteuse-écosseuse se trouve dans le champ même, elle suit chaque jour les faucheuses et suivant les avis de l’usine, elle ralentit ou accélère l’écossage… Voici donc la base du système. C’est un nouvel entraînement à faire comprendre à nos fermiers, mais qui ne peut se faire que sur de vastes plaines, où les semeuses, les faucheuses pourront fonctionner”. Or cet impératif, pour l’utilisation de la batteuse, de grandes surfaces à cultiver, était alors tout à fait contradictoire avec la réalité des exploitations agricoles de la région nantaises et de Bretagne, très morcelées.
[1] Le Paysan Nantais – 14 septembre 1946 – Archives CDMOT.
[2] Encyclopédie illustrée des Grandes Inventions Modernes – Tome 1 – Union Latine d’éditions Paris – sans date – probablement entre 1920 et 1930 – p. 257.
Lorsque ces batteuses commencent à être utilisées dans le Finistère, après la seconde guerre mondiale, agriculteurs et conserveurs y trouvent d’abord de nombreux inconvénients. Les cultivateurs estiment que “le rendement est inférieur avec l’emploi de la machine” ; “seules les cosses à maturité sont vidées et les grains fins et très fins des cosses moins avancés ne passent pas, ce qui se traduit par un rendement plus faible en grains, en quantité et en qualité, qu’avec le ramassage à la main”1. Autre inconvénient aux yeux des cultivateurs : les fanes et cosses des petits pois, qu’ils avaient l’habitude d’utiliser comme fourrage ou litière, sont pulvérisées par la machine, et ne peuvent plus servir que d’engrais.
Enfin, il trouvent que le travail reste assez important : “Le pois doit être fauché, chargé sur les charrettes et transporté par les soins du fermier jusqu’à la machine, et même enfourné par lui… Il a de nombreux transports à effectuer, surtout lorsque la machine se trouve un peu loin”. Finalement conclut cet article du Paysan Nantais, le cultivateur “préfère chaque fois que cela lui est possible, faire effectuer l’égoussage à la main. Ce n’est que dans le cas où la main-d’oeuvre lui fait défaut qu’il a recours à la machine”.
Les conserveurs ne semblent pas non plus très satisfaits de cette batteuse : comme les fanes et les cosses sont hachées par la machine, “les grains de pois sont accompagnés de particules de fanes et de cosses et demandent ensuite un sérieux nettoyage à l’usine”. De plus, les pois “sont tous gros ou moyens, jamais fins ou surfins, et comme ils fermentent très facilement, (le conserveur) doit les utiliser dans les 2 heures qui suivent le battage. Le manque de qualité est surtout le gros écueil, si bien que les conserveurs ont envisagé la possibilité d’accorder une plus-value aux pois récoltés à la main”2. On arrive là à ce paradoxe – peut-être n’est-il que le résultat d’une mauvaise compréhension du problème de la part du journal – que les conserveurs auraient,yd’une part, acheté des batteuses pour réduire les frais de cueillette et donc le prix de revient des pois, et d’autre part, auraient payé une sorte de prime aux cultivateurs qui n’utilisaient pas la batteuse.
1 Le Paysan Nantais – 14 septembre 1946 – Archives CDMOT.
2 Le Paysan Nantais – 14 septembre 1946 – Archives CDMOT.
Il est certain que ces batteuses ne furent réellement employées qu’après quelques années. Chez AMIEUX, c’est “depuis 1953, (qu’) on emploie sur le champ une machine étonnante, créée en 1945, la batteuse Fouché. Cette machine appartient au conserveur qui s’occupe entièrement de son fonctionnement et de son entretien [1]. Il avait fallu 7 ou 8 ans pour que ce conserveur trouve des avantages à l’utilisation de cette machine. Il s’agit d’ailleurs là d’une batteuse construite en France, donc peut-être un peu différente des premières. De plus, les agriculteurs fournisseurs de pois, passant à une culture plus systématique du petit pois, sur de plus grandes surfaces, il devenait sans doute plus avantageux d’utiliser la batteuse. Par ailleurs, il faut noter que les batteuses ont du amener, indirectement, les agriculteurs à abandonner la culture sur sillons, qui les obligeait à faire le fauchage à la faux, pour la culture à plat, permettant l’utilisation de la faucheuse. La batteuse ayant une grande capacité de travail, il fallait l’alimenter rapidement. Cependant chez AMIEUX, et sans doute dans d’autres conserveries également, il arriva encore à côté des pois battus – donc en grains – des pois en gousses, non passés dans la batteuse. Cela tenait essentiellement à la provenance des petits pois : les petits pois en grains, doivent être traités dans les 2 ou 3 heures pour ne pas fermenter; aussi n’étaient battus, mis en grains, que les pois transportables à l’usine dans un court laps de temps, c’est à dire les pois de la région du Sud de la Loire, pour les usines de Nantes. Les pois provenant du Finistère et du Morbihan arrivèrent toujours en gousses à Nantes, la gousse conservant une certaine humidité et fraîcheur au grain pendant quelque temps.
Ces batteuses étaient des machines fixes, qui étaient déplacées d’une zone agricole à une autre. Les cultivateurs avaient en charge de faucher les pois et de les transporter à la batteuse que Pon mettait le plus près possible de chez le courtier, parce qu’il avait le téléphone” [2]. A partir de là, c’était le conserveur, par l’intermédiaire de ses courtiers, qui prenait en charge les petits pois et les faisait transporter par ses propres camions, ou des camions loués. En décembre 1953, dans le Conseil d’Administration d’AMIEUX, nous trouvons les prévisions d’utilisation au maximum des batteuses : “La récolte au Sud de la Loire étant plus précoce que la production bretonne, nous avons le projet de transférer dès la fin de la récolte nantaise, deux batteuses en Bretagne, à proximité de notre usine de Saint-Guénolé. Celle-ci, à son tour, fera le même travail que Chantenay, plus réduit naturellement et, ainsi, nous aurons la possibilité d’amortir deux fois plus vite que nos confrères les batteuses que nous aurons fait travailler deux plus de temps, et nous assurerons à nos installations un approvisionnement plus large, entraînant des prix de revient meilleurs”.
[1] Vendre AMIEUX n° 2-3 – Septembre-décembre 1960. Archives privées.
[2] Entretien avec un représentant AMIEUX auprès des cultivateurs
Les perfectionnements techniques sur les batteuses donnèrent des moissonneuses-batteuses qui, comme leur nom l’indique, faisait aussi bien la moisson des pois que le battage. C’était encore un matériel qui, dans les régions de Loire, Sud-Loire, Bretagne, appartenait aux conserveurs, vu le coût important de ces machines par rapport à la taille des exploitations. D’ailleurs les conserveurs ne s’équipèrent pas entièrement avec ces moissonneuses- batteuses et continuèrent à utiliser des batteuses fixes. Chez AMIEUX, il semble qu’il n’y ait eu que des batteuses fixes, le fauchage se faisant avec une faucheuse ordinaire. “CASSEGRAIN, les Maraîchers Nantais, s’étaient par contre équipés des batteuses mobiles” [1] . Dans un article de Presse-Océan du 12-13 octobre 1974, il est indiqué que dans la région nantaise, “les 3/4 des petits pois sont récoltés à la ramasseuse-batteuse, et le dernier quart passe dans une batteuse fixe”. Les batteuses fixes furent également employées pour les flageolets, en tout cas pour les récoltes d’AMIEUX, à partir des années 1958-59″ [1]
[1] Voir note précédente.
Produire au meilleur rythme pour le fonctionnement des conserveries :
“Le conserveur a intérêt à ce que la campagne soit la plus longue possible , et, pendant toute la campagne, il faut une production régulière”[1]. Cette idée de pouvoir régulariser les récoltes de petits pois, n’atteint un début de réalisation qu’à partir des années 30. Jusque-là les conserveurs devaient rechercher, d’une zone de culture à l’autre dans la limite des contraintes de transport – les quantités de pois pouvant leur assurer un fonctionnement pas trop Inégal pendant la saison. SI l’on prend la petite conserverie ALBERT, dans la période où elle a fabriqué des conserves de petits pois, entre 1907 et 1914, on voit à travers des carnets notant au jour le jour les fabrications réalisées, qu’il y a eu des durées de campagne très variables, allant de 74 jours pour la plus longue, en 1912, à 8 jours en 1908. Mais de plus, à l’intérieur de ces campagnes, le nombre de jours travaillés est tout à fait fluctuant : en 1912, sur les 74 jours de campagne, il n’y a que 24 jours de travail pour la conserverie, c’est à dire qu’il y a de très nombreuses journées sans arrivage de petits pois, et encore en 1912, la Conserverie ALBERT s’est fournie à la fois chez des agriculteurs de la région nantaise et chez d’autres en Bretagne.
[1] Les Nouvelles des Forges – n° 49 – 2/1969 : “Une campagne de conserves de légumes”.
Les efforts de régularisation du rythme des récoltes ont d’abord porté sur le choix de variétés de graines, plus ou moins précoces ou tardives, afin d’allonger le plus possible la campagne, ce qui permet du même coup aux usines de traiter de plus grandes quantités de pois, et aux cultivateurs, d’ensemencer de plus grandes surfaces pour accroître leurs productions.
Dans le Paysan Nantais du 7 février 1948, sont donnés des résultats d’expériences de cultures de pois, fait par la Maison CASSEGRAIN, “afin de comparer les variétés et les méthodes de culture”. Il faut dire au passage, que ce type d’expérimentation faite par les conserveurs, était courante et se pratiquait depuis le début du siècle. Généralement les conserveurs cherchaient des cultivateurs volontaires pour prêter quelques terres pour l’expérimentation, moyennant une indemnisation. On trouve ce mode de contrat, en 1964 dans le compte-rendu d’une réunion interprofessionnelle entre les producteurs de légumes et les conserveurs [1]. Il s’agit “d’organiser des expériences, en particulier de culture, sur différentes parcelles de terrain situés en Loire-Atlantique, en Vendée, et en Maine-et-Loire, les producteurs qui ont accepté ces expériences sur leurs terres seront indemnisés en conséquence”.
[1] 1 Archives CDMOT
Les expériences faites en 1948 par CASSEGRAIN, donnent un classement de 4 variétés, allant d’un pois hâtif , le “caractacus”, à un pois tardif, “serpette amélioré”, en passant par 2 espèces, demi-hâtive, “le 42 de Sarcelles”, et demi-tardive, “le roi des conserves”. Les conserveurs faisaient ces expérimentations pour fournir ensuite aux cultivateurs avec lesquels ils passaient des contrats, les semences qu’ils voulaient voir employées. Par le compte-rendu d’une réunion de délégués communaux des producteurs de petits pois [1] on apprend que les conserveurs utilisaient un nombre plus ou moins grand de variétés de semences. En 1965, “CASSEGRAIN réduit à 5 le nombre des variétés. AMIEUX à 3, le GRAAL, plusieurs variétés ; les Maraîchers Nantais, probablement 6”.
Les semences fournies par les conserveurs, par l’intermédiaire de courtiers, étaient payés par les agriculteurs. Le prix en était fixé au cours des réunions interprofessionnelles annuelles entre délégués des agriculteurs et conserveurs. Il s’agissait donc d’un prix unique pour toutes les semences et pour tous les agriculteurs : réunion du 6 mars 1964 : “Le prix de rétrocession des semences de petits pois aux cultivateurs, a été fixé d’un commun accord à 2 francs le kilo pour 1964”. Réunion du 17 février 1967 : “Semences MJ.DEWERPE estime qu’en ce qui concerne la Maison AMIEUX, le prix de revient des semences devrait être majoré cette année de 0,20 F à 0,25 F le kilo… Après discussion, Monsieur BILLAUD (président du Syndicat des Producteurs de légumes de conserverie de Loire et Sèvre) pense que les Producteurs peuvent faire confiance aux conserveurs qui ne demandent qu’à retrouver leurs prix d’achat des semences, sans idée de bénéfice”.
Programme de production, prix des semences, prix des pois en fonction des qualités, conditions de paiement des agriculteurs par les conserveurs, toutes ces questions faisaient l’objet de discussions entre syndicat des producteurs de légumes et conserveurs, lors des réunions annuelles, tenues avant le printemps, c’est à dire avant le début des semis. Au niveau national existe également une organisation des rapports entre syndicats des producteurs de légumes et syndicat des fabricants de conserves de légumes. Un contrat-type national est signé entre ces deux organismes, “afin d’orienter la production vers la culture de variétés bien définies et de garantir l’absorption de la récolte à un prix préalablement fixé… Il s’agit d’obtenir une organisation du marché, pour éviter les désordres graves de la surproduction et de l’anarchie des prix”[1].
[1] Nantes-Réalité – n°5 – février 1965 – Archives Départementales de Loire Atlantique.
Au niveau régional était créé en 1963, un “Comité technique de vulgarisation” pour la production de légumes de plein champ destinés à la conserverie, composé à la fois de délégués des producteurs, un représentant par usine, plus, comme membre de droit, le président du syndicat de Producteurs de légumes, et de délégués conserveurs, plus un représentant de la Chambre d’Agriculture, un du Service de Protection de végétaux et un de la Direction des Services Agricoles.
En dehors de ces réunions interprofessionnelles qui réglementaient les conditions du marché, les rapports entre agriculteurs et conserveurs passaient par une organisation propre à chaque conserverie, et reposant sur un ensemble de courtiers, répartis dans toute la région productrice. Toute la planification des ensemencements et des récoltes, afin d’étaler la campagne de légumes, et de petits pois plus particulièrement, passait par les courtiers, euxmêmes contrôlés par un représentant de la conserverie.
Chez AMIEUX, il y avait, dans les années 50-60, 8 courtiers pour toute la zone située au sud de la Loire. Les courtiers étaient souvent eux-mêmes des marchands d’engrais. Ils connaissaient ainsi les agriculteurs, et par le biais de ces relations, établissaient leur réseau de cultivateurs-clients-producteurs pour une conserverie. En principe un courtier ne travaillait que pour une seule conserverie. Par contre, un cultivateur pouvait être producteur pour plusieurs conserveries. Si, en raison de la prévision globale de production d’une conserverie, un cultivateur ne recevait pas d’un courtier, la quantité de semences souhaitées, il pouvait s’adresser à un autre courtier, donc une autre conserverie, pour obtenir un complément de semences, dans la limite des quantités globales prévues là aussi pour cette autre conserverie.
Chaque courtier distribuait dans son réseau la quantité de semences correspondant au nombre d’hectares prévus, répartis chez plusieurs cultivateurs. Une carte était remplie pour chacun d’eux, indiquant les variétés fournies, les quantités, et les dates de semis. “Si bien qu’en reprenant toutes les cartes, on pouvait un peu prévoir nos étalements de récolte ; on donnait des variétés hâtives, semi-hâtives et tardives. Mais en fait tout dépendait du temps.
Tous nos rapports se terminaient… suivant le temps et les températures…” [1]. C’étaient les courtiers sur ordre du représentant, qui donnaient le feu vert pour les semis, à chaque cultivateur. Les dates des semis dépendaient des variétés, mais également des terrains, de leur état : “Il y avait des régions où on pouvait commencer très tôt ; les terres étaient vite reessuyées. Mais il y en avait d’autres, du côté de Machecoul, qui étaient boueux très tard. Du côté du lac de Grand-Lieu, il y avait des terrains faciles à travailler, c’étaient les premiers qui commençaient [2]. Pour être sûrs de bien contrôler ces dates de semis, “on donnait les semences au dernier moment. On essayait de les (les cultivateurs) arrêter quelquefois pour commencer à semer ; pour ne pas avoir à battre de petites quantités ; pour battre en gros. On aimait mieux marcher à plein tube que de végéter, parce que ça nous empêchait de faire d’autres fabrications”.[3]
[1] Entretien avec un représentant d’AMIEUX auprès des cultivateurs.
[2] Voir note précédente.
[3] Voir note précédente
Les récoltes étaient faites au fur et à mesure de la maturité des pois, donc étalées en fonction des dates de semis ; mais elles étaient aussi dépendantes, dans une certaine mesure, des possibilités de battage. Il y avait, pour une conserverie, un nombre fixe de batteuses (9 batteuses chez AMIEUX, 9 ou 10 chez CASSEGRAIN, et autant chez les Maraîchers Nantais). Il était nécessaire de prévoir un plan de battage, ou du moins d’organiser un peu à l’avance, les tours de rôle des différents agriculteurs. “Le courtier devait nous fournir 24 heures à l’avance, la liste des clients qu’il avait à passer, et la quantité, de manière qu’on puisse aussi prévoir à l’usine pour embaucher le personnel”, dit le représentant d’AMIEUX. Les cultivateurs amenaient leurs récoltes à la batteuse ; suivant l’emplacement de celle-ci, les cultivateurs avaient plus ou moins de trajet à faire. Dans une enquête 1] menée par le Syndicat des Producteurs de Légumes de conserves de Loire et Sèvre, en 1971, auprès des agriculteurs, on voit soulevé par ces derniers, le problème du battage : “plusieurs réponses soulignent les difficultés du fait de… l’incapacité des conserveries à accepter les tonnages présentés : les batteuses n’ont pas suivi le travail prévu, n’ayant pas de matériel nécessaire”, plainte émanant de Saint-Macaire en Mauges. Pour le battage des flageolets, on retrouve des plaintes concernant la distance jusqu’à la batteuse :
“Les producteurs d’une région excentrée (Machecoul), reprochent la distance pour le battage… Les producteurs de Saint-Macaire en Mauges voudraient une batteuse sur place”. Au cours des années d’assez forte chaleur, qui pouvait amener les pois à mûrissement en 24 ou 48 h, (ce qui fut semble-t-il le cas de 1971) il pouvait en effet y avoir “pagaille à la batteuse” [2]. Cependant, les cultivateurs essayaient aussi de régler par eux-mêmes et à leur manière, les problèmes de battage : “Si le jour où leurs petits pois étaient bons, CASSEGRAIN, par exemple, pouvait pas les passer, ils les ramenaient chez nous. On pouvait pas contrôler, il aurait fallu avoir le plan des champs ; ça pouvait se reconnaître quelquefois aux grains” [3].
Le battage se faisait surtout la nuit, d’une part pour éviter que, par la chaleur, les petits pois ne fermentent, et d’autre part pour approvisionner les usines dès le matin, avec des arrivages de pois frais à traiter immédiatement.
“Les batteuses commençaient quelquefois à 10 heures le soir, quand on aurait du commencer à minuit. Mais on était plus sûr la nuit, et on essayait de finir à midi, surtout quand il faisait vraiment chaud. A 5 heures, il fallait qu’il y ait de la marchandise pour commencer. Les cultivateurs fauchaient et laissaient pendant une demi-journée sur le terrain. C’est pour ça, quand les pois étaient coupés, les cultivateurs avaient peur d’un coup de feu. Il valait mieux les laisser sur pied que de les couper. Ils les chargeaient au dernier moment” [4].
[1] “Enquête faisant suite à la campagne 1971, et réalisée près des délégués communaux pois et flageolets” – Oct. 1971 – Archives CDMOT.
[2] Voir note précédente.
[3] Entretien avec un représentant d’AMIEUX auprès des cultivateurs.
[4] Entretien avec un représentant. Déjà cité.
Ce n’est pas seulement au niveau de la saison, que l’usine tend à imposer son rythme aux cultures, mais aussi d’une année à l’autre. En effet, selon la vente plus ou moins importante des conserves, selon l’état des stocks, les conserveries décident chaque année de traiter des quantités déterminées de légumes.
En fait, il semble que ce soit que sous la pression d’interventions gouvernementales, à partir de 1960, que des décisions communes des conserveurs aient été prises par rapport aux quantités globales à produire. Dans le Conseil d’Administration d’AMIEUX, du 27 juillet 1960, est présentée “l’orientation gouvernementale” : “A la suite des plaintes des agriculteurs, le gouvernement s’est soudainement vivement intéressé à la profession des conserveurs. Après une longue enquête, il estime que la Conserve sous sa forme actuelle, est inorganisée et incapable de collaborer avec l’agriculture.
L’administration envisage de participer à la création d’importantes usines, concentrées dans les zones agricoles, qui pourraient prendre la forme coopérative…”. C’est à la fois la production agricole et la production de conserves, débouché important de l’agriculture, que le Gouvernement de l’époque souhaite organiser et moderniser. Il semble en effet que jusque là, la concurrence des conserveurs entre eux, par rapport au marché agricole, avait créé une totale anarchie des prix agricoles et des quantités produites. Dans le Conseil d’Administration d’AMIEUX, du 8 décembre 1959, on trouve des traces de cette concurrence implacable :
“Le Président déclare au Conseil que nous avons failli avoir des ennuis avec les courtiers et les cultivateurs de petits pois, à la suite de l’intervention de nos confrères dans la zone réorganisée par nous. Les prix payés par nos concurrents aux courtiers et aux récoltants ont, en effet, été nettement plus élevés que ceux que nous avions nous-mêmes décidé d’accorder. En principe, notre société consent à la production de la Vallée de la Loire 10 à 15 % de prime sur celle des régions de production autres, Bretagne, Nord, Aisne, Oise. Nous avons eu à enregistrer de nombreuses réclamations de la part de nos courtiers et de cultivateurs. Des délégués sont venus à plusieurs reprises nous trouver, sollicitant une révision de nos conditions. Nous avons toujours refusé, estimant payer un juste prix. Nous ne devions pas tenir compte de l’effort concurrentiel de nos confrères, seulement destiné à provoquer des troubles dans les régions qui semblaient sous notre coupe depuis plusieurs années”. Le marché national des conserves de petits pois est finalement surchargé de produits qui n’arrivent pas à être vendus. Même l’exportation ne peut absorber ces stocks. semblaient sous notre coupe depuis plusieurs années”. Le marché national des conserves de petits pois est finalement surchargé de produits qui n’arrivent pas à être vendus. Même l’exportation ne peut absorber ces stocks.
En 1961, “Une convention nationale, acceptée par les industriels et les agriculteurs, a prévu que les semis de petits pois ne pourraient être supérieurs à 88 % de la moyenne des trois années précédentes, de manière à éviter une production excessive. L’application d’une pénalisation est prévue contre les conserveurs qui auront dépassé ce quota. Il semble que de nombreux industriels vont être obligés de payer des pénalités à un Centre créé en accord avec l’administration. Les sommes issues de ces paiements seront consacrées à une publicité nationale en faveur des conserves de petits pois”[1]
C’est sans doute là l’origine des contrats nationaux et régionaux que nous trouvons ensuite réglant certains points des rapports entre conserveurs et producteurs (quantités produites, prix e t c . ) . Ces contrats reposent désormais sur des décisions communes des conserveurs, et des discussions entre organisations syndicales de conserveurs et de producteurs de légumes. Cependant, cette organisation ne règle pas tous les problèmes, surtout pour les agriculteurs.
Dans le compte-rendu [2] de la réunion interprofessionnelle de mars 1968 entre délégués de producteurs de légumes et conserveurs, M. A. GARNIER, Président du Syndicat des Conserveurs, signale que “les programmes de production seront dans l’ensemble à peu près équivalents à ceux de 1967, avec cependant quelques variantes pour certaines Maisons, les diminutions chez certains conserveurs, notamment en flageolets, étant compensées par des augmentations chez d’autres conserveurs. M. A. GARNIER précise, à la suite d’une remarque de M. BiLLAUD, qu’il n’existe pas d’engagement quantitatif global ou individuel durant la période triennale. Les fluctuations commerciales obligent en effet les conserveurs à faire le point tous les ans et à ajuster en conséquence leur programme”. Ainsi, d’une année sur l’autre, les cultivateurs ne sont pas assurés des surfaces qu’il vont pouvoir ensemencer en tel ou tel légume.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
[1] Compte-rendu du Conseil d’Administration d’AMIEUX – 4 oct. 1961 – Archives AMIEUX – La CANA Ancenis.
[2] Archives CDMOT.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
De plus, comme dans les contrats, les quantités fixées par les conserveurs, sont définies en tonnage, les conserveurs “peuvent refuser les excédents, ou les payer plus tard”[1], pour les années de fort rendement à l’hectare. C’est le contenu du contrat national de 1965, sur lequel s’appuient les décisions prises régionalement.
Finalement pour ce contrat, “il est admis un tonnage moyen de 3,5 tonnes hectare, avec admission d’un surplus de 15 % payable par moitié, 50 % au 31 janvier 1966 et 50 % au 31 mars 1966”. Lors d’une réunion entre délégués de producteurs, en février 1965, un délégué proposait “l’éventualité d’un contrat pour 5 ans par exemple, ce qui permettrait d’avoir une sécurité en ce qui concerne les investissements de matériel”.
Produire certaines qualités :
Dans un numéro de Nantes-Réalité [2], André GARNIER, de la Société CASSEGRAIN-SAUPIQUET expose les avantages de la production de petits pois des régions nantaises et bretonnes par rapport aux régions du nord de la France :
“Pour certains légumes, comme le petit pois, … les multiples exploitations agricoles nantaises et bretonnes, disséminées et morcelées, sont en concurrence directe avec la grande culture picarde et ses hauts rendements. Elles ne doivent leur salut qu’à la finesse de leurs produits et aux accords interprofessionnels par lesquels sont précisés, avant chaque campagne, selon des normes, les prix variables en fonction de la qualité. L’effort pour l’agriculteur n’est pas seulement de se lier par contrat, mais bien d’exécuter les termes de ce dernier lorsque les conditions fixées se trouvent, au moment de la récolte, moins favorables que celles du marché libre. C’est alors que la discipline syndicale a son rôle à jouer”.
[1] Réunion des Délégués Communaux “petits pois” – 12 février 1965 – Archives F.D.S.E.A. – CDMOT.
[2] Nantes-Réalité – n°19 – Février 1968 – Archives Départementales de Loire-Atlantique.
La qualité des petits pois, appréciée en fonction de plusieurs critères, dont certains sont assez exactement mesurables, détermine les prix payés aux cultivateurs. Le premier critère de qualité tient à la grosseur du petit pois, qui permet de le classer en 2 ou 3 cribles, c’est-à-dire 2 ou 3 grosseurs. La tendreté du grain est un deuxième critère: “Pour avoir des graines tendres, il faut que la maturité ne soit pas trop avancée. Les pois trop mûrs présentent de graves défauts : ils sont généralement durs, leur goût est farineux, souvent amer ; dans la boîte, ils se gonflent de jus et on retrouve des pois de calibre supérieur à celui indiqué sur l’étiquette ; le jus est trouble et ils sont toujours plus hétérogènes”[1].
La couleur des graines est encore un autre critère : “On recherche des pois qui, après cuisson, sont d’un vert tendre et uniforme. Il faut donc des pois jeunes, à semences vertes (car elles donnent moins de pois jaunes) et éviter les mélanges pour garder une couleur uniforme”[2].
En même temps qu’ils se sont préoccupés de l’étalement des récoltes et de l’allongement de la campagne, les conserveurs ont cherché à utiliser des variétés qui amélioreraient la qualité des pois. Chaque conserveur restait libre du choix de ses variétés. Après la seconde guerre mondiale, en tous cas, les conserveurs se mirent à rechercher surtout les qualités fines de pois. Pour la production de la Région Nantaise, en 1963, les pois fins représentaient 27 %, en 1974 ils représentaient 83 % de cette production régionale qui cependant dans le même temps avait diminuée de moitié en tonnage (elle était passée de 4.000 t à 2.000 t). Le Conseiller technique du Comité de vulgarisation pour les légumes de plein champ, M. BOUREAU, déclarait d’ailleurs à l’époque [3] : “On ne peut que déplorer le gâchis entraîné actuellement par la recherche de la qualité. Il ne faut pas oublier que le battage de pois de petites tailles implique inévitablement une diminution des rendements. Dans la pratique, les pois les plus petits seront distribués dans le commerce sous les dénominations “extra-fins” ou “très-fins”.
Quant aux gros, on pourra lire sur les boîtes, “fins” ou “moyens”.
[1] Les Nouvelles des Forges – n° 49 – 2/1969 : “Une campagne de conserves de légumes”.
[2] Voir note précédente.
[3] Presse-Océan – 12-13 octobre 1974.
Cependant la finesse des pois dépend aussi de la nature du terrain et des engrais. Quant à la tendreté, elle dépend bien sûr de la variété, mais aussi du terrain et du degré de maturité. “Des moyens de début de saison valent beaucoup mieux que des extra-fins de fin de saison”, disait-on chez AMIEUX [1].
[1] Entretien avec un représentant d’AMIEUX.
Les prix d’achat fixés par les conserveurs, dans les contrats, reposaient d’abord sur la grosseur des pois. Ce n’est qu’à partir de 1967, que fut envisagé, par le contrat national, la possibilité de mesurer objectivement la tendreté des pois fins au moyen du tendéromètre MARTIN. Dans les prix payés aux cultivateurs, il n’était pris en compte que deux grosseurs de pois : les “gros”, correspondant à des perforations du crible de plus de 8 mm2, et les “fins”, passant par des perforations inférieures à 8 mm2. Le Syndicat des producteurs de légumes réclama en 1974, le paiement en 3 cribles au lieu de 2, ce qui aurait sans doute rendu les paiements plus équitables pour les agriculteurs. Les différences de tarifs étaient assez importantes entre ces 2 qualités : pour 1964, le prix du kilo de “gros”pois est fixé à 0,355 F et celui du kilo de pois “fins” à 0,996 F, soit presque le triple. D’ailleurs, cette année-là, au cours de la réunion interprofessionnelle entre producteurs de légumes et conserveurs, “Le Président GARNIER estime qu’il serait souhaitable de diminuer un peu le prix des fins au profit des gros, car les producteurs qui récoltent un assez fort pourcentage de gros, sont désavantagés. Il signale toutefois que les producteurs et conserveurs de l’Oise et de Nord, ne sont pas d’accord pour opérer ces modifications dans les prix”. En 1968, les prix n’ont guère changé, les gros ont légèrement augmenté : 0,996 F le kilo de fins, et 0,364 F le kilo de gros.
[1] Entretien avec un représentant d’AMIEUX.
Ce n’est qu’au moment de la livraison des pois à l’usine que le pourcentage de gros et de fins dans chaque lot était calculé par une méthode d’échantillonnage. Il semble qu’il y ait eu assez souvent des contestations à propos des échantillons, de la part des cultivateurs. Les conditions du criblage faisaient l’objet d’une réglementation précise, dont l’application était vérifiée par un contrôleur de l’UNILEC (Union Nationale Interprofessionnelle des Légumes de Conserve) : “Il est convenu que, conformément au contrat national, les pieds du cribleur doivent être scellés, le crible étant incliné à 35°. M. POTIRON (le contrôleur) demande que le criblage se fasse en 2 temps. Un premier criblage serait fait sur une quantité supérieure à 5 kg, 10 kg par exemple, et le 2ème sur 5 kg provenant du premier, c’est-à-dire, sur des pois propres” (les déchets de fanes ou de cosses ayant été enlevés).
Mais les contestations pouvaient aussi avoir leur origine dans les conditions de récolte et de battage des pois, puisque nous avons vu que l’attente pour passer à la batteuse pouvait entraîner un excès de maturité des pois restés sur pied, ou un dessèchement de ces derniers s’ils étaient coupés, voire une fermentation qui conduisait tout le lot au rébus et produisait alors une perte sèche pour le cultivateur. Les contestations s’accrurent encore lorsque le principe de la tenderométrie commença à se répandre, car les retards dans le fauchage et le battage, faisaient courir le risque de durcissement des pois. Tous les conserveurs n’utilisèrent pas la tenderométrie, chez AMI EUX, par exemple.
Dans la réunion interprofessionnelle producteurs de légumes-conserveurs, de mars 1968, il est indiqué : “en ce qui concerne la tenderométrie, jusqu’à présent la Maison CASSEGRAIN et les Maraîchers Nantais étaient les seuls à utiliser ce procédé. Il est possible que cette année la Maison AMIEUX l’utilisera également” ; en fait, elle ne l’utilisa pas.
Cette mesure de la tendreté des pois amène les conserveurs à fixer un indice au-delà duquel les lots étaient refusés. Les cultivateurs se montrèrent assez mécontents de l’application de ce principe ou tout au moins des conditions dans lesquelles il était mis en oeuvre. Dans l’enquête de 1971 déjà citée, ce mécontentement se manifeste : “Non à la tenderométrie s’il n’est pas possible de battre, comme au 14 juillet (agriculteurs de l’Hébergement). Exigences toujours importantes des conserveurs, surtout pour la tenderométrie (Saint-Laurent des Autels). Beaucoup de déceptions avec la tenderométrie et avec le pourcentage de fins (Montaigu). La tenderométrie ne pourrait-elle pas être prise à la batteuse ?
Différences de prix toujours importantes, compte tenu de la tenderométrie (l’Hébergement). Retards dans le battage et répercussions sur la tenderométrie (Saint-Macaire-en-Mauges)”. Le texte donnant les résultats de l’enquête continue ainsi : “Plusieurs réponses soulignent le problème particulier du 14 juillet : certains producteurs ne sont pas satisfaits des conserveurs qui ont mis à la poubelle des pois de bonne qualité (Rocheservière). Reproches à l’usine qui, pendant la saison, ne pouvait faire face aux apporteurs, d’où réception retardée, et pois très durs. Qui va payer les pois laissés à graine ? (Saint-Philbert-de-Grand-Lieu).
“Une suggestion est formulée par les producteurs de la région de Montaigu : quand un lot est refusé, le producteur n’est jamais seul responsible (courtiers, température). Mettre au point un système pénalisant les producteurs, mais faisant que les pois soient payés”.
Il est clair que les agriculteurs étaient les seuls à supporter les risques et les pertes financières liées aux conditions de la récolte et particulièrement du battage, alors qu’ils n’étaient pas maîtres de ces conditions. Par ailleurs, étant donné l’emprise de plus en plus grande qu’avaient les conserveurs sur les conditions mêmes de la culture, depuis les semis jusqu’à la récolte, les agriculteurs reprochaient aux courtiers, dépendant des conserveurs, de ne pas remplir complètement leur fonction, c’est-à-dire le contrôle de l’état des cultures tout au long de la saison ce qui éviterait aux cultivateurs certaines pertes. En effet, divers problèmes pouvaient se présenter dans les cultures et une intervention précoce pouvait dans certains cas sauver la récolte. Le représentant d’AMIEUX dit : “Dès qu’il y avait un problème chez un cultivateur, on m’appelait :
problème de maladie, d’insectes, mauvaises herbes dont la morelle, qui donne une graine de même densité, de même grosseur que les petits pois. En grande quantité c’est un poison, et puis c’est amer à manger. Quand j’en voyais dans un chargement, même arrivé à l’usine, je refusais catégoriquement tout le lot…
Quelquefois, on allait contrôler dans les champs. Il arrivait qu’un courtier me dise : je suis ennuyé, chez untel il y a de la morelle, venez donc voir est-ce que ça vaut le coup qu’il récolte…”.
Dans ces cas-là, la visite avant la récolte pouvait au moins éviter au cultivateur de faucher inutilement. Dans l’enquête de 1971, on retrouve plusieurs reproches faits aux courtiers et agents de culture (représentants des conserveurs) de la part des cultivateurs : “L’attitude des courtiers se limite à distribuer les semences et à payer. Ils devraient visiter les champs en cours de campagne et à la récolte (L’Hébergement). Manque de surveillance des courtiers sur l’état des champs au moment de la récolte (Montaigu)”.
Ce problème du manque de surveillance de la part des courtiers avait fait l’objet de plusieurs discussions dans les réunions interprofessionnelles producteurs-conserveurs. A celle de février 1967, on trouve : “Monsieur BECHU (du groupement CINAL) rappelle que l’année dernière, une réunion avait eu lieu à Clisson avec les courtiers, pour les inciter à s’intéresser d’une façon plus concrète à la marche de la récolte, mais n’avait pas donné de résultat valable. Il pense, étant donné le rôle important des courtiers dans la campagne de pois, qu’il serait bon de revoir la question”.
Liée à ce problème de la qualité des pois et donc de leur prix, se posait aussi la question des conditions de paiement. Le paiement des agriculteurs, pour les pois vendus aux conserveurs, se faisait aussi par l’intermédiaire des courtiers. Ce fait, déjà, ne satisfaisait pas toujours les agriculteurs : ils estimaient que les courtiers mettaient trop de temps à reverser aux uns et aux autres les sommes qui leur étaient dues. On trouve cette réclamation clairement exprimée dans la réunion interprofessionnelle de mars 1964: “Monsieur BILLAUD, appuyé par Monsieur LEBOT [1], demande que le règlement soit effectué directement aux producteurs et non aux courtiers afin d’éviter les retards qui ont eu lieu les années précédentes. Le Président GARNIER répond à M. BILLAUD que pour des cultures aussi fractionnées que celles de la région, le paiement direct aux producteurs serait difficilement réalisable, et que d’autre part, le rôle des courtiers comme fournisseurs des producteurs en engrais et autres produits nécessaires pour la culture, entraînerait des complications au moment du règlement. La ventilation des lots sans le concours des courtiers serait du reste parfois impossible, certains cultivateurs portant le même nom”.
[1] M. BILLAUD, représentant des syndicats d’exploitants agricoles de Loire Atlantique est alors “Président de la Commission Petits pois et Légumes de Conserverie”. M. LEBOT est “Secrétaire animateur de la F.D.S.E.A.”.
Parmi les trois raisons avancées par M. GARNIER pour refuser le paiement direct aux cultivateurs, deux (la 1ère et la 3ème) font référence à une difficulté d’organisation autre de ces paiements. Mais la 2ème raison invoquée tient au type de relation existant entre les producteurs et les courtiers : “Les complications au moment du règlement”, font allusion sans doute au fait que les courtiers récupéraient au passage, sur ces sommes dues aux agriculteurs, l’argent que ces derniers leur devaient pour l’achat d’engrais ou “d’autres produits nécessaires pour la culture”. Ainsi, les mauvaises années de production de petits pois ou de flageolets, (pour lesquels les conditions étaient les mêmes), certains agriculteurs pouvaient ne toucher aucune somme d’argent en fin de campagne, leur part restant entre les mains des courtiers pour paiement de leurs dettes. “La plupart du temps, la plus grande part de l’argent allait dans la poche du courtier qui avait vendu aux cultivateurs les engrais etc.. C’est pour ça que les cultivateurs auraient bien aimé ne pas être payés par les courtiers. Les courtiers récupéraient ça par les petits pois, par le blé et par le vin” [1]. Les agriculteurs étaient finalement contrôlés techniquement et financièrement à la fois par les conserveurs et les courtiers. D’ailleurs, même le Syndicat des Producteurs de Légumes de Conserves finissait par utiliser ces mêmes moyens de contrôle, puisqu’il demandait aux Conserveurs, en accord sans doute avec sa base, de faire les retenues de cotisations syndicales sur les sommes dues aux agriculteurs.
Chaque année, à la réunion interprofessionnelle entre conserveurs et producteurs, le représentant du Syndicat des Producteurs, indique aux conserveurs le tarif de la cotisation syndicale à retenir : 1964 “Les conserveurs acceptent de retenir comme les années précédentes, les cotisations sur les règlements de pois et de flageolets et de les reverser ensuite à la F.D.S.E.A.”.
“Monsieur BILLAUD indique ensuite que rien n’est changé au sujet des taxes syndicales et demande aux conserveurs, qui acceptent, que ces taxes soient perçues en 1967 au même taux, soit 1,50 F par tonne, de pois en grains ou de flageolets, et selon la même méthode qu’en 1966”.
Par ailleurs, un autre motif de réclamations de la part des agriculteurs était le délai officiellement fixé au contrat national, et appliqué parfois avec des variantes régionales, pour le paiement des pois et flageolets. En 1965, le contrat national [2] spécifie : “règlements, sauf accord, en trois acomptes : 1/3 fin août, 1/3 fin décembre, 1/3 fin février”. Nous avons vu que le paiement des surplus de production pris par les conserveries étaient payés plus tard : “50 % au 31 janvier 1966, 50 % au 31 mars 1966” prévoyait le contrat national 1965. Dans la pratique, au niveau de la région nantaise, des aménagements un peu différents sont apportés. A la réunion interprofessionnelle de 1967, “après discussion, il est décidé d’un commun accord qu’il pourra être adopté deux formules, soit celle consistant à payer 60 % du net au 15 octobre et 40 % au 30 janvier 1968, soit celle prévue au contrat national, c’est à dire 1/3 fin août, 1/3 fin novembre, 1/3 pour solde fin janvier”. Quelle que soit la solution adoptée, les cultivateurs devaient attendre plusieurs mois avant d’être payés pour la totalité des produits finis.
[1] Entretien avec un représentant d’AMIEUX auprès des cultivateurs.
[2] Le contenu du contrat national est présenté au cours d’une réunion entre délégués communaux des agriculteurs produisant des petits pois de conserverie – 12 février 1965 – Archives F.D.S.E.A. – C.D.M.O.T.
De plus, les agriculteurs ne savaient pas, au moment où leur produit était livré à la conserverie, surtout pour les pois, quelle somme ils allaient en tirer. Cela dépendait de la quantité, qu’ils connaissaient parce que le pesage avait lieu à la batteuse, mais aussi de la qualité, qu’ils ne connaissaient pas puisque criblage et tendérométrie ne se faisaient qu’à l’usine après la réception. Les cultivateurs eux-mêmes n’étaient pas présents à l’usine au moment de la réception de leurs produits, puisque c’était les conserveurs qui les prenaient en charge à partir de la batteuse et les faisaient transporter à l’usine. Les courtiers fournissaient à l’usine les informations nécessaires sur la provenance des lots. Ce n’est qu’à la fin de la saison que les agriculteurs étaient informés de la qualité de leurs produits et par conséquent de ce que la campagne allait leur rapporter.
Etant donné les rapports de créditeur à débiteur existant entre les courtiers et les agriculteurs, ces derniers demandaient [1] “qu’un avis soit envoyé individuellement le 1er octobre à chaque producteur, indiquant le détail des sommes à verser au courtier pour le 15 octobre”. Cela pouvait au moins permettre aux agriculteurs de contrôler eux-mêmes les calculs des courtiers soustrayant les dettes de ces revenus.
[1] Réunion interprofessionnelle du 6 mars 1964 entre les délégués communaux des producteurs de légumes de conserverie, et les conserveurs. Archives C.D.M.O.T.
Comme nous l’avons souligné plusieurs fois, l’organisation des rapports entre agriculteurs et conserveurs ne portait pas uniquement sur les petits pois. Ce légume a été, jusqu’à la fin des années 60, celui qui occupait le plus de place en culture et en fabrication de conserve dans la région nantaise Puis les agriculteurs de cette région du sud de la Loire s’en détournèrent, ne pouvant soutenir la concurrence sur les prix de revient des régions du nord de la France. Dans l’enquête de 1971, déjà citée, menée auprès des producteurs de légumes, “leurs réponses sont très pessimistes” quant à l’avenir du petit pois dans la région nantaise. Beaucoup parlent d’abandonner cette culture, pour un ensemble de raisons : “avenir incertain, conditions de travail trop dures, mécanisation difficile compte tenu des structures “, et surtout “prix insuffisants par rapport au travail et aux investissements. La paiement intervient trop tard ; il faudrait [1] mois au plus tard après la récolte”.
Le flageolet prend, à partir des années 60 , un plus grand développement dans les cultures de la région. Est-ce une reconversion de ces mêmes agriculteurs ? Sans doute en partie. Et cependant les conditions de cette culture, celles du paiement, sont à peu près identiques aux conditions concernant les petits pois. Le compte-rendu de l’enquête de 1971, nous apprend qu'”à l’inverse des réponses pessimistes évoquées pour le pois, celles que nous avons reçues pour le flageolet confirment la volonté de maintenir, voire d’étendre cette culture, à certaines conditions”. Parmi les conditions, on trouve celle de prix plus élevés que devaient payer les conserveurs, notamment par rapport aux prix des semences. Il ne semble pas qu’il y ait eu pour les flageolets, des contrats aussi précis que pour les petits pois, du moins sur les quantités à ensemencer. A la réunion interprofessionnelle de 1964, des délégués de producteurs demandent que soient signés de tels contrats : “Certains délégués de producteurs pensent qu’il serait souhaitable de régulariser la production en passant par exemple des contrats comme pour les petits pois. En ce qui concerne la qualité des livraisons, qui est due en grande partie à celle des semences, et aussi afin d’éviter des dépassements en quantité, réalisées par certains producteurs, Monsieur LEBOT demande qu’il soit envisagé des contrats entre le conserveur et le producteurlivreur, spécifiant les quantités de semences à fournir. Le producteur s’engagerait sur ce contrat à n’utiliser que les semences cédées par le conserveur… Le Président GARNIER répond que cette question peut être envisagée, mais qu’elle doit être étudiée avant de se prononcer sur son utilité et les possibilités de réalisation”. Chaque année la discussion entre conserveurs et producteurs de flageolets porte presque exclusivement sur les prix, et il n’y a pas toujours d’accord conclu : en 1968, alors que les producteurs de flageolets demandent une augmentation des prix, les conserveurs entendent eux appliquer une baisse, correspondant aux prix payés dans d’autres régions. De même en 1972, les producteurs de flageolets n’obtiennent pas l’augmentation qu’ils demandent [1]: “…La campagne “flageolets” est maintenant en cours et nous ne pouvons que regretter l’incompréhension des conserveurs qui n’a pas permis, comme les années précédentes, d’aboutir à un prix interprofessionnel. Nous sommes contraints d’accepter le prix, même s’il ne nous satisfait pas. Par ailleurs, aucune garantie ne nous a été donnée, pour ce qui concerne l’avenir.
Nous le regrettons car il n’est pas possible d’orienter nos cultures, d’engager des investissements, sans assurances pour les années futures”. Ainsi, bien que les flageolets apparaissent comme un produit plus rentable que les petits pois, aux yeux des cultivateurs, certains estiment “être trop à la merci des conserveurs” [2].
Les contrats pour les céleris n’étaient pas passés avec les mêmes agriculteurs que ceux produisant petits pois et flageolets, puisqu’il ne s’agissait pas de cultures de plein champ, mais de maraîchage. Un “contrat-type de culture ou fourniture de céleris”, daté de 1973, met en évidence la précision avec laquelle est définie la qualité du produit. Certains critères sont mesurables : grosseur et longueur des pieds : “Pour les céleris de type nantais”, les pieds devront être coupés à 40 cm, hors tout, 80% du chargement devra être composé de pieds pesant entre 500 et 800 grammes l’un ; dans les 20% restants, aucun pied ne devra peser moins de 400 g ou plus de 900 g”.
D’autres critères, spécifiés au contrat, peuvent être sujets à discussion, parce que moins précis : “Les céleris ne devront être ni jaunes, ni blancs, ni trop verts, et présenter une couleur vert-pâle. Les talons auront une coupe franche et ne devront pas dépasser un centimètre d’épaisseur, mais seront cependant suffisamment épais pour que les côtes extérieures y adhèrent solidement.
[1] Lettre du Syndicat des producteurs de légumes de conserve de Loire et Sèvre aux délégués communaux – 28 juin 1972 – Archives F.D.S.E.A. – C.D.M.O.T.
[2] Enquête d’octobre 1971 – Déjà citée.
“Les rejets, les branches fendues, éclatées, pourries, rouillées, tâchées excessivement par des produits de traitement et celles adhérant mal aux pieds, devront être éliminés. Seront également à éliminer, les pieds verts, montés, creux ou mal formés, les pieds échauffés et les coeurs pourris”.
S’il est vrai que les conserveries ont constitué un débouché important pour les produits agricoles de la région nantaise, aujourd’hui cette agriculture a du se reconvertir car il n’y a plus sur Nantes de conserverie traitant les légumes.
Ces types d’usines ont été installés dans d’autres zones agricoles de plus grande culture.
